

![]()
5ème émission juin 2005
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le mois dernier, j’annonçais ainsi la présente émission :

« Le 5ème épisode de juin 2005, intitulé « Peuples indigènes » insistera sur la diversité de notre monde et sera consacré à un monde qui fût le nôtre il y a très longtemps, et qui existe encore. Savez-vous que les peuples autochtones de notre planète représentent 300 millions de personnes, réparties en quelques 5000 groupes distincts, dont 70 groupes n’ont aucun contact avec le reste du monde. Parmi ces derniers, une cinquantaine se trouve en Amazonie. Nous parlerons des tribus de chasseurs-cueilleurs d’avant la révolution néolithique, il y a plus de 10 000 ans ».
Eh bien, je vous propose tout de suite une introduction sur ces peuples indigènes, appelés aussi avec des significations assez voisines, groupes autochtones, populations tribales, ou minorités ethniques, et, ensuite, pour bien vous imprégner, je vous propose un vaste tour du monde impressionniste d’une vingtaine de peuples, à travers, pour chacun d’eux, les mêmes questions : « Qui sont-ils ? Comment vivent-ils. A quels problèmes sont-ils confrontés ? ».
 Voilà,
démarrons donc cette introduction avec quelques points qui leur sont communs :
Ces minorités ethniques ou ces peuples indigènes, sont si nombreux qu'il est
impossible de les nommer tous. Présents sur les cinq continents, ils
représentent encore 300 millions de personnes, répartis dans plus de 70 pays
dans le monde. 300 millions, c’est une goutte d'eau par rapport à ce qu'ils
étaient au début du siècle. Ces peuples ont tout connu : colonisés,
massacrés, dominés, chassés, dépouillés, conquis avec leur environnement
dévasté…
Voilà,
démarrons donc cette introduction avec quelques points qui leur sont communs :
Ces minorités ethniques ou ces peuples indigènes, sont si nombreux qu'il est
impossible de les nommer tous. Présents sur les cinq continents, ils
représentent encore 300 millions de personnes, répartis dans plus de 70 pays
dans le monde. 300 millions, c’est une goutte d'eau par rapport à ce qu'ils
étaient au début du siècle. Ces peuples ont tout connu : colonisés,
massacrés, dominés, chassés, dépouillés, conquis avec leur environnement
dévasté…
Que leur reste-t-il ? Dans le monde entier, des colons se sont installés sur des terres qui ne leur appartenaient pas, puis en ont coupé les arbres.
L'industrie pétrolière a eu des effets désastreux sur la vie et l'environnement de ces peuples, les routes ont dévasté des territoires entiers. Les indigènes ont été tués par milliers à cause des épidémies apportées par les colonisateurs.
C'est en 1923 que la Société des
Nations fut saisie pour la première fois de la question des communautés
autochtones,...puis l’ONU a pris le relais. Afin de venir en aide et de
soutenir ces peuples minoritaires,
Pour cette émission, je m’appuierai sur l’association « Survival », de renommée internationale, qui soutient activement les organisations indigènes pour la défense de leurs terres et qui bénéficie d'un statut de consultant auprès des Nations unies, ce qui a permis à un grand nombre de représentants indigènes de faire connaître leurs problèmes. Enfin, son objectif est aussi d'accroître la prise de conscience du public pour un changement durable.
Quant à l’action de l’ONU : la protection des droits des peuples autochtones est un de ses récents volets d’activité. Bien que leurs cultures divergent, les divers groupes du monde entier ont les mêmes problèmes. Les peuples autochtones de par le monde se sont efforcés de faire reconnaître leur identité, leur mode de vie et leur droit aux terres et aux ressources traditionnelles. Or, leurs droits sont violés depuis toujours. La nécessité de prendre des mesures spéciales pour la protection de leurs droits est de plus en plus reconnue, cela concerne un large éventail de problèmes touchant les droits fondamentaux notamment dans les domaines de la santé, du logement et de l’éducation.
Maintenant, partons pour notre tour du monde auprès de ces peuples, à travers 25 brèves escales : 7 africaines, 10 américaines, et enfin 8 asiatiques au sens large. Parmi ces 25 peuples visités, la moitié sont des chasseurs-cueilleurs. Il est bon de préciser que l'homme a vécu de chasse et de cueillette 99 % de son temps depuis son émergence, il y a bien longtemps sur notre terre.
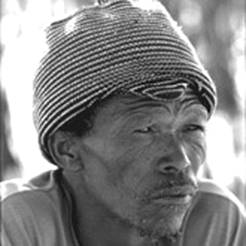 « Comment
vivent-ils ? » Les Bushmen sont des chasseurs-cueilleurs
qui, pendant des milliers d'années, ont trouvé leur subsistance dans le désert
grâce à leurs connaissances et à leurs compétences. Ils chassent,
principalement plusieurs espèces d'antilopes, mais leur nourriture quotidienne
a toujours été surtout constituée de fruits, baies et racines du désert. Ils se
construisent des abris de bois temporaire. Beaucoup d'entre eux ont été forcés
de quitter leur territoire et de vivre dans des villages situés dans des zones
impropres à la chasse et à la cueillette ; ils doivent faire un peu de culture
ou travailler dans des fermes.
« Comment
vivent-ils ? » Les Bushmen sont des chasseurs-cueilleurs
qui, pendant des milliers d'années, ont trouvé leur subsistance dans le désert
grâce à leurs connaissances et à leurs compétences. Ils chassent,
principalement plusieurs espèces d'antilopes, mais leur nourriture quotidienne
a toujours été surtout constituée de fruits, baies et racines du désert. Ils se
construisent des abris de bois temporaire. Beaucoup d'entre eux ont été forcés
de quitter leur territoire et de vivre dans des villages situés dans des zones
impropres à la chasse et à la cueillette ; ils doivent faire un peu de culture
ou travailler dans des fermes.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Le territoire des Bushmen a été envahi par les éleveurs bantous il y a environ 1500 ans et par les colons blancs ces 100 dernières années. Depuis cette époque, ils doivent faire face à la discrimination, à l'expulsion de leurs terres ancestrales, aux meurtres et à l'oppression qui ont abouti à un génocide massif, mais dont on ne parle pas, qui a réduit leur nombre de plusieurs millions à 100 000. Au Botswana, les Gana et les Gwi de la réserve de gibier du Kalahari central sont parmi les plus persécutés. Ils n'ont aucun droit sur leur terre et le gouvernement du Botswana tente depuis 16 ans de les faire partir de force de leur habitat ancestral.
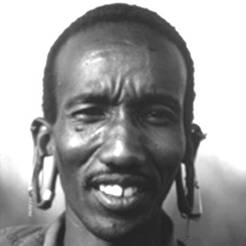 « Comment
vivent-ils ? » Pour les Maasaï,
le bétail est ce qui rend la vie belle ; la viande et le lait sont les
meilleurs aliments. Leur idéal était de ne vivre que du bétail mais à présent
ils doivent aussi pratiquer l'agriculture. Et les Maasaï ont été de plus en plus forcés de se sédentariser dans des villages et beaucoup
d'entre eux sont contraints de chercher un travail salarié.
« Comment
vivent-ils ? » Pour les Maasaï,
le bétail est ce qui rend la vie belle ; la viande et le lait sont les
meilleurs aliments. Leur idéal était de ne vivre que du bétail mais à présent
ils doivent aussi pratiquer l'agriculture. Et les Maasaï ont été de plus en plus forcés de se sédentariser dans des villages et beaucoup
d'entre eux sont contraints de chercher un travail salarié.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Depuis la période coloniale, la plupart des terres Maasaï ont été accaparées au profit de fermiers et de domaines privés, de projets gouvernementaux ou de parcs consacrés à la vie sauvage. Il ne leur a été laissé que les terres les plus arides et les moins fertiles. Ceux sont des éleveurs très efficaces qui ont rarement plus d'animaux que ne l'exigent leurs besoins ou que la terre ne peut en supporter. Mais le sol a été surexploité et la majorité de Maasaï, à qui trop peu de terres ou les plus mauvaises ont été laissées, se sont considérablement appauvris.
 « Comment
vivent-ils ? » Contrairement à la majorité des Fulani, les Mbororo ont conservé
leur mode de vie pastoral, élevant leur bétail dans les vastes prairies du
plateau. Ils sont fiers de leur identité et de leur culture qui enseigne
l'indépendance, la discrétion et le contrôle de soi. Ils se sont convertis à
l'islam durant le siècle dernier. Ils sont longtemps restés à l'écart des
autres peuples, mais sont désormais dans une période de transition qui passe
pour certains d'entre eux par la scolarisation de leurs enfants et l'abandon
progressif de l'agriculture et de l'élevage.
« Comment
vivent-ils ? » Contrairement à la majorité des Fulani, les Mbororo ont conservé
leur mode de vie pastoral, élevant leur bétail dans les vastes prairies du
plateau. Ils sont fiers de leur identité et de leur culture qui enseigne
l'indépendance, la discrétion et le contrôle de soi. Ils se sont convertis à
l'islam durant le siècle dernier. Ils sont longtemps restés à l'écart des
autres peuples, mais sont désormais dans une période de transition qui passe
pour certains d'entre eux par la scolarisation de leurs enfants et l'abandon
progressif de l'agriculture et de l'élevage.
« A quels
problèmes sont-ils confrontés ? » L'installation de colons
sur leurs pâturages communaux et l'intensification de leurs activités agricoles
et pastorales génèrent de nombreux conflits territoriaux. Les politiques
officiels marginalisent leur mode de vie pastoral. De plus les Mbororo de
 « Comment
vivent-ils ? » Les Mursi et les Bodi vivent dans les environs de la vallée de
« Comment
vivent-ils ? » Les Mursi et les Bodi vivent dans les environs de la vallée de
« A quels
problèmes sont-ils confrontés ? » Le manque d'eau et la
désertification progressive de l'environnement des Mursi et des Bodi provoquent des conflits dont la terre est
le principal motif. De plus en 2004, plus de 2000 colons Konso ont été déplacés sur le territoire des Bodi par le
gouvernement éthiopien. Ces méthodes ne peuvent qu'exacerber
 « Comment
vivent-ils ? » Les Nuba sont des
fermiers très compétents qui cultivent sur des terrasses à flanc et, quand la
paix le permet, dans les plaines fertiles ; ils ont aussi du bétail. Ils
honorent les morts et respectent leurs chefs religieux qui sont aussi
guérisseurs.
« Comment
vivent-ils ? » Les Nuba sont des
fermiers très compétents qui cultivent sur des terrasses à flanc et, quand la
paix le permet, dans les plaines fertiles ; ils ont aussi du bétail. Ils
honorent les morts et respectent leurs chefs religieux qui sont aussi
guérisseurs.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Pendant des siècles, les Nuba ont du se défendre contre les recruteurs d'esclaves et autres ennemis. A partir des années 1960 leurs plaines ont été accaparées par d'énormes fermes commerciales. Ceux qui refusent d'abandonner leurs terres sont harcelés, emprisonnés ou assassinés. Les Nuba sont aussi pris en tenaille dans la longue guerre civile qui met aux prises le gouvernement et les rebelles du sud, leurs villages sont bombardés, beaucoup sont assiégés, la population est déportée et internée.
 « Comment
vivent-ils ? » Ceux qui vivent dans la forêt profonde ne
pratiquent que la chasse et la cueillette mais la majorité cultive des légumes
et élève du bétail. Traditionnellement ils chassaient les antilopes et les
porcs sauvages, ce qui est devenu illégal. Ils cueillent des plantes sauvages
et recueillent le miel des ruches aménagées dans des tronçons d'arbres creux
qu’ils placent dans les branches élevées des arbres. Le miel occupe une place
importante chez les Ogiek, il est utilisé comme
aliment, pour fabriquer la bière et pour commercer avec des populations
voisines, hors de la forêt.
« Comment
vivent-ils ? » Ceux qui vivent dans la forêt profonde ne
pratiquent que la chasse et la cueillette mais la majorité cultive des légumes
et élève du bétail. Traditionnellement ils chassaient les antilopes et les
porcs sauvages, ce qui est devenu illégal. Ils cueillent des plantes sauvages
et recueillent le miel des ruches aménagées dans des tronçons d'arbres creux
qu’ils placent dans les branches élevées des arbres. Le miel occupe une place
importante chez les Ogiek, il est utilisé comme
aliment, pour fabriquer la bière et pour commercer avec des populations
voisines, hors de la forêt.
« A quels
problèmes sont-ils confrontés ? » Dès les débuts de l'ère
coloniale, il y eut des tentatives pour chasser les Ogiek de leurs forêts ancestrales, sous prétexte qu’ils
 d'endroits,
ils sont reconnus comme les premiers habitants de
d'endroits,
ils sont reconnus comme les premiers habitants de
« Comment
vivent-ils ? » Les Pygmées sont des gens de la forêt
qu'ils connaissent et dont ils connaissent intimement la faune et
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Les Pygmées voient leur forêt tropicale humide menacée par les coupes de bois ; eux-mêmes sont chassés par les colons. En certains endroits ils ont été expulsés et leur terre a été déclarée parc national. Ils sont continuellement privés de leurs droits par le gouvernement qui ne considère pas ces habitants de la forêt comme des citoyens égaux.
 du
Brésil mais pour elle comme pour beaucoup d'autres, ce nomadisme en soirée
est le résultat de la fuite devant les persécutions et du choix de
l'isolement comme refuge dans les forêts, aujourd'hui dévastées, de l'Est
amazonien. Ils sont en grave danger d'être tous anéantis.
du
Brésil mais pour elle comme pour beaucoup d'autres, ce nomadisme en soirée
est le résultat de la fuite devant les persécutions et du choix de
l'isolement comme refuge dans les forêts, aujourd'hui dévastées, de l'Est
amazonien. Ils sont en grave danger d'être tous anéantis.« Comment
vivent-ils ? » Au tout début du 19e siècle, les Awa ont
abandonné la vie sédentaire et l'agriculture pour la vie nomade afin d'échapper
aux violentes attaques des envahisseurs européens. Tous assurent leur
subsistance par la chasse et
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Durant les 100 dernières années, les Awa ont été victimes des tentatives d'extermination, perverses et systématiques, de la part des fermiers et des colons. Nombre de ceux qui sont en contact avec l'extérieur, sont les survivants de massacres et gravement traumatisés. Ils resteront vulnérables tant que leur terre ne sera pas légalement protégée. L'accroissement des empiètements de leur territoire par l'industrialisation, les fermiers et les colons expose les Indiens à la violence et aux maladies.
 marécages.
marécages.« Comment vivent-ils ? » Les Ayoreo sont des chasseurs-cueilleurs nomades qui habitaient autrefois une grande région de forêts et de brousse épineuse. Ils connurent leur premier contact durable avec les blancs quand des fermiers mennonites établirent des colonies sur leurs terres. La majorité du territoire Ayoreo est maintenant aux mains de propriétaires fonciers qui louent des équipes de travailleurs pour abattre les espèces d'arbres les plus rentables et introduisent le bétail sur la terre défrichée.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Pendant les années 1970 et 1980, les Ayoreo furent confrontés à une intense activité missionnaire qui encourageait ceux qui étaient convertis à poursuivre en forêt leurs ennemis traditionnels, les groupes nomades pour les amener de force à leur base. Il en est résulté de violents conflits. Leur terre fût aussi presque totalement confisquée par les fermiers, les indigènes ont beaucoup souffert de ce vol et, chassés de leurs forêts, eurent les plus grandes difficultés à assurer leur subsistance.
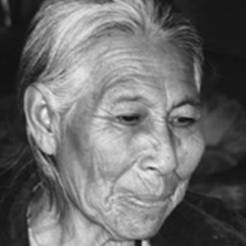 « Comment
vivent-ils ? » Ils étaient autrefois des
chasseurs-cueilleurs auto subsistants mais sont maintenant devenus des ouvriers
agricoles exploités dans les grandes fermes d'élevage qui ont absorbé leurs
terres. Ils arrivent à se nourrir, au moins en partie, grâce à la chasse et à
« Comment
vivent-ils ? » Ils étaient autrefois des
chasseurs-cueilleurs auto subsistants mais sont maintenant devenus des ouvriers
agricoles exploités dans les grandes fermes d'élevage qui ont absorbé leurs
terres. Ils arrivent à se nourrir, au moins en partie, grâce à la chasse et à
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » La terre des Enxet a été presque entièrement accaparée par les éleveurs qui ont abattu d'énormes zones de leurs forêts, souvent délibérément pour rendre la terre impropre aux activités de chasse et de cueillette. Ces dernières années, ils ont été soumis à un harcèlement et à des violences extrêmes pour leur faire quitter la terre qu'ils occupent encore ou pour qu'ils y meurent de faim.
 « Comment
vivent-ils ? » Les Guarani sont profondément
spiritualistes. Malgré leur division en différents sous-groupes, tous partagent
une religion qui place la Terre au-dessus de tout. Chaque communauté a une
maison de prière et un leader religieux dont l'autorité est plus fondée sur le
prestige que sur le pouvoir formel.
« Comment
vivent-ils ? » Les Guarani sont profondément
spiritualistes. Malgré leur division en différents sous-groupes, tous partagent
une religion qui place la Terre au-dessus de tout. Chaque communauté a une
maison de prière et un leader religieux dont l'autorité est plus fondée sur le
prestige que sur le pouvoir formel.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Les Guarani du Brésil ont terriblement souffert du vol de presque toutes leurs terres ; ils considèrent que cela constitue une offense contre leur religion aussi bien qu'une destruction de leur mode de vie et de leurs moyens d'existence. Des milliers d'entre eux sont maintenant entassés sur de très petites parcelles de plus en plus cernées par les fermes d'élevage et les plantations. La terre dont ils disposent n'est pas suffisante pour qu'ils puissent subsister de leurs activités traditionnelles : la chasse, la pêche et l'horticulture. Ce qui cause leur exploitation par les fermiers et les propriétaires comme main-d'œuvre bon marché.
 « Comment
vivent-ils ? » Actuellement les indiens du Brésil
constituent des sociétés très diverses, vivant dans des environnements aussi
variés que des forêts tropicales humides, des savanes, des forêts d'épineux ou
des déserts. Leur expérience de contacts avec les Européens est également très
variée : certains d'entre eux sont en contact avec les Blancs depuis cinq
siècles, d'autres ne le sont que depuis très récemment, enfin certains groupes
demeurent encore isolés. La plupart des Indiens du Brésil vivent de chasse, de
pêche, de cueillette et d'agriculture itinérante. Seuls les groupes non
contactés comme les Awa et les Maku d'Amazonie sont
totalement nomades et vivent exclusivement de chasse et de cueillette.
« Comment
vivent-ils ? » Actuellement les indiens du Brésil
constituent des sociétés très diverses, vivant dans des environnements aussi
variés que des forêts tropicales humides, des savanes, des forêts d'épineux ou
des déserts. Leur expérience de contacts avec les Européens est également très
variée : certains d'entre eux sont en contact avec les Blancs depuis cinq
siècles, d'autres ne le sont que depuis très récemment, enfin certains groupes
demeurent encore isolés. La plupart des Indiens du Brésil vivent de chasse, de
pêche, de cueillette et d'agriculture itinérante. Seuls les groupes non
contactés comme les Awa et les Maku d'Amazonie sont
totalement nomades et vivent exclusivement de chasse et de cueillette.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Depuis l'arrivée des Européens, les Indiens du Brésil ont subi un génocide à très grande échelle et ont été spoliés de la plupart de leurs terres par les propriétaires terriens, les industriels, les mineurs ou les colons. Ils meurent toujours, soit des maladies transmises par les envahisseurs, soit de malnutrition lorsqu'ils sont privés de leurs territoires de chasse, ou bien encore de la violence perpétrée par les hommes de main recrutés par les fermiers et les propriétaires terriens pour les chasser de leurs terres. Un racisme profondément enraciné vis-à-vis des Indiens est à l'origine de cette situation et l'exigence première des Indiens est de pouvoir exercer le contrôle de leurs terres.
 Le
territoire traditionnel des Innu qu'ils occupent
depuis des millénaires est une vaste région de forêts de conifères, de lacs et
de rivières.
Le
territoire traditionnel des Innu qu'ils occupent
depuis des millénaires est une vaste région de forêts de conifères, de lacs et
de rivières.
« Comment vivent-ils ? » Jusqu'à la seconde moitié du XXème siècle, ils étaient des chasseurs nomades. La plus grande partie de l'année, les cours d'eau étaient gelés et ils devaient se déplacer en petits groupes de deux ou trois familles sur des raquettes à neige, poussant des traîneaux. A la fonte des glaces, ils se rendaient en canoë sur la côte ou sur une grande île lacustre pour pêcher, commercer, retrouver leurs parents et amis. Ils chassaient l'ours, le castor et le porc-épic, pêchaient et cueillaient des baies mais vivaient aussi sur les troupeaux de caribous qui migrent à travers leur territoire au printemps et à l'automne. Jusqu'à très récemment, les Innu obtenaient tout ce dont ils avaient besoin du caribou. A présent, de nombreuses Innu ont été sédentarisés dans des villages.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Durant les années 1950 et 1960, les Innu nomades subirent les pressions du gouvernement canadien, de l'église catholique pour se fixer dans les villages. La vie sédentaire en communautés est traumatisante et marquée par un haut degré d'alcoolisme, de drogue chez les enfants, de violence et un taux record de suicides. Beaucoup d'Innu lutte toujours pour retrouver leur mode de vie traditionnel mais c'est devenu très difficile, le gouvernement attribuant des concessions minières sur leurs terres, inondant le cœur de leur territoire pour la construction d'usines hydroélectriques et sillonnant le reste par des routes.
 agriculteurs vivant dans la région montagneuse à la frontière
du Brésil et du Guyana.
agriculteurs vivant dans la région montagneuse à la frontière
du Brésil et du Guyana.« Comment vivent-ils ? » La terre des Macuxi est une magnifique région montagneuse couverte de forêts de savanes tropicales où ils élèvent du bétail. Pendant les longs mois de la saison sèche, ils chassent et pêchent dans toutes les rivières qui ne sont pas asséchées et rendent visite aux villages du voisinage.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Dés le début de la colonisation au XVIIIème siècle, les Macuxi ont enduré de terribles violences et le vol de leurs terres. Aujourd'hui ils souffrent particulièrement de l'invasion des fermiers et des orpailleurs qui non seulement détruisent leurs terres et leur apportent des maladies, mais les traitent avec une extrême brutalité ; certains fermiers engagent des hommes de main pour les intimider ou les assassiner. L’armée brésilienne constitue maintenant une nouvelle menace pour le Macuxi par la militarisation de la région.
 mais il est probable qu'ils y sont depuis les débuts
du peuplement de l'Amérique du Sud, vieux peut-être de cinquante mille
ans.
mais il est probable qu'ils y sont depuis les débuts
du peuplement de l'Amérique du Sud, vieux peut-être de cinquante mille
ans.« Comment
vivent-ils ? » Chaque communauté Yanomami vit dans une
très grande maison collective, qui peut abriter jusqu'à 400 personnes, bien
qu'ils soient généralement moins nombreux. Les Yanomami se nourrissent du
produit de leur chasse, de leur pêche, de leur cueillette et aussi des plantes
cultivées dans de vastes jardins défrichés dans
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Durant les années 1970 et 1980 les Yanomami ont considérablement souffert de l'invasion des chercheurs d'or sur leurs terres. En 20 ans 20 % d'entre eux sont morts. De plus le Brésil refuse toujours de leur reconnaître la propriété de leurs terres, malgré le droit international dont ce pays est signataire.
 prennent leur source plusieurs affluents de l'Amazone.
prennent leur source plusieurs affluents de l'Amazone.« Comment vivent-ils ? » Comme d’autres populations indigènes, les Yora se sont enfuis pour se réfugier dans cette région, il y a une centaine d’années. Ils ont ainsi tenté d'échapper aux massacres, à la chasse aux esclaves et aux maladies à l'époque du « boom » du caoutchouc. Aujourd'hui, ils s'isolent volontairement et évitent le contact avec le monde extérieur. Ils sont nomades, vivant en petits groupes familiaux qui se déplacent fréquemment. Pendant la saison sèche, ils se rapprochent des rivières pour pêcher plus facilement et ramasser les œufs de tortues sur le sable des berges ; ils se retirent dans la profondeur de la forêt à la saison des pluies pour chasser et cueillir les fruits, les baies et les noix d’Amazonie.
« A quels
problèmes sont-ils confrontés ? » Dans les années 1980 le
territoire des Yora a été envahi par la compagnie pétrolière Shell puis en 1996 ce fût
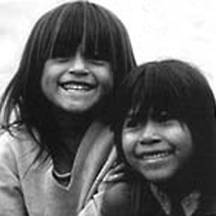 Les
quelque 40 000 Wichi en Argentine et en Bolivie.
Depuis des millénaires, ils occupent le nord de l'Argentine et avec d'autres
groupes indiens, ils vivent près des frontières entre l'Argentine, le Paraguay
et la Bolivie.
Les
quelque 40 000 Wichi en Argentine et en Bolivie.
Depuis des millénaires, ils occupent le nord de l'Argentine et avec d'autres
groupes indiens, ils vivent près des frontières entre l'Argentine, le Paraguay
et la Bolivie.
« Comment vivent-ils ? » Traditionnellement les Wichi sont des chasseurs, pêcheurs et cultivateurs. Autrefois, les forêts et les prairies fertiles de leur territoire leur procuraient tout ce dont ils avaient besoin. Mais l’introduction du bétail a transformé celui-ci en un désert sablonneux et aride les rendant vulnérables à des périodes de disette et même de famine, et plus dépendants pour leur survie, d'emplois occasionnels chez les étrangers.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Ces cent dernières années, leur territoire a été systématiquement envahi, les coupeurs de bois ont abattu la forêt, les colons ont introduit le bétail. Non seulement le bétail désertifie la terre mais pénètre dans les petites parcelles que les Wichi ont réussi à maintenir et détruit leur culture. Les Indiens ont été privés de leurs terres et de leurs moyens d'existence.
 « Comment
vivent-ils ? » La région centrale montagneuse de la
Papouasie est l'habitat des populations des hautes terres qui élèvent des porcs
domestiques et cultivent des patates douces, celles des basses terres vivent dans
les régions côtières, marécageuses et impaludées, où elles chassent un gibier
abondant et cueillent des végétaux sauvages. Certaines langues indigènes sont
apparentées entre elles mais d'autres sont complètement distinctes les unes des
autres. Les populations papoues sont ethniquement différentes des Indonésiens
qui contrôlent leur pays.
« Comment
vivent-ils ? » La région centrale montagneuse de la
Papouasie est l'habitat des populations des hautes terres qui élèvent des porcs
domestiques et cultivent des patates douces, celles des basses terres vivent dans
les régions côtières, marécageuses et impaludées, où elles chassent un gibier
abondant et cueillent des végétaux sauvages. Certaines langues indigènes sont
apparentées entre elles mais d'autres sont complètement distinctes les unes des
autres. Les populations papoues sont ethniquement différentes des Indonésiens
qui contrôlent leur pays.
« A quels
problèmes sont-ils confrontés ? » Les Papous ont
grandement souffert de la violente occupation indonésienne depuis
 des hautes
terres, vivant dans la région centre sud de la Papouasie.
des hautes
terres, vivant dans la région centre sud de la Papouasie.« Comment
vivent-ils ? » Le climat de leur région est froid et
humide. Ils sont essarteurs (agriculteurs sur
brûlis), chasseurs, éleveurs de porcs et cueilleurs de racines, noix et baies.
Ils attachent beaucoup d'importance sociale à la générosité et à
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Comme tous les peuples indigènes de la Papouasie, les Amungme ont grandement souffert de l'oppression et de la violence depuis l'invasion indonésienne dans les années 1960. Ils ont aussi particulièrement souffert de l'installation d'un énorme complexe minier d'extraction de cuivre et d'or dans leur territoire. Les propriétaires anglo-américains des mines ont détruit leurs montagnes sacrées. L'armée indonésienne réprime violemment les protestations.
 C’est
un peuple isolé, sans contact avec les étrangers, vivant dans les îles Andaman
de l'Océan indien. Durant les 150 dernières années, des colons britanniques et
indiens se sont installés sur leurs îles mais les Jarawa ont choisi de se maintenir dans un isolement presque total. Leur apparence est
très différente de celle de leurs voisins Indiens et les tests d'ADN suggèrent
un apparentement avec les Africains.
C’est
un peuple isolé, sans contact avec les étrangers, vivant dans les îles Andaman
de l'Océan indien. Durant les 150 dernières années, des colons britanniques et
indiens se sont installés sur leurs îles mais les Jarawa ont choisi de se maintenir dans un isolement presque total. Leur apparence est
très différente de celle de leurs voisins Indiens et les tests d'ADN suggèrent
un apparentement avec les Africains.
« Comment vivent-ils ? » Du fait de leur isolement volontaire et qu'aucun étranger ne parle vraiment leur langue, on sait très peu de choses sur eux. Nous savons qu'ils vivent de la chasse, notamment des cochons sauvages et des « lézards moniteurs », qu'ils pêchent avec des arcs et des flèches, qu'ils cueillent des graines, des baies et collectent du miel. Ils sont nomades, groupés en bandes de 40 à 50 personnes. Ils ont résisté à tout contact jusqu'en 1998 quand certains d'entre eux sortirent de la forêt pour visiter les villes et les villages voisins, surtout des femmes et des enfants. Ils continuent à vivre en auto subsistance dans la forêt.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Les menaces principales sont constituées par les empiètements sur leur territoire – fragmenté, depuis 1970 par la construction d'une route à travers la forêt – et le risque surtout de sédentarisation forcée. La sédentarisation forcée fut fatale à d'autres peuples des îles Andaman, comme elle l'est, partout dans le monde, aux populations jusque-là isolées, elle introduit toujours des maladies, détruit la conscience identitaire et le sens de l'appartenance sociale, prive les populations de leur autosuffisance et les livre sans défense à l'alcoolisme et au désespoir.
 Les Chakma et les Marma sont
bouddhistes, les autres tribus sont hindouistes ou pratiquent leurs propres
religions.
Les Chakma et les Marma sont
bouddhistes, les autres tribus sont hindouistes ou pratiquent leurs propres
religions.
« Comment vivent-ils ? » Les Chittagong Hill Tracts sont une région montagneuse et accidentée rendant toute culture difficile. Pour tirer le meilleur parti des pentes escarpées de leur territoire, les Jumma pratiquent l’agriculture sur brûlis, cultivant de petites parcelles durant un cycle annuel avant de se déplacer vers de nouvelles parcelles, laissant les anciennes en jachère.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Le gouvernement du Bangladesh a longtemps considéré la région des Chittagong Hill Tracts comme une terre vierge où il pouvait installer les Bengali pauvres et sans terre et n’a apparemment aucune considération pour les Jumma, qui en sont pourtant les habitants originels. Tout en ayant été chassés par ces derniers auxquels on attribue les meilleures terres, les Jumma ont longtemps été confrontés à une violente répression de l’armée. Depuis l’indépendance obtenue en 1971, les Jumma ont été assassinés, torturés, violés et ont vu leurs villages incendiés au cours d’une campagne génocidaire. Cependant, bien que la situation se soit quelque peu améliorée, les Jumma continuent de subir des violences et la spoliation de leur terre.
 Ce
territoire est recouvert d'une dense forêt tropicale et son sous-sol est
extrêmement riche en ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. Les Penan sont l'un des nombreux peuples indigènes du Sarawak,
mais ils sont les seuls nomades.
Ce
territoire est recouvert d'une dense forêt tropicale et son sous-sol est
extrêmement riche en ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. Les Penan sont l'un des nombreux peuples indigènes du Sarawak,
mais ils sont les seuls nomades.
« Comment
vivent-ils ? » Les Penan sont
des chasseurs-cueilleurs nomades. Bien que nombre d'entre eux soient désormais
sédentarisés, près de 500 Penan nomadisent encore
dans
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Depuis les années 1970, tous les peuples indigènes du Sarawak ont été spoliés de leur terre pour faire place à l'exploitation forestière, à la construction de barrages et aux plantations de palmier à huile, les contraignant à vivre dans des villes et villages où ils sont réduits à une extrême pauvreté. Au fur et à mesure de l'exploitation des forêts, les rivières s'envasent, la pollution tue les poissons et le gibier s'enfuit dans ce qu'il reste de forêt. Depuis 1987, les Penan qui mènent une lutte en bloquant les routes de transport du bois n'ont plus la possibilité de se nourrir. Certaines compagnies acceptent maintenant de ne plus exploiter les forêts penan.
Nos trois dernières escales vont nous conduire en Sibérie, en Russie.
 %
de la superficie de
%
de la superficie de
« Comment vivent-ils ? » Certains sont des éleveurs de rennes nomades vivant dans la toundra, d'autres, qui vivent dans la forêt de la toundra ou de la taïga ont une économie mixte d'élevage de rennes, de chasse et de cueillette et sont souvent sédentaires. Aujourd'hui seulement 10% des peuples de Sibérie ont une vie nomade ou semi-nomade contre 70% d'entre eux il y a 30 ans.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Sous le régime soviétique les « petits peuples » de Sibérie ont perdu leurs terres au profit d'industries d'État. Avec l'industrialisation, la région fut envahie par des gens de l'extérieur qui s'employèrent énergiquement à supprimer les langues, les cultures et les modes de vie indigènes. Aujourd'hui les plus gros problèmes sont ceux posés par la dégradation de l'environnement causée par l'exploitation du pétrole, du gaz naturel, des industries du bois et par l'opacité qui entoure la question des droits sur la terre.
 « Comment
vivent-ils ? » Traditionnellement les Khanty se déplacent avec leurs troupeaux, demeurant parfois dans des « chum »
(tentes en peau de renne) ou dans des maisons en rondins. Les Khanty dépendent largement des rennes qui leur fournissent
une grande part de leur nourriture et de leurs matériaux. Ils chassent aussi,
pêchent et cueillent des baies et se procurent des produits de première
nécessité grâce à la vente des rennes et des fourrures.
« Comment
vivent-ils ? » Traditionnellement les Khanty se déplacent avec leurs troupeaux, demeurant parfois dans des « chum »
(tentes en peau de renne) ou dans des maisons en rondins. Les Khanty dépendent largement des rennes qui leur fournissent
une grande part de leur nourriture et de leurs matériaux. Ils chassent aussi,
pêchent et cueillent des baies et se procurent des produits de première
nécessité grâce à la vente des rennes et des fourrures.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Dans les années 1930, sous le régime soviétique, les Khanty furent persécutés : leurs enfants enlevés et placés dans des internats, leurs chamanes tués. Aujourd'hui, ils sont menacés par les compagnies pétrolières. L'exploitation du pétrole sur leurs terres pollue leurs forêts et leurs lacs sacrés, tue les rennes et effraie le gibier. De nombreux Khanty ont été chassés de leurs terres. Ils en sont réduits à vivre dans des « villages nationaux » loin de leur territoire de chasse ancestral et sont devenus dépendants de l’administration et des compagnies pétrolières pour leur survie.
 « Comment
vivent-ils ? » Ils vivent au bord des rivières qui coulent
à travers la forêt et leurs différents sous-groupes tirent leur nom de ces
rivières. Ils obtiennent de la forêt tout ce dont ils ont besoin, se
nourrissant de chasse, de pêche et de cueillette, faisant aussi parfois pousser
des légumes. Par le commerce des fourrures, du saumon et du ginseng, ils
acquièrent d'autres marchandises.
« Comment
vivent-ils ? » Ils vivent au bord des rivières qui coulent
à travers la forêt et leurs différents sous-groupes tirent leur nom de ces
rivières. Ils obtiennent de la forêt tout ce dont ils ont besoin, se
nourrissant de chasse, de pêche et de cueillette, faisant aussi parfois pousser
des légumes. Par le commerce des fourrures, du saumon et du ginseng, ils
acquièrent d'autres marchandises.
« A quels problèmes sont-ils confrontés ? » Comme celui de nombreux peuples indigènes, le mode de vie des Udege fut détruit avec perversité par le régime soviétique. Les petits groupes familiaux arrachés à la forêt furent forcés de s'établir dans des villes, de parler russe et leur religion fut interdite. Les fâcheuses conséquences sur leur vie sociale s'en font encore sentir. Aujourd'hui les richesses en bois et en minerais de leur forêt attirent les intérêts économiques extérieurs. La plupart des Udege veulent que leur territoire soit déclaré « Territoire à usage de ressources naturelles traditionnelles », ce qui les protégerait contre de telles menaces.
Voilà ce large survol des peuples indigènes effectué, je pense que cela devrait permettre de donner une idée aux auditeurs.
Pour mieux connaître ces « Peuples indigènes », nos frères humains :
![]() Sur Internet, deux sites, le site « Survival », utilisé largement pour cette émission, à
partir d’un moteur de recherche, google par ex., également le site de l’ONU,
avec google, vous indiquez ONU et peuples indigènes, ceux sont deux sites
intéressants,
Sur Internet, deux sites, le site « Survival », utilisé largement pour cette émission, à
partir d’un moteur de recherche, google par ex., également le site de l’ONU,
avec google, vous indiquez ONU et peuples indigènes, ceux sont deux sites
intéressants,
![]() J’évoquerai aussi chez Plon, la collection « Terre
Humaine », qui a fêté en 2005 son cinquantième anniversaire et qui
constitue, comme le précise son fondateur Jean
Malaurie, « le sol d’un terreau de respect multiculturel, indispensable à
l’avenir du monde ».
J’évoquerai aussi chez Plon, la collection « Terre
Humaine », qui a fêté en 2005 son cinquantième anniversaire et qui
constitue, comme le précise son fondateur Jean
Malaurie, « le sol d’un terreau de respect multiculturel, indispensable à
l’avenir du monde ».
![]() Bien sûr, au cœur de cette collection, je
citerai « Tristes Tropiques » (2ème édit) de C. Lévi-Strauss.
Bien sûr, au cœur de cette collection, je
citerai « Tristes Tropiques » (2ème édit) de C. Lévi-Strauss.
 Alors,
maintenant pour terminer, comme d’habitude l’annonce de la prochaine émission.
Dans l’éventail des sociétés humaines, nous avons survolé aujourd’hui une
multitude de peuples indigènes, il me paraît intéressant, pour la prochaine
émission, de nous centrer sur une seule société humaine, située au milieu de
l’éventail, et d’approfondir son mode de fonctionnement. Lors de la 1ère
émission, j’avais évoqué, en boutade que j’étais un « samo blanc de Toma »,
aussi nous parlerons de l’ethnie samo au Burkina Faso, et plus précisément des
samos du Sud, appelés aussi les Maka. Pour la
préparation de cette émission, je sais déjà pouvoir m’appuyer sur le travail de
chercheurs français et burkinabè. La 6ème de « Regards du Sud »
s’intitulera donc « Les samos du Sud au Burkina Faso ».
Alors,
maintenant pour terminer, comme d’habitude l’annonce de la prochaine émission.
Dans l’éventail des sociétés humaines, nous avons survolé aujourd’hui une
multitude de peuples indigènes, il me paraît intéressant, pour la prochaine
émission, de nous centrer sur une seule société humaine, située au milieu de
l’éventail, et d’approfondir son mode de fonctionnement. Lors de la 1ère
émission, j’avais évoqué, en boutade que j’étais un « samo blanc de Toma »,
aussi nous parlerons de l’ethnie samo au Burkina Faso, et plus précisément des
samos du Sud, appelés aussi les Maka. Pour la
préparation de cette émission, je sais déjà pouvoir m’appuyer sur le travail de
chercheurs français et burkinabè. La 6ème de « Regards du Sud »
s’intitulera donc « Les samos du Sud au Burkina Faso ».
Et donc, à très bientôt, avec mon amical et fraternel bonsoir.
lectures...