

![]()
Une superbe expédition africaine « trait d’union »
1ère partie Au BURKINA FASO
39ème émission : diffusion les 1er mardi du mois à 20h30
« Radio Voix du Béarn » 95,10 Mhz, le 7
avril 2009
(Jean-Louis
Giordano et Jacques Mortier 2-23 décembre 2008)
 Bonjour
à toutes et bonjour à tous. Une superbe expédition
africaine « trait d’union », tel est l’intitulé de ma 39ème émission mensuelle de « Regards
du Sud », qui raconte une tournée de trois semaines en décembre dernier,
jalonnée d’une dizaine d’étapes du Mali au Burkina Faso. Précisons que cette
émission, porteuse d’espoir, a la modeste ambition d’ouvrir nos regards aux
dimensions du monde, avec une seule question, depuis plus de 4 ans : Comment
construire tous ensemble un monde plus fraternel ? Précisons aussi que
si cette question ne vous paraît pas totalement stupide, vous pourrez retrouver
textes, sons et images sur mon blog, où il est facile d’entrer avec un moteur
de recherche, en indiquant 3 mots : monde, fraternel et mortier,
comme le mortier, pilonné à longueur de journées par les femmes et les
fillettes africaines, mortier aussi comme le liant, le trait d’union dans la
construction. Mortier, c’est aussi mon nom de famille : 3 mots
donc pour accéder au blog : monde, fraternel et mortier. Dès à présent,
vous y trouverez quelques textes sur notre voyage en duo, en accédant également
à un vaste reportage photos.
Bonjour
à toutes et bonjour à tous. Une superbe expédition
africaine « trait d’union », tel est l’intitulé de ma 39ème émission mensuelle de « Regards
du Sud », qui raconte une tournée de trois semaines en décembre dernier,
jalonnée d’une dizaine d’étapes du Mali au Burkina Faso. Précisons que cette
émission, porteuse d’espoir, a la modeste ambition d’ouvrir nos regards aux
dimensions du monde, avec une seule question, depuis plus de 4 ans : Comment
construire tous ensemble un monde plus fraternel ? Précisons aussi que
si cette question ne vous paraît pas totalement stupide, vous pourrez retrouver
textes, sons et images sur mon blog, où il est facile d’entrer avec un moteur
de recherche, en indiquant 3 mots : monde, fraternel et mortier,
comme le mortier, pilonné à longueur de journées par les femmes et les
fillettes africaines, mortier aussi comme le liant, le trait d’union dans la
construction. Mortier, c’est aussi mon nom de famille : 3 mots
donc pour accéder au blog : monde, fraternel et mortier. Dès à présent,
vous y trouverez quelques textes sur notre voyage en duo, en accédant également
à un vaste reportage photos.
 L’intitulé
de cette émission dit l’essentiel : « Une superbe expédition
africaine trait d’union ». Ce fut une véritable expédition, elle fut
superbe, et, à mes yeux, superbement trait d’union. J’aurai pu
l’appeler de 36 autres façons, qui chacune aurait mis en exergue une des
multiples facettes de ce voyage : par ex. « Une tournée ‘Terre
nourricière et Humanisme’ » ou « Rencontres et retrouvailles »,
ou bien « Valeurs, Méthodes et Responsabilités », ou encore
« Sur les traces de mon frère », …ou tout simplement « Ultime
expédition africaine ». Eh bien, nous allons maintenant cheminer
ensemble au cœur de toutes ces
L’intitulé
de cette émission dit l’essentiel : « Une superbe expédition
africaine trait d’union ». Ce fut une véritable expédition, elle fut
superbe, et, à mes yeux, superbement trait d’union. J’aurai pu
l’appeler de 36 autres façons, qui chacune aurait mis en exergue une des
multiples facettes de ce voyage : par ex. « Une tournée ‘Terre
nourricière et Humanisme’ » ou « Rencontres et retrouvailles »,
ou bien « Valeurs, Méthodes et Responsabilités », ou encore
« Sur les traces de mon frère », …ou tout simplement « Ultime
expédition africaine ». Eh bien, nous allons maintenant cheminer
ensemble au cœur de toutes ces
 facettes.
facettes.
Ainsi donc cette présente émission se veut multiple à la fois partage du voyage, schéma d’intervention, bilan, plaidoyer, mais aussi commentaires du reportage photo évoqué.
Quel fil directeur choisir, pour
vous faire partager, en peu de temps, l’Essentiel ? L’articulation
chronologique en trois phases, m’a paru la plus naturelle : la 1èrephase,
l’avant voyage avec la préparation, les motivations, les perspectives, la 2ème,
le voyage bien sûr, avec le déroulé des étapes successives, le
 programmé
et l’inopiné, et enfin la 3ème, l’après-voyage avec les
enseignements tirés, les suites, les multiples interventions prévisibles, etc…
programmé
et l’inopiné, et enfin la 3ème, l’après-voyage avec les
enseignements tirés, les suites, les multiples interventions prévisibles, etc…
Que de choses à dire ! Aussi il me paraît plus raisonnable de dédoubler l’émission. Ce mois-ci, pour la 39ème, je vous propose donc d’effectuer ensemble la partie malienne de notre voyage, en nous réservant la partie burkinabè pour la 40ème émission. Plusieurs mois se sont écoulées depuis la précédente émission, ce qui s’explique essentiellement par deux bonnes raisons, d’une part une préparation énorme de ce voyage, d’autre part une priorité, bien naturelle, donnée à la famille, avec notamment beaucoup de bonheur dans « l’art d’être grand-père » et aussi dans « l’art d’être gendre ».
I-L’AVANT VOYAGE
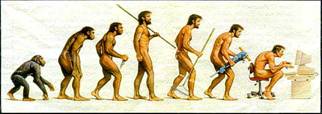 Arrêtons
nos batifolages et entrons donc maintenant dans la phase primordiale de
« l’Avant voyage » : Pourquoi ce voyage ? On dit
souvent « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », eh
bien, à 64 ans je suis, me semble-t-il, à la charnière d’un temps où les
deux sont encore présents ensemble : le savoir et le pouvoir, alliés à un
troisième mousquetaire déterminant : le vouloir. Pourquoi ce voyage ?
On pourrait aussi s’appuyer sur la coutume africaine qui récapitule souvent
la vie en 4 cycles : l’initiation, l’action, la transmission et la
sagesse. Dans cet esprit, ce voyage se veut aussi, pour moi, un rite de
changement d’état, changement de cycle entre le temps de l’action et celui de
la transmission.
Arrêtons
nos batifolages et entrons donc maintenant dans la phase primordiale de
« l’Avant voyage » : Pourquoi ce voyage ? On dit
souvent « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », eh
bien, à 64 ans je suis, me semble-t-il, à la charnière d’un temps où les
deux sont encore présents ensemble : le savoir et le pouvoir, alliés à un
troisième mousquetaire déterminant : le vouloir. Pourquoi ce voyage ?
On pourrait aussi s’appuyer sur la coutume africaine qui récapitule souvent
la vie en 4 cycles : l’initiation, l’action, la transmission et la
sagesse. Dans cet esprit, ce voyage se veut aussi, pour moi, un rite de
changement d’état, changement de cycle entre le temps de l’action et celui de
la transmission.
Pourquoi ce voyage ? Eh bien, de façon plus concrète, je vais reprendre brièvement, en vrac et en cascade, quelques extraits de mes écrits préparatoires adressés aux amis d’ici et de là-bas. Je disais donc :

-à l’été 1967, jeune étudiant, j’avais organisé une première expédition, de deux mois, avec mon grand copain d’école, mon frère jumeau « adoptif », Jean-Louis Giordano, dit Gigi, à travers le Canada, les USA et le Mexique, où un stage au fond d’une mine de charbon nous attendait ; cette année 2008, 41 ans après, j’embarque à nouveau avec Gigi, pour une aventure humaine, en duo, de trois semaines en Afrique noire, qui sera sans aucun doute, le dernier long voyage africain organisé par mes soins,
-nous sommes donc deux anciens, deux grands-pères, en voyage personnel, d’abord à l’écoute fraternelle des africains, mais aussi en étant porteurs, l’un et l’autre, de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu, de nos projets, de nos engagements passés, engagements présents, en responsabilité bénévole tous les deux à l’association « Terre et Humanisme » de Pierre Rabhi, à priori ouverts et disponibles pour des échanges et des interventions possibles sur des sujets multiples. Peut-être faut-il préciser que nous sommes tous les deux ingénieurs (retraités). Gigi, est également titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées sur les problèmes de complexité, il enseigne encore sur ces questions à notre Ecole Centrale de Paris (conduite de projets, prise en compte de la dimension culturelle…). Quant à moi, Jacques Mortier, «professionnel du bénévolat » depuis plus de 40 ans, j’ai aussi eu la chance de bénéficier d’une double formation, avec un cycle à Sciences Politiques de Paris, en 1967, sur les « Pays en Voie de Développement »,
-c’est donc un voyage « trait d’union », à multiples motivations : découverte de l’Afrique noire pour Gigi, retrouvailles et pèlerinage pour moi avec ce 10ème voyage sur le continent africain, amitiés, échanges, partage, suivi ou accompagnement de projets, voyage-immersion, voyage-rencontres en particulier avec des jeunes…dans le même esprit que les précédents décrits sur mon blog,
-je faisais aussi des propositions : nous serons à disposition pour échanger, partager avec enseignants, collégiens, ou villageois,... Compte tenu de nos « âges » d’adultes bien mûrs…, nous devrions pouvoir nous adapter sans trop de mal, si nécessaire, aussi bien au niveau des sujets laïcs ou non, que des modes d’échanges : débats, interpellations, interventions,…
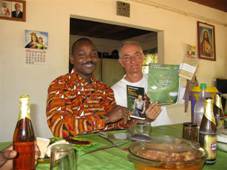 -j’écrivais aussi qu’au cours de l’intense
préparation : la composante « crises alimentaires » a
pris, de plus en plus d’importance et sera, sans aucun doute, le fil directeur
de notre voyage.
-j’écrivais aussi qu’au cours de l’intense
préparation : la composante « crises alimentaires » a
pris, de plus en plus d’importance et sera, sans aucun doute, le fil directeur
de notre voyage.
C’est dans cette perspective, que j’ai préparé une douzaine de kit-cadeaux, intégrant le dernier ouvrage de Pierre Rabhi, intitulé « Manifeste pour la Terre et l’Humanisme » aux éditions «Actes Sud ». Merci donc à l’entreprise « Nature et Découvertes » qui a appuyé l’édition de cet ouvrage et m’a approvisionné gracieusement, merci à « Kokopelli », remarquable conservatoire de semences qui a fait de même pour des graines de semences, des semences de vie.
-j’écrivais encore : ...convaincu de la puissance des
« réseaux » fondés sur des relations de confiance entre personnes en
responsabilité, donc porteuses potentielles de démultiplication, j‘ai choisi de
jouer à l’homme-orchestre et de porter lors
de ce voyage de nombreuses casquettes, celle de « Terre et
Humanisme », d’Eau Vive, de Kokopelli, de chrétien engagé, de citoyen du
monde, d’astronome passionné
 des « cieux », d’animateur de radio
humaniste, et encore d’autres. J’ai choisi de m’appuyer sur quatre
« entités amies », actives ici et en Afrique, qui partagent
toutes, me semble-t-il, les mêmes valeurs essentielles avec un engagement
très fort au service des Paysans et des populations : les associations Terre
et Humanisme et Eau Vive, la communauté Emmaüs de l’abbé
Pierre, communauté Lescar Pau en relation avec l’AIDMR (Association Interzones
de Développement Rural) au Burkina Faso et 4ème entité, l’Eglise,
précisons bien l’Eglise de Vatican II, celle qui est généreuse, ouverte sur le
monde et non intégriste bien sûr, avec ses multiples composantes, fidèles aux
valeurs évangéliques (CCFD, CARITAS, OCADES, Paroisses, Séminaires,
Missionnaires d’Afrique,…), en particulier avec le Père blanc Maurice Oudet,
depuis 40 ans au Burkina Faso, grand défenseur des paysans du Sud, et qui
illustre à merveille que l’Eglise en Afrique est, comme beaucoup le pensent, la
première ONG du continent,
des « cieux », d’animateur de radio
humaniste, et encore d’autres. J’ai choisi de m’appuyer sur quatre
« entités amies », actives ici et en Afrique, qui partagent
toutes, me semble-t-il, les mêmes valeurs essentielles avec un engagement
très fort au service des Paysans et des populations : les associations Terre
et Humanisme et Eau Vive, la communauté Emmaüs de l’abbé
Pierre, communauté Lescar Pau en relation avec l’AIDMR (Association Interzones
de Développement Rural) au Burkina Faso et 4ème entité, l’Eglise,
précisons bien l’Eglise de Vatican II, celle qui est généreuse, ouverte sur le
monde et non intégriste bien sûr, avec ses multiples composantes, fidèles aux
valeurs évangéliques (CCFD, CARITAS, OCADES, Paroisses, Séminaires,
Missionnaires d’Afrique,…), en particulier avec le Père blanc Maurice Oudet,
depuis 40 ans au Burkina Faso, grand défenseur des paysans du Sud, et qui
illustre à merveille que l’Eglise en Afrique est, comme beaucoup le pensent, la
première ONG du continent,
-et je voulais, au cours de ce
voyage, valider une idée, qui me paraît essentielle, et que j’ai souvent
exprimée ainsi, lors de débats, interpellations, plaidoyers, ou autres : pour
avancer au plus vite vers ce nouveau monde espéré, où le « manger propre et le boire potable » serait un impératif éthique prioritaire, ma conviction s’exprime par le
proverbe africain : « Si les bouches des fourmis s’unissaient, elles
transporteraient un
 éléphant ». Chacun d’entre nous, avec ses qualités et ses faiblesses, suit son
cheminement de vie, apporte plus ou moins, sa « petite goutte d’eau » à cette avancée. Et, il est urgent que
éléphant ». Chacun d’entre nous, avec ses qualités et ses faiblesses, suit son
cheminement de vie, apporte plus ou moins, sa « petite goutte d’eau » à cette avancée. Et, il est urgent que
 toutes les précieuses « petites gouttes d’eau »
dans le monde, émanant d’admirables consciences individuelles disséminées un
peu partout, tous les « petits ou grands ruisseaux », provenant
d’associations, de collectifs d’associations, ou de collectifs humains de
toutes natures, il est urgentissime que toutes ces gouttes d’eau, tous ces
ruisseaux, tous ces innombrables réseaux, qui n’ont individuellement hélas
aucun poids « Politique » significatif, collaborent intelligemment et
s’unissent sur l’Essentiel pour déboucher sur un magnifique fleuve d’Humanité.
Quand j’évoque le poids Politique, il s’agit bien sûr de Politique avec un
grand P, et c’est relatif au Vivre Ensemble.
toutes les précieuses « petites gouttes d’eau »
dans le monde, émanant d’admirables consciences individuelles disséminées un
peu partout, tous les « petits ou grands ruisseaux », provenant
d’associations, de collectifs d’associations, ou de collectifs humains de
toutes natures, il est urgentissime que toutes ces gouttes d’eau, tous ces
ruisseaux, tous ces innombrables réseaux, qui n’ont individuellement hélas
aucun poids « Politique » significatif, collaborent intelligemment et
s’unissent sur l’Essentiel pour déboucher sur un magnifique fleuve d’Humanité.
Quand j’évoque le poids Politique, il s’agit bien sûr de Politique avec un
grand P, et c’est relatif au Vivre Ensemble.
Voilà, j’imagine qu’à travers ces divers extraits choisis, vous avez
maintenant une idée de l’esprit de ce voyage en ce qui me concerne, de
l’importance attachée à cette préparation « en réseau » et aussi déjà
de la tonalité de la prochaine émission. Quant à l’ami Gigi, une émission
ultérieure devrait peut-être raconter, avec ses mots et son propre regard, sa
préparation, son apprentissage et sa découverte de l’Afrique noire.
Il est temps d’entrer dans la deuxième phase : le déroulement du
voyage.
![]()
Avant de décoller, je vous propose une 1ère pause musicale…
II-VOYAGE (images http://picasaweb.google.fr/jacques.mortier/ExpedAfrik2008)
Profitons maintenant de notre vol vers le Mali pour
évoquer quelques traits caractéristiques de ce voyage. La première image du
diaporama évoqué, accessible par mon blog, est une carte qui résume cette tournée africaine de trois
semaines, en une dizaine d’étapes à travers le Mali et le Burkina Faso, étapes
à la fois chez des amis, pour la plupart
 venus en France, et également
« chez les amis des amis ». Il apparaît qu’en fait, le gîte et le
couvert ont été essentiellement assurés au coeur de communautés chrétiennes,
qui font toutes de l’agriculture vivrière, d’une part pour assurer, au moins
partiellement, leur nourriture, d’autre part pour réduire leurs dépenses et
ainsi mieux équilibrer leurs budgets. Pour le transport, nous avons été
globalement fidèles aux transports publics de base, y compris les minibus et
taxis collectifs rustiques, qui partent sur les pistes quand c’est plein.
venus en France, et également
« chez les amis des amis ». Il apparaît qu’en fait, le gîte et le
couvert ont été essentiellement assurés au coeur de communautés chrétiennes,
qui font toutes de l’agriculture vivrière, d’une part pour assurer, au moins
partiellement, leur nourriture, d’autre part pour réduire leurs dépenses et
ainsi mieux équilibrer leurs budgets. Pour le transport, nous avons été
globalement fidèles aux transports publics de base, y compris les minibus et
taxis collectifs rustiques, qui partent sur les pistes quand c’est plein.
MALI
1-Bamako (étape
de 2 jours/3 nuits) :
Avant
d’atterrir à la capitale Bamako, le Niger apparaît comme un long serpent. Son joli nom en
bambara est « djoliba » et signifie « fleuve rouge, fleuve
sang », et aussi « fleuve abondant qui nourrit ». En vues aériennes, la silhouette impressionnante de la
Banque des Etats d’Afrique de l’Ouest indique le
 centre de la ville. L’accueil à Bamako fut contrasté, rude
à l’aéroport avec un 36°C sur le tarmac, mais accueil surtout remarquable, avec
de très riches échanges, au sein de la communauté des Frères du Sacré Cœur,
au quartier Bako Djikoroni, sur la rive droite et tout près du fleuve. Cette
congrégation, que j’ai bien connue au Burkina Faso, a vocation éducative, en
particulier pour offrir une 2ème chance, et regroupe à Bamako une
dizaine de Frères, enseignants, proviseur de lycée, principal de collège. Elle
abrite également son provincial Donat Dena, responsable de la congrégation pour toute l’Afrique de
l’Ouest.
centre de la ville. L’accueil à Bamako fut contrasté, rude
à l’aéroport avec un 36°C sur le tarmac, mais accueil surtout remarquable, avec
de très riches échanges, au sein de la communauté des Frères du Sacré Cœur,
au quartier Bako Djikoroni, sur la rive droite et tout près du fleuve. Cette
congrégation, que j’ai bien connue au Burkina Faso, a vocation éducative, en
particulier pour offrir une 2ème chance, et regroupe à Bamako une
dizaine de Frères, enseignants, proviseur de lycée, principal de collège. Elle
abrite également son provincial Donat Dena, responsable de la congrégation pour toute l’Afrique de
l’Ouest.
 Dès la 1ère journée à Bamako, il a été possible
d’initier un mini réseau en organisant une belle rencontre préméditée, avec Alain Ky Zerbo, responsable d’Eau Vive pour le Mali, Oumar
Diabaté, vétérinaire et maraîcher bio, de « Terre et Humanisme »
Mali, qui venait le jour même d’inaugurer la 1ère AMAP du Mali, et
peut-être aussi d’Afrique de l’Ouest, et bien sûr la communauté des
Dès la 1ère journée à Bamako, il a été possible
d’initier un mini réseau en organisant une belle rencontre préméditée, avec Alain Ky Zerbo, responsable d’Eau Vive pour le Mali, Oumar
Diabaté, vétérinaire et maraîcher bio, de « Terre et Humanisme »
Mali, qui venait le jour même d’inaugurer la 1ère AMAP du Mali, et
peut-être aussi d’Afrique de l’Ouest, et bien sûr la communauté des
 Frères du Sacré Cœur avec René Sagara, proviseur de lycée et
responsable de la communauté de Bamako. La
question alimentaire étant un objectif très important de ce voyage, de
nombreuses images « agricoles » rythment le diaporama avec des
planches de culture alimentaire et la remise d’une douzaine de kits-cadeaux
évoqués (ouvrage, revues et graines de semences de vie, associant donc
l’éthique, les méthodes agro écologiques et le concret des semences de vie).
Par ailleurs une soirée réunissant toute la communauté a été animée par mes
soins, avec une initiation astronomique grâce à de belles images, initiation
« aux merveilles du cosmos » et à la « création du monde »,
c’est-à-dire à l’environnement de notre planète et de notre humanité.
Frères du Sacré Cœur avec René Sagara, proviseur de lycée et
responsable de la communauté de Bamako. La
question alimentaire étant un objectif très important de ce voyage, de
nombreuses images « agricoles » rythment le diaporama avec des
planches de culture alimentaire et la remise d’une douzaine de kits-cadeaux
évoqués (ouvrage, revues et graines de semences de vie, associant donc
l’éthique, les méthodes agro écologiques et le concret des semences de vie).
Par ailleurs une soirée réunissant toute la communauté a été animée par mes
soins, avec une initiation astronomique grâce à de belles images, initiation
« aux merveilles du cosmos » et à la « création du monde »,
c’est-à-dire à l’environnement de notre planète et de notre humanité.
Ensuite
départ de Bamako en bus pour Ségou, avec une attente toujours incertaine à la
gare routière.
 2-Ségou (une étape de 1,5 j/2 n) : une étape essentielle pour
moi, espérée depuis longtemps « sur les traces de mon frère »,
puisque André, « Dédé », mon aîné de 14 mois, mon presque jumeau, a été
enseignant-coopérant, à la Mission catholique de Ségou durant deux années
scolaires, de septembre 1966 à juin 1968, il y a plus de 40 ans. Et, quelques
années plus tard, hélas, en 1974, à 30 ans, il se tuait en deltaplane, en étant
une des toutes premières victimes de cet
2-Ségou (une étape de 1,5 j/2 n) : une étape essentielle pour
moi, espérée depuis longtemps « sur les traces de mon frère »,
puisque André, « Dédé », mon aîné de 14 mois, mon presque jumeau, a été
enseignant-coopérant, à la Mission catholique de Ségou durant deux années
scolaires, de septembre 1966 à juin 1968, il y a plus de 40 ans. Et, quelques
années plus tard, hélas, en 1974, à 30 ans, il se tuait en deltaplane, en étant
une des toutes premières victimes de cet
 engin volant, il y a donc 35 ans. Cette étape se voulait
« communion fraternelle » en m’immergeant dans un environnement qu’il
avait fréquenté et beaucoup aimé et en essayant de retrouver des personnes qui
l’avaient connu. Je disposais du courrier que nous échangions ainsi que de
photos de lui à cette époque. Nous logions au Centre AB Gabriel Cissé, là où
était jadis la Mission, à proximité de la Cathédrale. Nous
engin volant, il y a donc 35 ans. Cette étape se voulait
« communion fraternelle » en m’immergeant dans un environnement qu’il
avait fréquenté et beaucoup aimé et en essayant de retrouver des personnes qui
l’avaient connu. Je disposais du courrier que nous échangions ainsi que de
photos de lui à cette époque. Nous logions au Centre AB Gabriel Cissé, là où
était jadis la Mission, à proximité de la Cathédrale. Nous
 avons beaucoup flâné dans Ségou, au bord du Niger, nous
avons aussi capté de magnifiques visages souriants dans les ruelles, nous avons
traversé le fleuve, le djoliba en pinasse avec notre pilote Fah, pour aller à
la rencontre des potières du village de
Kalabougou. C’est là que l’ami Gigi a
mangé son premier tô, rustique à souhait. C’est le repas de base, une pâte
composée de farine de mil, la seule variable étant la sauce gluante qui lui
donne goût : oseille, feuille de baobab ou autre. Il faut maintenant en
venir à l’Essentiel, j’ai eu la chance
de retrouver 5/6 personnes qui avaient connu mon frère et ce furent des
rencontres bouleversantes, surtout pour moi. Apprenant par ma voix, le décès de
mon frère Dédé, j’ai reçu d’émouvantes condoléances, comme si cela venait juste
d’arriver et je me suis retrouvé
avons beaucoup flâné dans Ségou, au bord du Niger, nous
avons aussi capté de magnifiques visages souriants dans les ruelles, nous avons
traversé le fleuve, le djoliba en pinasse avec notre pilote Fah, pour aller à
la rencontre des potières du village de
Kalabougou. C’est là que l’ami Gigi a
mangé son premier tô, rustique à souhait. C’est le repas de base, une pâte
composée de farine de mil, la seule variable étant la sauce gluante qui lui
donne goût : oseille, feuille de baobab ou autre. Il faut maintenant en
venir à l’Essentiel, j’ai eu la chance
de retrouver 5/6 personnes qui avaient connu mon frère et ce furent des
rencontres bouleversantes, surtout pour moi. Apprenant par ma voix, le décès de
mon frère Dédé, j’ai reçu d’émouvantes condoléances, comme si cela venait juste
d’arriver et je me suis retrouvé
 dans le même état d’esprit qu’il y a 35 ans. Un ancien
élève, disant et répétant à plusieurs reprises : quel dommage, quel
dommage …Rudes et magnifiques moments, où je n’ai pu retenir
dans le même état d’esprit qu’il y a 35 ans. Un ancien
élève, disant et répétant à plusieurs reprises : quel dommage, quel
dommage …Rudes et magnifiques moments, où je n’ai pu retenir
 mes larmes. Merci pour ces partages de vie, à Jacqueline, Colette, Léopold, Firmin
au téléphone, et puis Alain plus tard à San, et aussi Théophile que j’ai visité
au retour en France. Merci pour vos sympathiques témoignages, merci aussi à
tous ceux qui se sont associés à cette quête fraternelle : Josepha,
Cyprien, Evariste,… J’étais persuadé que l’école, où mon frère avait enseigné,
avait été détruite au moment de la construction du centre Gabriel Cissé où nous
étions hébergés, et, la veille du départ de Ségou, j’ai appris qu’elle était
toujours debout, tout à côté du stade, et j’ai donc pu, à 6h du matin, aller
photographier ces salles de classe. Le gardien de nuit m’a, très gentiment, ouvert les salles
qui n’avaient pas fondamentalement changé ces dernières dizaines d’années. Là
aussi, cette visite, dans la paix du
mes larmes. Merci pour ces partages de vie, à Jacqueline, Colette, Léopold, Firmin
au téléphone, et puis Alain plus tard à San, et aussi Théophile que j’ai visité
au retour en France. Merci pour vos sympathiques témoignages, merci aussi à
tous ceux qui se sont associés à cette quête fraternelle : Josepha,
Cyprien, Evariste,… J’étais persuadé que l’école, où mon frère avait enseigné,
avait été détruite au moment de la construction du centre Gabriel Cissé où nous
étions hébergés, et, la veille du départ de Ségou, j’ai appris qu’elle était
toujours debout, tout à côté du stade, et j’ai donc pu, à 6h du matin, aller
photographier ces salles de classe. Le gardien de nuit m’a, très gentiment, ouvert les salles
qui n’avaient pas fondamentalement changé ces dernières dizaines d’années. Là
aussi, cette visite, dans la paix du
 petit matin, fut bouleversante, comme jamais je n’aurais pu
petit matin, fut bouleversante, comme jamais je n’aurais pu
 l’imaginer. Et, en quittant l’école, sur le stade voisin,
une fillette portant un plat de poissons sur la tête, m’offrit un lumineux
sourire esquissé. Après cette extraordinaire étape, qui, à elle seule, aurait
justifié à mes yeux, un tel voyage, nous rejoignons ensuite, en ce dimanche
matin, une des gares routières de Ségou pour poursuivre vers Dobwo et l’ami
Emmanuel, avec une étape surprise à San. Nous utilisons les transports publics
réguliers avec un horaire prévu, et un spectacle toujours renouvelé, dont je ne
me lasse jamais : défilé des paysages de brousse, villages animés,
mosquées … avec les petits commerces de survie à chaque arrêt.
l’imaginer. Et, en quittant l’école, sur le stade voisin,
une fillette portant un plat de poissons sur la tête, m’offrit un lumineux
sourire esquissé. Après cette extraordinaire étape, qui, à elle seule, aurait
justifié à mes yeux, un tel voyage, nous rejoignons ensuite, en ce dimanche
matin, une des gares routières de Ségou pour poursuivre vers Dobwo et l’ami
Emmanuel, avec une étape surprise à San. Nous utilisons les transports publics
réguliers avec un horaire prévu, et un spectacle toujours renouvelé, dont je ne
me lasse jamais : défilé des paysages de brousse, villages animés,
mosquées … avec les petits commerces de survie à chaque arrêt.
 2bis-San (1/2 j) : sur la route de Dobwo, une escale
supplémentaire a été programmée à la
2bis-San (1/2 j) : sur la route de Dobwo, une escale
supplémentaire a été programmée à la
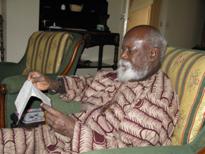 ville de San, car l’ordination d’un prêtre, le 135ème prêtre malien, Matthias Dabou, donne lieu à une grande fête et un immense repas
collectif rassemblant une partie importante de l’Eglise famille du Mali, dans
ce pays majoritairement musulman. Mon frère avait, quant à lui, assisté le 9
mars 1968, à l’ordination du 14ème prêtre malien, à Kolongo, Théophile Diallo,
et m’avait longuement décrit cette belle journée. Le bus nous emmènera de Dobwo
à San, juste à l’heure du repas. Trois des six évêques du Mali sont présents à
San, notamment l’évêque dogon de Mopti que nous verrons à nouveau longuement
plus tard. Et ce fut une occasion exceptionnelle d’échanger avec des jeunes,
des clercs, des laïcs, des autorités, de retrouver l’ami Emmanuel, qui nous
acheminera jusqu’à notre prochaine étape Dobwo, son champ d’action actuel.
ville de San, car l’ordination d’un prêtre, le 135ème prêtre malien, Matthias Dabou, donne lieu à une grande fête et un immense repas
collectif rassemblant une partie importante de l’Eglise famille du Mali, dans
ce pays majoritairement musulman. Mon frère avait, quant à lui, assisté le 9
mars 1968, à l’ordination du 14ème prêtre malien, à Kolongo, Théophile Diallo,
et m’avait longuement décrit cette belle journée. Le bus nous emmènera de Dobwo
à San, juste à l’heure du repas. Trois des six évêques du Mali sont présents à
San, notamment l’évêque dogon de Mopti que nous verrons à nouveau longuement
plus tard. Et ce fut une occasion exceptionnelle d’échanger avec des jeunes,
des clercs, des laïcs, des autorités, de retrouver l’ami Emmanuel, qui nous
acheminera jusqu’à notre prochaine étape Dobwo, son champ d’action actuel.
 3-Dobwo (1 j/2 n) : Pourquoi cette étape de Dobwo ?
D’abord pour sacrifier à l‘amitié, puisque j’ai connu le Frère malien Emmanuel
Dakouo des Frères du Sacré Coeur, qui avait la responsabilité du CAF de Toma au
3-Dobwo (1 j/2 n) : Pourquoi cette étape de Dobwo ?
D’abord pour sacrifier à l‘amitié, puisque j’ai connu le Frère malien Emmanuel
Dakouo des Frères du Sacré Coeur, qui avait la responsabilité du CAF de Toma au
 Burkina, avant de prendre celle du CAF de Dobwo au Mali.
Emmanuel est venu nous rendre visite dans les Pyrénées avec Laurent Mouchague,
que j’ai eu la joie de mettre en relation avec lui. D’ailleurs la 37ème émission évoquait cette belle histoire au Mali et au Burkina Faso. J’avais donc
vu des images de Dobwo, mais je n’imaginais pas du tout que c’était aussi
important que cela, puisqu’en fait, il y a à la fois le CAF avec 187
collégiennes et collégiens, une école de catéchistes, où sont formés durant
quatre années à temps plein, une dizaine de couples qui seront ensuite envoyés
en mission dans les villages. Il y a également un juvénat pour préparer une
trentaine de jeunes collégiennes à la vie religieuse, et de même un juvénat
pour les garçons. Les terrains et installations représentent, je crois une
quarantaine d’hectares, dont pas mal en cultures (maraîchages et arbres
fruitiers donnant mangues, pamplemousses, oranges, citrons, bananes, dattes).
Les images montrent clairement
Burkina, avant de prendre celle du CAF de Dobwo au Mali.
Emmanuel est venu nous rendre visite dans les Pyrénées avec Laurent Mouchague,
que j’ai eu la joie de mettre en relation avec lui. D’ailleurs la 37ème émission évoquait cette belle histoire au Mali et au Burkina Faso. J’avais donc
vu des images de Dobwo, mais je n’imaginais pas du tout que c’était aussi
important que cela, puisqu’en fait, il y a à la fois le CAF avec 187
collégiennes et collégiens, une école de catéchistes, où sont formés durant
quatre années à temps plein, une dizaine de couples qui seront ensuite envoyés
en mission dans les villages. Il y a également un juvénat pour préparer une
trentaine de jeunes collégiennes à la vie religieuse, et de même un juvénat
pour les garçons. Les terrains et installations représentent, je crois une
quarantaine d’hectares, dont pas mal en cultures (maraîchages et arbres
fruitiers donnant mangues, pamplemousses, oranges, citrons, bananes, dattes).
Les images montrent clairement
 que, comme je l’ai déjà exprimé, l’agriculture a une place
très importante dans chaque structure éducative.
que, comme je l’ai déjà exprimé, l’agriculture a une place
très importante dans chaque structure éducative.
Dès
l’arrivée ce qui distingue Dobwo d’autres lieux, c’est qu’il y a profusion de chevaux au
lieu des ânes habituels, qui tirent des carrioles tous usages qui sont souvent
joliment décorées. Dobwo est un village qui fait partie de la commune de Bénana
et de la paroisse de Mandiakuy, village natal d’Emmanuel. Parmi toutes nos
étapes avec hébergement, c’est la seule où il n’y a ni réseau électrique, ni
réseau téléphonique, ni internet bien sûr, par contre à certains endroits très
précis, le téléphone portable de certains fournisseurs
 fonctionne. Quant à l’eau, il y a forages et châteaux
d’eau, et dispositif classique de filtrage d’eau pour les besoins de
consommation. Personnellement, je n’ai presque pas fait attention à ces
absences de réseaux de base, à cette frugale économie de moyens, dans la
mesure, où j’ai trouvé, lors de ce voyage, qu’il y avait comme l’illustrent
certaines images, beaucoup plus qu’avant des blocs
« panneaux photovoltaïques accouplées à batteries en charge » et la
fonctionne. Quant à l’eau, il y a forages et châteaux
d’eau, et dispositif classique de filtrage d’eau pour les besoins de
consommation. Personnellement, je n’ai presque pas fait attention à ces
absences de réseaux de base, à cette frugale économie de moyens, dans la
mesure, où j’ai trouvé, lors de ce voyage, qu’il y avait comme l’illustrent
certaines images, beaucoup plus qu’avant des blocs
« panneaux photovoltaïques accouplées à batteries en charge » et la
 suite logique « batteries
en décharge dans tubes néon », pour
les usages nocturnes (par ex. devoirs du soir, repas,..). Il y a également des
antennes paraboliques pour recevoir la télévision.
suite logique « batteries
en décharge dans tubes néon », pour
les usages nocturnes (par ex. devoirs du soir, repas,..). Il y a également des
antennes paraboliques pour recevoir la télévision.
Le
lundi 8 décembre ici, c’est la tabaski, la grande fête musulmane du
« mouton », commémorant le sacrifice d’Abraham. En fait tout le
monde, musulmans, chrétiens, participent à la fête commune, sauf les pauvres
moutons sacrifiés en la circonstance. Emmanuel nous emmène donc dans son
village à Mandiakuy chez sa famille, voir sa
maman, très vive pour son nombre
conséquent de printemps. C’est toujours émouvant de voir des intellectuels de
haute pointure et de grande humanité, comme Emmanuel, nous présenter leur papa
et/ou leur maman, qui, le plus souvent, ne sont pas allés à l’école et ne
parlent pas le français. Nous visitons l’église
de Mandiakuy qui est l’une des plus
grandes du Mali, pouvant contenir plus de 2000 personnes, avec deux tours de 50
m de haut en banco, et qui a 50 ans d’âge. C’est le Père blanc Verspieren, qui
l’a bâti jadis, ce Père, expert en agronomie, est aussi connu pour avoir, il y
a des dizaines d’années, créé, dans sa lutte contre la sécheresse, un village
entier d’avant-garde, Teriya Bugu, situé entre Bla et San, un village avec
école, dispensaire, pépinières, le tout fonctionnant grâce aux énergies
renouvelables. L’aventure continue actuellement avec un centre de tourisme
solidaire et de développement rural. Nous apprécions aussi à Mandiakuy de
visiter les amis d’Emmanuel dans cette ambiance de fête fériée.
 A Dobwo, trois Frères forment la communauté des FSC
Raphaël, Eric et Emmanuel. Trois Sœurs sont en charge du juvénat des jeunes
filles, avec la responsable Sœur Augustine, également professeur de
A Dobwo, trois Frères forment la communauté des FSC
Raphaël, Eric et Emmanuel. Trois Sœurs sont en charge du juvénat des jeunes
filles, avec la responsable Sœur Augustine, également professeur de
 français au CAF. Et, il y a aussi chapelles et église, avec
de belles célébrations communautaires, qui m’étaient assez familières, et j’ai
admiré la patience de Gigi, nettement moins habitué, mais qui en a également
largement bénéficié…
français au CAF. Et, il y a aussi chapelles et église, avec
de belles célébrations communautaires, qui m’étaient assez familières, et j’ai
admiré la patience de Gigi, nettement moins habitué, mais qui en a également
largement bénéficié…
Quelques
points forts à Dobwo : une lettre plaidoyer touchante du cuisinier
Boniface, sollicitant une aide pour un orphelin qu’il élève avec ses
enfants ; une belle soirée à la communauté avec connaissance réciproque, où nos
familles étaient présentes, où Gigi a parlé de son milieu marseillais très
modeste, et même pauvre, d’Armande et de Marius, ses parents, que j’ai bien
connus et qui sont partis il y a déjà longtemps. Mon poème sur la
« Fraternité », exprimé dans une précédente émission, était, à mes
yeux, à l’unisson des sentiments ressentis dans cette lumineuse soirée de
bonheur partagé, sur le même petit nuage. Le lendemain, reprise des cours pour
tous après la fête, avec la traditionnelle
montée du drapeau et l’hymne national.
Ensuite, Emmanuel nous a invités à nous adresser l’un après l’autre, à tous les
élèves et professeurs rassemblés : chacun, à sa façon, s’est présenté et
a, me semble-t-il, su trouver les mots d’encouragement, de fraternité et d’humanité.
Et puis, Emmanuel nous a conduit sur la route de Mopti, où, exceptionnellement
sans aucune attente, nous avons immédiatement pris le bus public vers Mopti,
Sévaré sa banlieue et le pays dogon.
![]()
Le pays dogon se mérite, aussi pour y entrer en musique je vous propose une nouvelle pause musicale…

4-Pays dogon (2,5 j/3 n ) : Pourquoi cette étape ? Tout
simplement pour découvrir en direct cette fameuse culture dogon, qui a séduit
dès son premier séjour en 1931, l’ethnologue Marcel Griaule, lequel l’a
restitué en 1948, à sa façon, dans un ouvrage fondateur « Dieu
d’eau ». Il s’agit d’un livre charnière dans l’ethnologie contemporaine,
qui, et je cite, « redresse le regard de l’Européen, l’amène à voir
l’autre, l’indigène, le primitif, comme le dépositaire d’une culture cohérente,
en tous points comparable à celle du monde, dit développé… En fait il annonce
et montre que l’esprit souffle dans toutes les têtes. Une leçon d’humilité qui
n’a pas d’âge ». J’ai beaucoup lu, vu de nombreux reportages et diverses
videos sur cette culture dogon. La falaise de Bandiagara, Sangha, sont
longtemps restés pour moi des mots magiques et nous sommes dans le car qui nous
emmène vers ce pays dogon.
 C’est l’ami burkinabè André Ouedraogo et son réseau « d’amis
des amis », qui nous a mis en relation avec Jean Somboro, le vicaire
général du diocèse malien de Mopti. Mais, suite à quelques difficultés
téléphoniques, nous chercherons longuement en taxi l’évêché de Mopti, méconnu
de tous, nous semble-t-il, avant d’y être très bien accueilli par l’évêque
dogon Georges Fonghoro, que nous avions déjà salué à San. Nous avons alors
appris qu’il aurait suffi de demander « le chef des chrétiens » pour
que tout le monde nous indique immédiatement le lieu recherché. Nous échangeons
sur notre voyage et rapidement, nous découvrons que nous avions un grand ami
commun, récemment décédé, Mgr François Saint Macary, archevêque de Rennes, qui
nous avait mariés et que l’évêque dogon avait sympathiquement visité toute une
semaine en Bretagne, l’Ille et Vilaine et Mopti étant jumelés. Par hasard à
nouveau, dans la
C’est l’ami burkinabè André Ouedraogo et son réseau « d’amis
des amis », qui nous a mis en relation avec Jean Somboro, le vicaire
général du diocèse malien de Mopti. Mais, suite à quelques difficultés
téléphoniques, nous chercherons longuement en taxi l’évêché de Mopti, méconnu
de tous, nous semble-t-il, avant d’y être très bien accueilli par l’évêque
dogon Georges Fonghoro, que nous avions déjà salué à San. Nous avons alors
appris qu’il aurait suffi de demander « le chef des chrétiens » pour
que tout le monde nous indique immédiatement le lieu recherché. Nous échangeons
sur notre voyage et rapidement, nous découvrons que nous avions un grand ami
commun, récemment décédé, Mgr François Saint Macary, archevêque de Rennes, qui
nous avait mariés et que l’évêque dogon avait sympathiquement visité toute une
semaine en Bretagne, l’Ille et Vilaine et Mopti étant jumelés. Par hasard à
nouveau, dans la
 multitude de photos que j’emporte toujours, j’ai une photo
de notre ami, que je lui offre ainsi que l’ouvrage « Manifeste pour la
Terre et l’Humanisme » de Pierre Rabhi. Il a semble-t-il apprécié ces
gestes. Le monde est vraiment petit. Que de hasards en pays dogon et ailleurs
au cours de ce voyage. Einstein disait que le hasard, c’est « quand Dieu
vient incognito sur terre », les chrétiens parlent aussi de « signes
des temps ». Ensuite, nous allons nous installer pour quelques jours à la
mission de Sévaré,
multitude de photos que j’emporte toujours, j’ai une photo
de notre ami, que je lui offre ainsi que l’ouvrage « Manifeste pour la
Terre et l’Humanisme » de Pierre Rabhi. Il a semble-t-il apprécié ces
gestes. Le monde est vraiment petit. Que de hasards en pays dogon et ailleurs
au cours de ce voyage. Einstein disait que le hasard, c’est « quand Dieu
vient incognito sur terre », les chrétiens parlent aussi de « signes
des temps ». Ensuite, nous allons nous installer pour quelques jours à la
mission de Sévaré,
 notre camp de base, à proximité immédiate de Mopti. Mopti, qui est quasiment une presqu’île, entourée d’eau. Mopti la « Venise
malienne » au confluent du Bani et du
Niger, appelée aussi la « ville du Poisson ». La communauté qui nous
accueille, est composée de trois prêtres, dont Jean le vicaire général, un
autre Jean stagiaire, futur prêtre et Abel Kassogué, qui sera notre guide en
pays dogon. Nous prenons aussi contact avec l’antenne d’Eau Vive à Sévaré, et
passons un moment avec son responsable Traoré Amadou, ainsi qu’avec Youssouf
Dao.
notre camp de base, à proximité immédiate de Mopti. Mopti, qui est quasiment une presqu’île, entourée d’eau. Mopti la « Venise
malienne » au confluent du Bani et du
Niger, appelée aussi la « ville du Poisson ». La communauté qui nous
accueille, est composée de trois prêtres, dont Jean le vicaire général, un
autre Jean stagiaire, futur prêtre et Abel Kassogué, qui sera notre guide en
pays dogon. Nous prenons aussi contact avec l’antenne d’Eau Vive à Sévaré, et
passons un moment avec son responsable Traoré Amadou, ainsi qu’avec Youssouf
Dao.
Après
une bonne nuit récupératrice à Sévaré et quelques photos matinales d’un gecko,
du veilleur de nuit, de la repasseuse, de bougainvillés, de vaches à bosse,
d’un lever de soleil, Abel nous entraîne à Mopti, cette Venise africaine, puis
nous faisons route vers le cœur du pays dogon : Bandiagara qui nous
accueille, à son
 entrée, par un clin d’œil en affichant deux
objectifs : autosuffisance alimentaire et maîtrise de l’eau, reliant ainsi
le manger propre et local de « Terre et Humanisme » et le boire
potable « d’Eau Vive ». Depuis l’époque de Marcel Griaule, des
barrages ont été construits et la culture de
l’oignon a été largement développée sur
des planches à bordure en pierre, où le plus souvent la terre a été
entrée, par un clin d’œil en affichant deux
objectifs : autosuffisance alimentaire et maîtrise de l’eau, reliant ainsi
le manger propre et local de « Terre et Humanisme » et le boire
potable « d’Eau Vive ». Depuis l’époque de Marcel Griaule, des
barrages ont été construits et la culture de
l’oignon a été largement développée sur
des planches à bordure en pierre, où le plus souvent la terre a été
 rapportée, en provenance d’ailleurs. Il est surprenant de
voir ces belles tâches de verdure, avec une intense agitation familiale pour
l’arrosage et le ramassage. Nous entrons à Sangha par un arc de triomphe
symbolique, à l’heure du marché. Abel nous y
présente sa maman, qui vient à pied, tous
les jours de marché, depuis son village natal de Tabitongo à une dizaine de
kms. Avec Abel, nous avons un guide dogon extraordinaire, qui est sur le
territoire de son ancienne paroisse, et nouvel hasard, en juillet 2008, il a
assuré les remplacements du curé aux Vans en Ardèche, quasiment au siège de
l’association « Terre et Humanisme ». Il a même visité l’église
romane du XIIème siècle de Saint Julien du Serre, village cher à mon
rapportée, en provenance d’ailleurs. Il est surprenant de
voir ces belles tâches de verdure, avec une intense agitation familiale pour
l’arrosage et le ramassage. Nous entrons à Sangha par un arc de triomphe
symbolique, à l’heure du marché. Abel nous y
présente sa maman, qui vient à pied, tous
les jours de marché, depuis son village natal de Tabitongo à une dizaine de
kms. Avec Abel, nous avons un guide dogon extraordinaire, qui est sur le
territoire de son ancienne paroisse, et nouvel hasard, en juillet 2008, il a
assuré les remplacements du curé aux Vans en Ardèche, quasiment au siège de
l’association « Terre et Humanisme ». Il a même visité l’église
romane du XIIème siècle de Saint Julien du Serre, village cher à mon
 cœur, village de mes vacances enfantines et de mes ancêtres
maternels, village où reposent mes proches. Et nous avons, là aussi, à nouveau
des connaissances et amis communs, notamment l’ami évêque François Blondel. Que
le monde est vraiment petit !
cœur, village de mes vacances enfantines et de mes ancêtres
maternels, village où reposent mes proches. Et nous avons, là aussi, à nouveau
des connaissances et amis communs, notamment l’ami évêque François Blondel. Que
le monde est vraiment petit !
Les
paysages dogons sont saisissants avec la « falaise de Bandiagara »,
en grès ferrugineux, longue d’une
 petite centaine de kilomètres et qui surplombe de quelques
300 à 400m, une plaine sablonneuse. Les dogons sont quelques 800 000 et
habitent dans 289 villages construits au pied
des falaises et aussi sur les éboulis. Ils
sont arrivés en plusieurs vagues au 12ème et au 14ème siècle, et ont chassé les tellems qui habitaient dans des cavités à flanc de falaise et qui,
eux-mêmes, avaient succédé aux prétellems, présents déjà à l’époque paléolithique. Les dogons
utilisent les anciennes habitations des tellem, au long des falaises, comme
caveaux pour leurs morts ; ils vont également, en jouant les acrobates, y
chercher du guano, pour nourrir leurs terres. Les chefs religieux des village
s’appellent les hogons, mais ils ont tendance à disparaître. Nous visitons le
village d’Ireli,
petite centaine de kilomètres et qui surplombe de quelques
300 à 400m, une plaine sablonneuse. Les dogons sont quelques 800 000 et
habitent dans 289 villages construits au pied
des falaises et aussi sur les éboulis. Ils
sont arrivés en plusieurs vagues au 12ème et au 14ème siècle, et ont chassé les tellems qui habitaient dans des cavités à flanc de falaise et qui,
eux-mêmes, avaient succédé aux prétellems, présents déjà à l’époque paléolithique. Les dogons
utilisent les anciennes habitations des tellem, au long des falaises, comme
caveaux pour leurs morts ; ils vont également, en jouant les acrobates, y
chercher du guano, pour nourrir leurs terres. Les chefs religieux des village
s’appellent les hogons, mais ils ont tendance à disparaître. Nous visitons le
village d’Ireli,
 avec ses togunas, qui
sont les lieux où se réunissent les sages, lieux volontairement très bas de
plafond, dissuadant ainsi les brutales gesticulations et toutes violences. Il
existe des cases décorées d’animaux et de signes, selon les coutumes. Le grenier à mil, à la silhouette
avec ses togunas, qui
sont les lieux où se réunissent les sages, lieux volontairement très bas de
plafond, dissuadant ainsi les brutales gesticulations et toutes violences. Il
existe des cases décorées d’animaux et de signes, selon les coutumes. Le grenier à mil, à la silhouette
 caractéristique de chaque ethnie, est le trésor matériel de chaque famille, mais les vrais
trésors, les productions les plus précieuses sont, dans la culture dogon, la
Parole, le Verbe et aussi les enfants. En revenant vers Sévaré, sur une piste
parfois hérissée de roches, où le passage au pas est vivement recommandé, nous
voyons des tables de divination, où des tiges de mil plantées au milieu d’arachides
éparpillées, sont piétinées la nuit par le renard roux, et permettent ainsi aux
grands initiés, dans la tradition dogon, d’interpréter les signes visibles sur
le sol. Puis le soleil se couche sur le plateau dogon, à l’heure où le paysan
rejoint son village, l’outil sur les épaules. Et, nous aussi, nous
caractéristique de chaque ethnie, est le trésor matériel de chaque famille, mais les vrais
trésors, les productions les plus précieuses sont, dans la culture dogon, la
Parole, le Verbe et aussi les enfants. En revenant vers Sévaré, sur une piste
parfois hérissée de roches, où le passage au pas est vivement recommandé, nous
voyons des tables de divination, où des tiges de mil plantées au milieu d’arachides
éparpillées, sont piétinées la nuit par le renard roux, et permettent ainsi aux
grands initiés, dans la tradition dogon, d’interpréter les signes visibles sur
le sol. Puis le soleil se couche sur le plateau dogon, à l’heure où le paysan
rejoint son village, l’outil sur les épaules. Et, nous aussi, nous
 allons nous reposer avant une rude journée en perspective
entre le Mali et le Burkina Faso.
allons nous reposer avant une rude journée en perspective
entre le Mali et le Burkina Faso.
C’est donc juste avant cette redoutable et mémorable transition entre le Mali et le Burkina Faso que notre 39ème émission va s’achever. A priori, le mois prochain, nous devrions nous retrouver au Burkina Faso où nous évoquerons aussi, comme je le disais en introduction, « l’après-voyage, les enseignements tirés, les suites, les multiples interventions prévisibles, etc… ». Mais le papy que je suis très heureux d’être, n’a pas la totale maîtrise de son emploi du temps. Ne soyez donc pas étonnés si, d’aventure, je n’étais pas au rendez-vous, cela signifierait très probablement que l’art d’être grand-père, m’accapare encore plus que je ne pensais, pour ma plus grande joie. Mais ce serait partie remise pour le mois d’après. Sur ce, je vous souhaite un très fraternel bonsoir. Et à bientôt.



lectures...