

![]()
Maurice Oudet au cœur des paysans du Sud
32ème émission, le 1er janvier 2008

Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette émission est donc diffusée présentement le 1er janvier 2008, aussi, j’ai plaisir, tout de suite, à souhaiter aux auditeurs et aussi aux lecteurs de mon blog, une excellente année 2008, pour vous-même et les vôtres, une année de paix, de joie, de santé, de courage et, bien sûr, de Fraternité.
 Quelques
mots pour expliquer le choix de notre thème « Maurice Oudet au cœur des paysans du Sud » :
c’est tout simplement en découvrant avec grande joie le dernier éditorial
hebdomadaire de Maurice Oudet sur son site internet www.abcburkina.net . Il était daté du 16
décembre, porte le n°259 et s’intitule
Quelques
mots pour expliquer le choix de notre thème « Maurice Oudet au cœur des paysans du Sud » :
c’est tout simplement en découvrant avec grande joie le dernier éditorial
hebdomadaire de Maurice Oudet sur son site internet www.abcburkina.net . Il était daté du 16
décembre, porte le n°259 et s’intitule
 « Rencontres entre producteurs de riz thaïlandais et ouest-africains…ou de la difficulté pour un paysan de vivre
dignement de son travail ». A plusieurs reprises, j’ai fait
référence à Maurice Oudet, qui se défonce pour que vivent les paysans du Sud,
et qui m’a conduit à lancer il y a 3 ans et à nommer cette émission
« Regards du Sud ». J’associe souvent Maurice Oudet et Pierre Rabhi, deux
personnes exceptionnelles, deux consciences, deux experts complémentaires du
monde paysan, tous deux dans la pensée et dans l’action… j’ai eu la joie
d’interviewer l’ami Pierre au Mali lors de la 13ème émission, et l’ami Maurice
en Béarn lors de la 19ème et il est possible de lire et d’entendre leurs propos
sur mon blog, blog d’accés facile en entrant sur un moteur de recherche
« radio voix du béarn », puis en allant sur les liens chercher
« regards du sud », ce qui vous permettra aussi avec mes propres liens
favoris, d’accéder directement aux sites de Pierre Rabhi et de Maurice Oudet.
« Rencontres entre producteurs de riz thaïlandais et ouest-africains…ou de la difficulté pour un paysan de vivre
dignement de son travail ». A plusieurs reprises, j’ai fait
référence à Maurice Oudet, qui se défonce pour que vivent les paysans du Sud,
et qui m’a conduit à lancer il y a 3 ans et à nommer cette émission
« Regards du Sud ». J’associe souvent Maurice Oudet et Pierre Rabhi, deux
personnes exceptionnelles, deux consciences, deux experts complémentaires du
monde paysan, tous deux dans la pensée et dans l’action… j’ai eu la joie
d’interviewer l’ami Pierre au Mali lors de la 13ème émission, et l’ami Maurice
en Béarn lors de la 19ème et il est possible de lire et d’entendre leurs propos
sur mon blog, blog d’accés facile en entrant sur un moteur de recherche
« radio voix du béarn », puis en allant sur les liens chercher
« regards du sud », ce qui vous permettra aussi avec mes propres liens
favoris, d’accéder directement aux sites de Pierre Rabhi et de Maurice Oudet.
Cette 32ème émission, en résumé, est un échantillon des éditoriaux de Maurice Oudet, échantillon qui me paraît très représentatif de son combat. J’ai donc choisi parmi les 259 parus, 7 éditoriaux récents écrits entre le 21 avril 2007 et le 16 décembre, soit quelques 3 à 4% de l’ensemble. Aussi je vous cite les 7 titres que je vous exprimerais chronologiquement et qui donne la tonalité générale :
La Banque mondiale change de cap ! ; Le
renard invite la poule… ; Les citoyens européens doivent savoir ! ;
Après le lait en poudre et le riz importé, le blé... ; 5 ans déjà ! ;
Vision d'une politique agricole durable ; Rencontre entre producteurs de riz
thaïlandais et ouest-africains...du 16
 décembre
dernier.
décembre
dernier.
Entrons donc dans notre premier éditorial choisi, écrit le 21 avril 2007, le 226ème de la série :
I-La Banque mondiale
change de cap
Pas de lutte contre la pauvreté sans soutien aux
agriculteurs.
Dans son prochain Rapport mondial annuel sur le développement du monde, qui doit être rendu public en septembre, la Banque mondiale encourage les gouvernements des pays pauvres à encadrer et à soutenir leurs paysanneries. La Banque mondiale prend ainsi à contre-pied la doctrine néo-libérale "d'ajustement structurel" quelle a défendue pendant des dizaines d’année. Pour la première fois depuis 1982, ce rapport, qui devrait orienter la nouvelle stratégie de la Banque mondiale, se concentre sur l'agriculture. Délaissée par les politiques de lutte contre la pauvreté, l'aide au secteur agricole redevient un enjeu majeur.
 La
Banque mondiale commence par un constat que nos lecteurs connaissent bien : "Il
est frappant de voir que les trois quarts des pauvres des pays en développement
sont des ruraux : 2,1 milliards d'individus vivent en dessous du seuil de
pauvreté de 2 dollars par jour, soit un tiers de l'humanité (...). Bien que
l'agriculture ne soit pas le seul instrument capable de les sortir de la
pauvreté, c'est une source hautement efficace de croissance pour y parvenir."
La
Banque mondiale commence par un constat que nos lecteurs connaissent bien : "Il
est frappant de voir que les trois quarts des pauvres des pays en développement
sont des ruraux : 2,1 milliards d'individus vivent en dessous du seuil de
pauvreté de 2 dollars par jour, soit un tiers de l'humanité (...). Bien que
l'agriculture ne soit pas le seul instrument capable de les sortir de la
pauvreté, c'est une source hautement efficace de croissance pour y parvenir."
Suit un
diagnostic qui sonne comme l'aveu des erreurs passées : "Malgré cela, la puissance
de l'agriculture pour le développement a trop souvent été sous-utilisée.
Avec la domination de l'industrialisation dans le débat politique, le
développement par l'agriculture n'a souvent même pas été considéré comme une option. Les pays en développement connaissent très fréquemment un
sous-investissement et un mal-investissement dans l'agriculture, de même que
des travers politiques qui jouent à l'encontre de l'agriculture et des
populations rurales pauvres. Et les bailleurs de fonds ont tourné le dos à
l'agriculture. Cet abandon de l'agriculture a eu des coûts élevés pour la
croissance, le bien-être et l'environnement."
D’après le quotidien français Le Monde du 20 avril 2007, le Français Michel Griffon, responsable de l'agriculture et du développement durable au sein de l'Agence nationale de la recherche, se réjouit d'un tel revirement, "qui devrait orienter l'action de la Banque mondiale pour vingt ans". "C'est le document que nous attendions de la Banque mondiale depuis plus de vingt ans, depuis que les politiques d'ajustement structurel ont balayé les politiques publiques agricoles antérieures sans les remplacer", applaudit-il.
 Constatant
que la part de l'agriculture dans les dépenses publiques a reculé entre 1980 et
2004, que ce soit en Afrique (de 6,4 % à 5 %), en Amérique Latine (de 14,8 à
7,4 %), ou en Asie (de 8 à 2,7 %), le texte de la Banque mondiale insiste sur
la nécessité de relancer ces aides. "La croissance agricole, bien que
conduite par le secteur privé et le marché, est très dépendante du soutien du
secteur public. C'est pourtant dans les pays où l'agriculture est la plus
vitale que les Etats tendent à être les plus faibles. (...) La mise en place de
politiques de développement agricole réclame de solides stratégies nationales
et une administration publique œuvrant en faveur d'une distribution et d'une
responsabilité financière efficaces (...)."
Constatant
que la part de l'agriculture dans les dépenses publiques a reculé entre 1980 et
2004, que ce soit en Afrique (de 6,4 % à 5 %), en Amérique Latine (de 14,8 à
7,4 %), ou en Asie (de 8 à 2,7 %), le texte de la Banque mondiale insiste sur
la nécessité de relancer ces aides. "La croissance agricole, bien que
conduite par le secteur privé et le marché, est très dépendante du soutien du
secteur public. C'est pourtant dans les pays où l'agriculture est la plus
vitale que les Etats tendent à être les plus faibles. (...) La mise en place de
politiques de développement agricole réclame de solides stratégies nationales
et une administration publique œuvrant en faveur d'une distribution et d'une
responsabilité financière efficaces (...)."
Vincent Ribier, du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, a participé à une réunion d'experts sur le rapport au Quai d'Orsay le 6 avril dernier. Impressionné par ce changement de ton, il a confié au journal Le Monde : "Les politiques néo-libérales d'ajustement structurel défendues par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont eu un impact très direct et très négatif sur le monde rural dans les pays pauvres."
 Selon
cet économiste, la Banque mondiale s'apprête à sceller pour la première fois
dans un rapport international majeur "la fin du
consensus de Washington", qui résume depuis 1989 la
stratégie des experts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international
et du département du Trésor américain : privatisation, déréglementation, impôts
faibles, libéralisation des échanges. L'un des auteurs principaux du rapport
confirme : "On s'est clairement placés au-delà du consensus de Washington,
parce que la pauvreté n'a pas reculé, et que maintenant il y a l'urgence environnementale."
Selon
cet économiste, la Banque mondiale s'apprête à sceller pour la première fois
dans un rapport international majeur "la fin du
consensus de Washington", qui résume depuis 1989 la
stratégie des experts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international
et du département du Trésor américain : privatisation, déréglementation, impôts
faibles, libéralisation des échanges. L'un des auteurs principaux du rapport
confirme : "On s'est clairement placés au-delà du consensus de Washington,
parce que la pauvreté n'a pas reculé, et que maintenant il y a l'urgence environnementale."
A l'heure où
selon les Nations unies, l'exode rural n'a jamais été aussi rapide dans
l'histoire, la nouvelle ligne adoptée par le rapport de la Banque mondiale
trouve son origine dans le constat de nouveaux périls. "L'accélération du changement
climatique, l'imminence d'une crise de l'eau, la lente adoption des nouvelles
biotechnologies, et le bourgeonnement de la demande de biocarburants et
d'aliments pour le bétail créent de nouvelles incertitudes sur les conditions
dans lesquelles la nourriture
 sera
disponible dans l'économie mondiale", prévient la Banque mondiale.
sera
disponible dans l'économie mondiale", prévient la Banque mondiale.
Ce revirement de la Banque Mondiale devrait réconforter les paysans à travers le monde. C’est un premier pas vers la prochaine étape : la reconnaissance du droit de souveraineté alimentaire par la Banque Mondiale et la communauté internationale. En attendant, les organisations paysannes africaines (entre autres) ont intérêt à bien connaître ce document. Il devrait leur permettre d’engager d’utiles négociations avec leurs gouvernements respectifs.
Dans ses négociations avec les pays ACP (Afrique - Caraïbe - Pacifique), la commission européenne a refusé de mettre l’agriculture à l’ordre du jour. Sera-t-elle la seule à s’entêter et à ne pas reconnaître le rôle essentiel des paysans dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement ?
Notre second éditorial choisi date du 6 mai 2007 et se trouve le 229ème de la série :
II-Le renard invite
la poule…
Les Accords de Partenariat Economique entre l'Union
Européenne et l'Afrique (APE) :
Le renard invite la poule à s'adapter au monde moderne !
 Conte moderne du Burkina Faso :
Conte moderne du Burkina Faso :
Un de mes amis paysans dans le nord-ouest du pays, un ancien combattant, aimait bien, à la veillée, au clair de lune, raconter ce conte.
L'histoire se passe, disait-il, en France, en mai 1968. Il fait déjà nuit. La poule s'est barricadée dans son poulailler, quand le renard approche. Il s'arrête devant le grillage et ouvre sa radio. Le journaliste est en train de décrire la grève des étudiants et explique que partout sur les murs, il est écrit " Il est interdit d'interdire ! ". Le renard ferme son poste de radio et se tourne vers la poule.
" Tu as entendu ? Les temps ont changé !
Il est maintenant interdit d'interdire ! "
" Et alors, lui demande la poule, qu'est-ce que ça
change pour nous ? "
" Cela veut dire que si tu veux être quelqu'un de moderne, dès demain matin, quand tu sors de ton poulailler, tu laisses la porte ouverte. Tu ne peux plus interdire à quelqu'un d'entrer chez toi ! " Là-dessus, il continue sa route.
Le lendemain matin, après une bonne nuit, la poule se réveille en pleine forme, et sort à la recherche de nourriture. Elle allait fermer la porte de son poulailler quand elle se rappelle ce que le renard lui a dit. Et elle laisse la porte ouverte, en se disant : "Bien sûr que je suis quelqu'un de moderne !"
 Le
soir, elle rentre chez elle pour se reposer. Cette fois encore, elle allait
fermer la porte. Mais elle se reprend. " Tu
oublies que tu es moderne ! Laisse donc la porte ouverte. Il faut t'adapter au
monde d'aujourd'hui. Sinon, le renard va venir se moquer de toi ! " Elle laisse donc la porte ouverte. Et bientôt, elle s'endort du sommeil du
juste !
Le
soir, elle rentre chez elle pour se reposer. Cette fois encore, elle allait
fermer la porte. Mais elle se reprend. " Tu
oublies que tu es moderne ! Laisse donc la porte ouverte. Il faut t'adapter au
monde d'aujourd'hui. Sinon, le renard va venir se moquer de toi ! " Elle laisse donc la porte ouverte. Et bientôt, elle s'endort du sommeil du
juste !
 Peu
de temps après, le renard approche du poulailler sans faire de bruit. Il se
demandait : " Est-ce que la poule sera assez
bête pour avoir laissé la porte ouverte?" Arrivé devant la porte,
il ne tarde pas à voir qu'elle est grande ouverte ! Il n'a qu'un bond à
faire pour saisir la poule et la dévorer !
Peu
de temps après, le renard approche du poulailler sans faire de bruit. Il se
demandait : " Est-ce que la poule sera assez
bête pour avoir laissé la porte ouverte?" Arrivé devant la porte,
il ne tarde pas à voir qu'elle est grande ouverte ! Il n'a qu'un bond à
faire pour saisir la poule et la dévorer !
Ce conte, me semble-t-il, illustre à merveille le discours que l'Europe tient aux pays africains, et comment elle conduit ces mêmes pays africains à signer des accords aux conséquences dramatiques pour les populations africaines.
J'ai assisté à Bruxelles à une rencontre entre la Commission européenne et les députés qui suivent les négociations en vue de la signature des APE. Le représentant de la Commission européenne expliquait qu'il n'y avait pas d'alternative au libéralisme actuel. Que l'Europe ne pouvait faire qu'une chose en faveur des pays ACP (d'Afrique - des Caraïbe et du Pacifique) : les aider à moderniser leurs économies et donc à ouvrir leurs frontières. Il a eu cette expression : "Le libéralisme, c'est la vie !" En d'autres termes : " Soyez modernes ! Acceptez le libre-échange ! "
L'Europe persuade les pays africains que s'adapter au monde d'aujourd'hui, cela veut dire : "Laissez la porte ouverte ! Supprimez vos droits de douanes ! Acceptez le libre-échange pur et dur ! "
 Si
l'Europe était moins hypocrite et moins dure envers les pays de l'Afrique de
l'Ouest, elle tiendrait un tout autre langage. Elle pourrait lui dire : " Vous voulez développer votre production
laitière ? Commencez par taxer le lait en poudre à l'importation !
Regardez ce que nous faisons ! Notre filière lait est beaucoup plus
développée que la vôtre. Ce n'est pas pour cela que nous avons cessé de la
protéger ! Nous taxons le lait en poudre à l'importation à 75 %,
alors que vous ne vous protéger qu'à 5 % ! " Et
l'Europe aurait bien d'autres exemples à donner !
Si
l'Europe était moins hypocrite et moins dure envers les pays de l'Afrique de
l'Ouest, elle tiendrait un tout autre langage. Elle pourrait lui dire : " Vous voulez développer votre production
laitière ? Commencez par taxer le lait en poudre à l'importation !
Regardez ce que nous faisons ! Notre filière lait est beaucoup plus
développée que la vôtre. Ce n'est pas pour cela que nous avons cessé de la
protéger ! Nous taxons le lait en poudre à l'importation à 75 %,
alors que vous ne vous protéger qu'à 5 % ! " Et
l'Europe aurait bien d'autres exemples à donner !
 L'Europe
pourrait dire aux pays africains : " Profitez
de notre expérience. Quand nous négocions un accord de libre-échange avec
d'autres pays, nous prenons bien garde de tout libéraliser. Nous proposons de
libéraliser là où nous trouvons notre intérêt, mais nous refusons de
libéraliser le commerce de nombreux produits, quand cela serait défavorable à
nos producteurs. Vous devriez exclure de la libéralisation au moins autant de
produits que nous dans nos accords de libre-échange avec le Chili (471 lignes
tarifaires ont été exclues de toute réduction), avec le Mexique (631 lignes
tarifaires ont été exclues de toute réduction) et avec l'Afrique du Sud
(324). " Ces lignes tarifaires portent notamment sur les
viandes, les produits laitiers, les céréales et les farines, le sucre, les
préparations alimentaires.
L'Europe
pourrait dire aux pays africains : " Profitez
de notre expérience. Quand nous négocions un accord de libre-échange avec
d'autres pays, nous prenons bien garde de tout libéraliser. Nous proposons de
libéraliser là où nous trouvons notre intérêt, mais nous refusons de
libéraliser le commerce de nombreux produits, quand cela serait défavorable à
nos producteurs. Vous devriez exclure de la libéralisation au moins autant de
produits que nous dans nos accords de libre-échange avec le Chili (471 lignes
tarifaires ont été exclues de toute réduction), avec le Mexique (631 lignes
tarifaires ont été exclues de toute réduction) et avec l'Afrique du Sud
(324). " Ces lignes tarifaires portent notamment sur les
viandes, les produits laitiers, les céréales et les farines, le sucre, les
préparations alimentaires.
 Si
l'Europe voulait vraiment construire un partenariat au lieu de renforcer sa
domination sur l'Afrique, elle donnerait d'utiles conseils à l'Afrique de
l'Ouest. Elle pourrait lui dire de faire comme elle, et donc d'instaurer deux
sortes de taxes à l'importation (les deux pouvant s'appliquer en même temps).
Prenons un exemple. Pourquoi ne pas taxer le riz importé à 20 % au lieu
des 10 % actuels, et ajouter une taxe forfaitaire par kilo, par exemple de
100 FCFA (soit 15 cent d’euro). C'est un procédé que l'Europe utilise
fréquemment. Pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest si elle veut développer son
agriculture ? On pourrait aussi ajouter une taxe de 1000 FCFA par
poulet importé. C'est un procédé courant dans d'autres pays. Et nous pourrions
multiplier les exemples. C'est dire que le TEC (Tarif Extérieur Commun) est à
reprendre dans son ensemble.
Si
l'Europe voulait vraiment construire un partenariat au lieu de renforcer sa
domination sur l'Afrique, elle donnerait d'utiles conseils à l'Afrique de
l'Ouest. Elle pourrait lui dire de faire comme elle, et donc d'instaurer deux
sortes de taxes à l'importation (les deux pouvant s'appliquer en même temps).
Prenons un exemple. Pourquoi ne pas taxer le riz importé à 20 % au lieu
des 10 % actuels, et ajouter une taxe forfaitaire par kilo, par exemple de
100 FCFA (soit 15 cent d’euro). C'est un procédé que l'Europe utilise
fréquemment. Pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest si elle veut développer son
agriculture ? On pourrait aussi ajouter une taxe de 1000 FCFA par
poulet importé. C'est un procédé courant dans d'autres pays. Et nous pourrions
multiplier les exemples. C'est dire que le TEC (Tarif Extérieur Commun) est à
reprendre dans son ensemble.
Mais l'Europe se comporte avec les pays africains comme le renard avec la poule de notre conte. Et hélas, les pays africains comme la poule avec le renard. Qui, quel évènement sera encore capable d'aider les uns et les autres à changer de comportement ?
Un 3ème éditorial, daté du 5 août 2007, est le 241ème de la série :
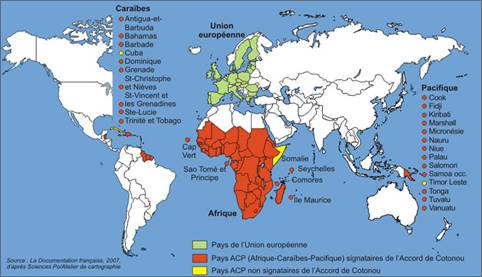 III-241) Les
citoyens européens doivent savoir !
III-241) Les
citoyens européens doivent savoir !
Il y a tout juste deux ans (le 5 août 2005), j'écrivais un article intitulé :
"Les corrompus, le corrupteur". Aujourd'hui, ce qui se passait dans l'ombre est maintenant manifeste ! La Commission européenne, qui a toujours prétendu que le FED (Fonds européen de Développement) n'était pas lié à la signature des APE (Accord de Partenariat Economique), vient de menacer explicitement les pays ACP (les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) de la région Pacifique de leur couper le FED s'ils ne signent pas l'APE avant le 31 décembre 2007. C'est à dire que si les pays du Pacifique ne signent pas l'Accord de Partenariat Economique dans la forme et à la date proposée par la Commission Européenne, la part du 10° FED qui a été attribuée au Pacifique et annoncée solennellement par le commissaire européen Louis Michel sera amputée de 48 % (excusez du peu !).
En clair, cela veut dire que l'Union Européenne qui annonce à toutes les occasions qu'elle va augmenter son aide au développement, menace de la réduire de moitié si les pays ACP ne signent pas avant la fin de l'année les Accords de Partenariat Economique (qui sont des accords de libre-échange).
 Pourtant,
il y a quelques mois, nous étions une trentaine à l'ambassade de la
Pourtant,
il y a quelques mois, nous étions une trentaine à l'ambassade de la
 Commission
européenne de Ouagadougou. Nous étions invités pour échanger avec les
représentants de la Commission européenne venus poursuivre les négociations en
vue d'un Accord de Partenariat Economique avec la CEDEAO (les pays de l'Afrique
de l'Ouest). Au cours de cette réunion j'ai demandé que les gouvernements des
Etats européens déclarent solennellement que les APE et le FED n'étaient pas
liés. Il n'y a pas eu de réponse à ma demande précise, mais il nous a été
affirmé avec force qu'il n'y avait pas de lien entre les APE et le FED.
Aujourd'hui, il apparaît que la Commission Européenne nous a menti !
Commission
européenne de Ouagadougou. Nous étions invités pour échanger avec les
représentants de la Commission européenne venus poursuivre les négociations en
vue d'un Accord de Partenariat Economique avec la CEDEAO (les pays de l'Afrique
de l'Ouest). Au cours de cette réunion j'ai demandé que les gouvernements des
Etats européens déclarent solennellement que les APE et le FED n'étaient pas
liés. Il n'y a pas eu de réponse à ma demande précise, mais il nous a été
affirmé avec force qu'il n'y avait pas de lien entre les APE et le FED.
Aujourd'hui, il apparaît que la Commission Européenne nous a menti !
Voilà comment se comporte la Commission Européenne vis à vis des pays ACP, parmi lesquels se trouvent les pays les plus pauvres du monde (comme le Burkina Faso et le Niger). L'Union Européenne parle de partenariat, mais ici il prend la forme de la menace et du mensonge !
Nous invitons tous les européens qui souhaitent que s'établissent de véritables partenariats entre l'Europe et les pays ACP à interpeller leurs gouvernements respectifs pour que le mandat de la Commission Européenne soit corrigé et respecte les pays ACP qui savent que la libéralisation du commerce ne peut pas, à elle seule, assurer leur développement.
 Le
4ème daté du 27 août 2007 est le 244ème épisode
Le
4ème daté du 27 août 2007 est le 244ème épisode
IV-Après le lait en
poudre et le riz importé, le blé...
De la nécessité de protéger son marché intérieur...
Gouverner, c'est prévoir !
Il semble que ceux qui ont mis en place le TEC (Tarif Extérieur Commun de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest - UEMOA, en l'an 2000) n'ont pas su anticiper les mouvements prévisibles du marché mondial. En supprimant quasiment toute taxe à l'importation sur le lait en poudre, le riz, l'huile, le blé... ils ont permis aux populations urbaines de se nourrir aux moindres coûts. Mais en favorisant les populations urbaines, ils ont freiné le développement des filières lait, riz, céréales... dont ils dépendent pour se nourrir !
 Aujourd'hui
les limites de ce TEC, sans doute le plus libéral du monde, apparaissent
clairement. Les producteurs de riz, et les producteurs de lait sont incapables
de répondre à la demande puisqu'on les a découragés au lieu de les appuyer. Les
populations urbaines (et rurales) sont livrées au bon vouloir du marché
mondial. Et les gouvernements sont incapables de maîtriser la situation.
Aujourd'hui
les limites de ce TEC, sans doute le plus libéral du monde, apparaissent
clairement. Les producteurs de riz, et les producteurs de lait sont incapables
de répondre à la demande puisqu'on les a découragés au lieu de les appuyer. Les
populations urbaines (et rurales) sont livrées au bon vouloir du marché
mondial. Et les gouvernements sont incapables de maîtriser la situation.
 Voici,
à ce sujet, quelques extraits de la revue de presse Afrique du 20/08/07 de RFI
par Frédéric Couteau.
Voici,
à ce sujet, quelques extraits de la revue de presse Afrique du 20/08/07 de RFI
par Frédéric Couteau.
« Une hausse des prix menace les consommateurs ». Avertissement lancé ce lundi par Fraternité Matin. Le quotidien ivoirien affirme que le prix du pain pourrait prochainement augmenter. « La raison en est simple, explique le journal, la hausse du prix du blé sur les marchés mondiaux qui pourrait atteindre 60% pour la campagne d’août ».
Mais il n’y a pas que le pain. Et L’intelligent (d'Abidjan) s’indigne ce matin : « le prix des produits de grande consommation (huile, savon, lait…) augmente vertigineusement, sans qu’aucune autorité ne lève le petit doigt pour stopper l’hémorragie ».../...
 Mali :
baisse de poids pour le pain !
Mali :
baisse de poids pour le pain !
Ce phénomène de hausse des prix gagne toute la sous région et même au-delà. « Flambée des prix du blé : le pain subit le contrecoup », titre L’Essor au Mali. Après une longue concertation, explique le journal, les acteurs de la filière pain ont pris une décision originale : pas d’augmentation directe pour le consommateur, mais une baisse du poids du pain. Ainsi la baguette de 200 grammes passe à 150 et le gros pain passe de 400 grammes à 300, pour un prix donc inchangé. Reste maintenant au gouvernement, précise L’Essor, à avaliser cette décision...
 Nécessité de protéger son marché intérieur
Nécessité de protéger son marché intérieur
Nous avons là la "démonstration par l'absurde" (expression bien connu des étudiants en mathématiques !) de la nécessité, pour nos populations et nos états, de récupérer le droit de souveraineté alimentaire. Inutile de se lamenter sur ce qui a été fait, par contre il est urgent de faire pression sur la commission de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) pour qu'elle corrige le TEC actuel, et surtout qu'elle instaure des taxes à l'importation variables en fonction du marché mondial de façon à assurer des prix rémunérateurs aux producteurs agricoles. La CEDEAO a tout ce qu'il faut pour produire le lait et le riz dont elle a besoin pour sa consommation. Elle a aussi la possibilité de développer des alternatives (à base de maïs ou d'autres céréales) au pain et aux pâtes alimentaires. Encore faut-il s'en donner les moyens et offrir un minimum de protection à ses propres producteurs, ce que font si bien les pays les plus riches.

Le 5ème éditorial choisi ici, est le 245ème de la série et a été écrit le 4 septembre 2007 :
V-5 ans déjà !
4 septembre 2002 - 4 septembre 2007 : 5 ans déjà !
Voilà 5 ans,
jour pour jour, j'écrivais ma première lettre hebdomadaire sur
www.abcburkina.net. Je vous la propose à nouveau, car en la relisant, il m'a
semblé qu'elle restait tout à fait d'actualité. Simplement,
aujourd'hui, il faudrait évoquer les Accords de Partenariat Economique que l'Europe
impose aux pays ACP (Afrique - Caraïbe - Pacifique) et la nécessité pour
l'Afrique de l'Ouest de faire reconnaître son droit de Souveraineté alimentaire.
 Trop, c'est trop !
Trop, c'est trop !
Trop, c'est trop ! C'est ce que la société civile du Burkina Faso a proclamé unanimement après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo un certain 13 décembre 1998.
Trop, c'est trop ! C'est la pensée qui me vient spontanément à l'esprit, au moment où je décide de créer cette nouvelle rubrique, que je voudrais hebdomadaire.
Trop, c'est trop ! Quand je vois les sommets mondiaux se succéder (celui de Monterrey au Mexique, en mars 2002, sur le financement du développement, le sommet mondial de l'alimentation à Rome ( FAO ) en juin 2002, et maintenant le sommet mondial pour un développement durable à Johannesburg), et qu'on refuse de regarder la réalité en face, je me dis : trop, c'est trop !
A Doha, au Qatar, en novembre 2001, au sommet mondial de l'Organisation Mondiale du Commerce, les Pays du Sud ont demandé une évaluation des accords en vigueur actuellement, avant d'envisager de nouveaux accords. Cette demande a été refusé par les puissants de la planète, les mêmes qui inondent le monde d'étude de faisabilité, de statistiques... pour imposer leur libéralisme sans frontière.
 Cette
réalité que les pays riches ont refusé de regarder en face, nous qui vivons
dans un pays appelé P.M.A. (Pays Moins Avancé) par les maîtres du monde,
nous la côtoyons chaque jour. Au moment où s'engagent de nouvelles négociations
sur l'agriculture à l'O.M.C., au moment où l'Europe se prépare à réformer sa
P.A.C. (Politique Agricole Commune), cette réalité, nous voulons la faire
connaître. Je veux parler des conséquences des règles en vigueur sur les
populations rurales des pays du sud. Ce sera un des objectifs de cette rubrique
(Vu au Sud).
Cette
réalité que les pays riches ont refusé de regarder en face, nous qui vivons
dans un pays appelé P.M.A. (Pays Moins Avancé) par les maîtres du monde,
nous la côtoyons chaque jour. Au moment où s'engagent de nouvelles négociations
sur l'agriculture à l'O.M.C., au moment où l'Europe se prépare à réformer sa
P.A.C. (Politique Agricole Commune), cette réalité, nous voulons la faire
connaître. Je veux parler des conséquences des règles en vigueur sur les
populations rurales des pays du sud. Ce sera un des objectifs de cette rubrique
(Vu au Sud).
P.M.A. Pays Moins Avancé ! Et si, justement, c'était "la règle du jeu" que les Etats-Unis et l'Union Européenne voulaient imposer à l'ensemble du monde qui empêchait ces pays d'avancer, comme l'a très vite compris Nicodème Biwando, un simple producteur de coton d'un petit village du Burkina. Le 25 décembre 2001, il nous disait :
 "Il faut dire aux
Américains et aux Européens que nous sommes tous dans un même monde, ils sont
des frères, nous avons besoin les uns des autres. Il ne faut pas qu'ils
organisent leur travail (allusion aux subventions aux producteurs de coton)
comme s'ils étaient dans un autre monde, à part. Leur façon de faire n'est pas
bonne, puisqu'ils nous empêchent, nous, d'avancer. Qu'ils cherchent une
solution, pour que tous ensemble, eux et nous, nous puissions avancer."
("La mondialisation vu par les producteurs de coton africain").
"Il faut dire aux
Américains et aux Européens que nous sommes tous dans un même monde, ils sont
des frères, nous avons besoin les uns des autres. Il ne faut pas qu'ils
organisent leur travail (allusion aux subventions aux producteurs de coton)
comme s'ils étaient dans un autre monde, à part. Leur façon de faire n'est pas
bonne, puisqu'ils nous empêchent, nous, d'avancer. Qu'ils cherchent une
solution, pour que tous ensemble, eux et nous, nous puissions avancer."
("La mondialisation vu par les producteurs de coton africain").
Ces mots
peuvent faire sourire, face à la puissance que dépensent les Etats-Unis et
l'Europe pour imposer leurs règles
 aux
pays du sud. Pourtant, y a t il une autre voie si on ne veut pas condamné à la
pauvreté sans fin les populations rurales de ces pays?
aux
pays du sud. Pourtant, y a t il une autre voie si on ne veut pas condamné à la
pauvreté sans fin les populations rurales de ces pays?
A l'heure de la
globalisation économique et du commerce international, ceux qu'on entend le
plus souvent, ce sont les tenants de la Farm Bill (cette nouvelle loi agricole
américaine qui se propose de protéger encore plus ses producteurs de coton, de
riz, de soja, et de maïs !) et de la P.A.C. (Politique Agricole Communautaire
Européenne) avec ses subventions les plus élevées du monde. Or ce sont les
mêmes qui demandent aux pays pauvres de supprimer toute protection de leur
agriculture ! N'est-il pas temps, pour les pays du sud, d'imaginer de
véritables politiques agricoles à partir d'une analyse de la situation de leurs
propres agriculteurs/éleveurs ? N'est-il pas temps d'exprimer le point de vue du sud sur les
règlements en cours, comme sur les réformes qui se préparent?
Ce sera le deuxième
objectif de cette rubrique hebdomadaire. (Vu du Sud)
Le 6ème et avant-dernier édito choisi, date
d’octobre 2007 et est le 250ème de la série :
 VI-Vision d'une politique
agricole durable
VI-Vision d'une politique
agricole durable
 Interview de M. Gil Ducommun
Interview de M. Gil Ducommun
Aujourd’hui, nous vous proposons une interview de M. Gil Ducommun, professeur à la Haute école d'agronomie de Zollikofen, en Suisse. Cette interview est parue dans l’AGRI, l’hebdomadaire professionnel agricole de la Suisse Romande (www.agrihebdo.ch). En 2003 et 2004, M. Gil Ducommun est venu plusieurs fois au Burkina : il dirigeait alors des travaux de recherche sur les exploitations familiales agricoles du Burkina. Nous avons rendu compte de ces travaux dans l’abcBurkina N°85 : « L’exploitation paysanne familiale : moteur du développement »
«Agri»: La souveraineté alimentaire et le commerce équitable sont-ils à vos yeux des concepts qui ont une chance de percer ?
 G. D.:
Oui. La souveraineté alimentaire passe par une réduction des échanges
commerciaux des produits agricoles de base. C'est insensé de transporter des
milliers de tonnes de céréales d'un continent à l'autre ou d'exporter de la
poudre de lait dans la zone soudano sahélienne très propice à l'élevage. Par
contre, que l'Europe importe des ananas, que la France exporte son vin ou la
Suisse son gruyère, n'est pas très problématique si les frais du transport
incluent les coûts écologiques. L'exportation de produits de niche à forte
valeur ajoutée ne remet pas en cause la souveraineté alimentaire.
G. D.:
Oui. La souveraineté alimentaire passe par une réduction des échanges
commerciaux des produits agricoles de base. C'est insensé de transporter des
milliers de tonnes de céréales d'un continent à l'autre ou d'exporter de la
poudre de lait dans la zone soudano sahélienne très propice à l'élevage. Par
contre, que l'Europe importe des ananas, que la France exporte son vin ou la
Suisse son gruyère, n'est pas très problématique si les frais du transport
incluent les coûts écologiques. L'exportation de produits de niche à forte
valeur ajoutée ne remet pas en cause la souveraineté alimentaire.
La mise en oeuvre de cette souveraineté passe par des échanges équitables. Est équitable une marchandise produite dans le respect des travailleurs et de l'environnement.

«Agri»: Quelle est votre analyse des échecs à répétition de l'OMC ?
G. D.: C'est parce que les pays dominants refusent cette équité et le respect des intérêts de chacun que l'OMC accumule les échecs. Une position néolibérale domine à l'OMC. Elle ignore les concepts de durabilité et d'équité et privilégie les intérêts économiques des grands exportateurs agricoles. L'OMC n'a aucun volet d'action dans les domaines durabilité et équité, les pays dominants l'ayant refusé.
Fort heureusement, les négociations n'aboutissent pas, car l'opposition est trop forte. Cela étant, un organisme comme l'OMC est indispensable. Le monde est en train de prendre conscience de la nécessité d'intégrer d'autres critères dans les négociations et l'OMC pourra en être l'instrument. Dans un futur avenir, il serait souhaitable que des pays exportateurs puissent être pénalisés si les marchandises qu'ils exportent sont produites sans respecter des critères de durabilité écologique et sociale.

 «Agri»:
Une politique agricole internationale intégrant la multifonctionnalité, la
souveraineté alimentaire, la durabilité sociale et le commerce équitable
est-elle une utopie ?
«Agri»:
Une politique agricole internationale intégrant la multifonctionnalité, la
souveraineté alimentaire, la durabilité sociale et le commerce équitable
est-elle une utopie ?
G. D.: Les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. 70% des paysans du monde travaillent le sol à la main, cultivant moins d'un hectare par travailleur (UT), 27% utilisent la traction animale et cultivent 2 à 4 hectares par UT et 3% ont recours à la mécanisation pour cultiver 10 à 200 hectares par UT. A la lumière de ces chiffres, on comprend qu'il n'est pas raisonnable de mettre ces agriculteurs en compétition. La mise en concurrence totale serait insupportable pour l'agriculture suisse et elle est catastrophique à l'échelle mondiale. Les baisses de prix qu'elle engendre déclenchent un exode rural massif, une urbanisation incontrôlée et des mouvements migratoires planétaires.
L'USP et la Suisse devraient chercher des alliances plus fortes avec les nombreux pays en développement dont l'agriculture a des intérêts communs avec les agriculteurs suisses.

«Agri»: Peut-on appliquer à l'agriculture le principe de la libre concurrence et des lois du marché ?
G. D.:
Comme instrument de régulation, elles ne sont applicables uniformément ni à
l'agriculture ni à aucun autre secteur économique. Appliquées comme mesures
uniques de régulation, elles induisent un dumping
 social
et environnemental aux conséquences inacceptables. La politique agricole de
quel pays que ce soit a aussi pour but le maintien du patrimoine rural, la
conservation des compétences de production, des savoir-faire, du tissu social
et des espaces de récréation. Ces objectifs ne pourront être atteints que si
les règles d'échange le permettent.
social
et environnemental aux conséquences inacceptables. La politique agricole de
quel pays que ce soit a aussi pour but le maintien du patrimoine rural, la
conservation des compétences de production, des savoir-faire, du tissu social
et des espaces de récréation. Ces objectifs ne pourront être atteints que si
les règles d'échange le permettent.
Une pression unilatérale sur les prix en vue d'abaisser les coûts de production par rationalisation économique n'est pas un objectif valable. La rationalisation économique a des limites imposées par les objectifs supérieurs de durabilité et de qualité de vie de tous.
 AbcBurkina :
Il y a quelques semaines, nous avons repris le plaidoyer des producteurs de
lait du Canada en faveur de la souveraineté alimentaire pour leur pays et pour le
monde. Aujourd’hui, cette interview vient de Suisse. Je suis sûr que les
paysans burkinabé qui liront ces lignes se retrouveront dans cette vision d’une
politique agricole durable. Elle rejoint notamment la vision de l’agriculture
de la Confédération Paysanne du Faso. Merci à M. Gil Ducommun pour nous avoir
partagé simplement sa vision d’une politique agricole durable
AbcBurkina :
Il y a quelques semaines, nous avons repris le plaidoyer des producteurs de
lait du Canada en faveur de la souveraineté alimentaire pour leur pays et pour le
monde. Aujourd’hui, cette interview vient de Suisse. Je suis sûr que les
paysans burkinabé qui liront ces lignes se retrouveront dans cette vision d’une
politique agricole durable. Elle rejoint notamment la vision de l’agriculture
de la Confédération Paysanne du Faso. Merci à M. Gil Ducommun pour nous avoir
partagé simplement sa vision d’une politique agricole durable

Le 7ème et ultime présenté a été écrit le 16 décembre et porte le n° 259 :
VII-Rencontre entre producteurs
de riz thaïlandais et ouest-africains...
Ou de la difficulté pour un paysan de vivre dignement de son
travail
Du 26 novembre au 5 décembre 2007, j’étais en Thaïlande avec quelques producteurs de riz du Ghana, du Mali et du Burkina Faso. Nous étions invités par les producteurs de riz thaïlandais qui avaient participé au Forum Mondial de la Souveraineté alimentaire qui s’est tenu au Mali en février dernier. Nous étions tous pressés de rencontrer ces paysans qui inondent le marché de l’Afrique de l’Ouest de leur riz.
En arrivant,
nous pensions qu’en Thaïlande les producteurs de riz
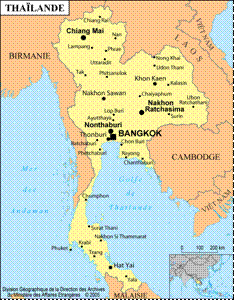 vivaient
bien ; que la vente de leur production de riz leur rapportait des revenus
convenables. Aussi, quel choc quand les paysans de la province de Chai Nat (à
environ 150 km de Bangkok) nous ont dit qu’ils étaient presque tous endettés.
Que la plupart avaient même dû vendre leur terre pour payer une partie de leurs
dettes. Qu’aujourd’hui, dans leur province, seuls 20 % des paysans étaient
propriétaires de leurs terres.
vivaient
bien ; que la vente de leur production de riz leur rapportait des revenus
convenables. Aussi, quel choc quand les paysans de la province de Chai Nat (à
environ 150 km de Bangkok) nous ont dit qu’ils étaient presque tous endettés.
Que la plupart avaient même dû vendre leur terre pour payer une partie de leurs
dettes. Qu’aujourd’hui, dans leur province, seuls 20 % des paysans étaient
propriétaires de leurs terres.
Nous avons cherché à comprendre.
Les paysans nous ont expliqué qu’ils étaient endettés parce que (dans cette région) faisant trois récoltes par an, dès qu’une saison de culture se terminait, il leur fallait vendre rapidement une bonne partie de leur riz pour payer les intrants pour la nouvelle saison : engrais chimiques, pesticides. Et comme cela ne suffisait pas, ils empruntaient également aux banques. Si, pour une raison ou une autre, la récolte étaient moins bonne que prévu, alors ils n’arrivaient pas à rembourser.
 Nous
avons dit notre étonnement, car nous pensions que chaque année le gouvernement
fixait un prix garanti pour la vente du riz paddy (le riz avec son enveloppe,
tel qu’il est récolté dans les champs). Les paysans nous ont dit que ce prix
garanti existait bien, mais qu’il ne les satisfaisait pas pour deux raisons.
D’abord parce qu’il était trop faible (souvent moins de 70 F CFA le kg, soit 11
centimes d’euro), et aussi parce qu’il était fixé trop tard (après la récolte,
au moment où les paysans ont déjà vendu la plus grande partie de leur récolte à
cause de besoins pressants d’argent, notamment pour ceux qui font 3 récoltes
par an !). Notons que ce prix est fixé par le gouvernement en accord avec
les banques et les commerçants. Pas en accord avec les paysans !
Nous
avons dit notre étonnement, car nous pensions que chaque année le gouvernement
fixait un prix garanti pour la vente du riz paddy (le riz avec son enveloppe,
tel qu’il est récolté dans les champs). Les paysans nous ont dit que ce prix
garanti existait bien, mais qu’il ne les satisfaisait pas pour deux raisons.
D’abord parce qu’il était trop faible (souvent moins de 70 F CFA le kg, soit 11
centimes d’euro), et aussi parce qu’il était fixé trop tard (après la récolte,
au moment où les paysans ont déjà vendu la plus grande partie de leur récolte à
cause de besoins pressants d’argent, notamment pour ceux qui font 3 récoltes
par an !). Notons que ce prix est fixé par le gouvernement en accord avec
les banques et les commerçants. Pas en accord avec les paysans !
 Le
lendemain, nous étions plus au nord, dans le district de Nenkam, avec des
paysans qui cultivent le riz pluvial (et font donc une saison de culture par
an), mais aussi la canne à sucre.
Le
lendemain, nous étions plus au nord, dans le district de Nenkam, avec des
paysans qui cultivent le riz pluvial (et font donc une saison de culture par
an), mais aussi la canne à sucre.
Là aussi, les
paysans nous disaient qu’ils étaient endettés. Parce que le riz paddy se vendait
à un prix très bas : 5 à 6 bats le
 kilo
(67 à 80 F CFA). Et aussi parce que pour la canne à sucre, ils dépendaient
entièrement de l’usine locale.
kilo
(67 à 80 F CFA). Et aussi parce que pour la canne à sucre, ils dépendaient
entièrement de l’usine locale.
En effet, chaque paysan cultive la canne à sucre dans ses champs, et ensuite la livre à l’usine qui impose ses prix ! Un paysan nous a expliqué que l’an dernier l’usine lui a payé sa récolte à 800 bats (environ 16 euros) les 100 kg ( ?), mais que cette année l’usine n’a « offert » que 600 bats ! Cette baisse du prix d’achat serait due à l’augmentation de la production, elle-même due à l’annonce de l’ouverture d’une usine devant fabriquer du carburant à partir de la canne à sucre. Mais l’usine n’est toujours pas ouverte !
A l’étape, au moment de partager le repas du soir, nous échangions sur ce que nous avions vu et entendu. Nous nous disions que partout dans le monde, le métier de paysan n’est pas facile ! On s’intéresse bien à sa production, mais on ne veut pas la payer un juste prix. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Déjà, Voltaire ne disait-il pas « la bonne politique a le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres » ? (Voltaire, philosophe français, 1694 - 1778). Existe-t-il un pays au monde qui défende vraiment ses paysans ?
Nous nous disions également qu’il fallait nous unir pour mieux
nous défendre. Et aussi pour chercher ensemble des
 alternatives.
alternatives.
 Et
cela, non seulement à l’intérieur de chaque pays, mais aussi au niveau mondial.
Et tout au long du voyage, notre désir de développer des liens entre paysans
thaïlandais et paysans ouest-africains allait grandissant. Ce désir de coopération s’est renforcé le jour
où nous avons rencontré un groupement de paysans qui avaient abandonné l’usage
de tous les produits chimiques (engrais, pesticides) pour se tourner vers la
culture biologique, et cela avec des résultats remarquables. Ce sera
le sujet d’un prochain courrier !
Et
cela, non seulement à l’intérieur de chaque pays, mais aussi au niveau mondial.
Et tout au long du voyage, notre désir de développer des liens entre paysans
thaïlandais et paysans ouest-africains allait grandissant. Ce désir de coopération s’est renforcé le jour
où nous avons rencontré un groupement de paysans qui avaient abandonné l’usage
de tous les produits chimiques (engrais, pesticides) pour se tourner vers la
culture biologique, et cela avec des résultats remarquables. Ce sera
le sujet d’un prochain courrier !
Voilà cette émission va s’achever, j’espère qu’elle vous aura permis de mieux comprendre la situation vue d’ailleurs. Merci infiniment à Maurice Oudet et à ses proches, pour le redoutable combat qu’ils mènent obstinément. Merci aussi pour les images en provenance pour la plupart de son site www.abcburkina.net .
Le mois prochain, il est probable, si une disponibilité suffisante est au rendez-vous, que le remarquable forum de Biarritz du 16 au 18 novembre 2007 soit à l’ordre du jour. Sur ce, je vous salue en vous renouvelant mes souhaits de bonheur pour 2008. Et à bientôt.

lectures...