

![]()
Témoignages d’un ancien : Pierre SAINT CRICQ
29ème émission les 2 et 15 octobre 2007
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Monsieur Pierre Saint Cricq. (Bonjour Jacques).
 Chers
auditeurs, chers lecteurs de mon « blog »,
chers amis, chers jeunes à qui je pense tout particulièrement avec cette
émission d’espoir. Comme d’habitude, par respect pour vous et pour votre emploi
du temps, je vais vous faire un bref résumé de la petite heure que nous allons
passer ensemble. Un mot préalable pour dire que tous les mois, nous nous posons
la même question essentielle « Comment construire tous ensemble un monde
plus fraternel ? » en variant les approches, « mais de mille
façons, mais par mille détours », comme disait Jacques Brel : la présente 29ème émission, intitulée « Témoignage d’un ancien : Pierre Saint Cricq » sera, en
Chers
auditeurs, chers lecteurs de mon « blog »,
chers amis, chers jeunes à qui je pense tout particulièrement avec cette
émission d’espoir. Comme d’habitude, par respect pour vous et pour votre emploi
du temps, je vais vous faire un bref résumé de la petite heure que nous allons
passer ensemble. Un mot préalable pour dire que tous les mois, nous nous posons
la même question essentielle « Comment construire tous ensemble un monde
plus fraternel ? » en variant les approches, « mais de mille
façons, mais par mille détours », comme disait Jacques Brel : la présente 29ème émission, intitulée « Témoignage d’un ancien : Pierre Saint Cricq » sera, en
 quelque sorte le
survol de ce drôle de 20ème siècle à travers la simplicité et la
richesse d’une vie quotidienne. J’ai une joie toute particulière à enregistrer
cette émission car, j’ai beaucoup de chance, cet ancien, grand témoin
d’aujourd’hui, est mon beau-père, mon beau-papa.
quelque sorte le
survol de ce drôle de 20ème siècle à travers la simplicité et la
richesse d’une vie quotidienne. J’ai une joie toute particulière à enregistrer
cette émission car, j’ai beaucoup de chance, cet ancien, grand témoin
d’aujourd’hui, est mon beau-père, mon beau-papa.
Vous me permettrez, en votre nom de le remercier, car, connaissant son goût et son talent d’écriture et de mémoire, je lui ai posé récemment quelques questions par écrit. Et rapidement de son écriture sans ratures, en s’appuyant parfois sur certains cahiers déjà bien remplis, il a répondu ce que vous allez entendre maintenant. Et, un dernier conseil, ne zappez pas, c’est une émission exceptionnelle.
1-Papy, pour démarrer cette
émission, il serait bien que vous vous présentiez un petit peu aux auditeurs.
 Je
m'appelle Pierre Saint Cricq, et je suis né à Sendets, un village situé à 10 km à l'est de Pau et faisant partie maintenant de la communauté d'agglomération de
Pau. J’y suis né le 9 novembre 1918, deux jours plus tard, toutes les cloches
de Pau sonnaient pour l’armistice. De très nombreux contingents de soldats ou
travailleurs des colonies ou des pays alliés venaient « guigner » à
la fenêtre car le village était un véritable cantonnement. Ils voulaient voir
la maman et le petit. Le temps a passé et maintenant je suis le doyen de la
commune au niveau des hommes, et je vais entrer dans ma 90e année, ce 9
novembre prochain. D'après la légende le nom de Sendets viendrait des sentiers du roi Vert galant, que traversait Henri IV, quand il
allait rencontrer la belle Corisande au château d’Andoins. J’habite toujours à Sendets et nous y sommes bien, mais il ne faut pas trop le dire. Mon père était
tailleur d'habits et fut secrétaire de mairie durant 35 années. Il avait ouvert
aussi une auberge en 1923. Ma mère était chemisière-couturière.
Nous étions trois enfants : ma soeur avait dix ans de plus que moi et fût
couturière à Pau. Mon frère qui avait cinq ans de plus que moi, était artisan
tailleur d'habits à Pau. Dans ces temps extrêmement difficiles pour les
artisans de campagne, mon arrivée ne fut pas désirée... Mais je ne n'en ai pas
souffert. On était quand même choyés et aimés. L'argent ne circulait pas, il y
en avait très peu. Avant 1914, c'était presque la misère pour beaucoup, même
ceux qui avaient des terres. L’or et les pièces en or, c'était la monnaie de
l'époque, qui fut remplacée par la planche à billets pour la défense de la
nation en 1914-18.
Je
m'appelle Pierre Saint Cricq, et je suis né à Sendets, un village situé à 10 km à l'est de Pau et faisant partie maintenant de la communauté d'agglomération de
Pau. J’y suis né le 9 novembre 1918, deux jours plus tard, toutes les cloches
de Pau sonnaient pour l’armistice. De très nombreux contingents de soldats ou
travailleurs des colonies ou des pays alliés venaient « guigner » à
la fenêtre car le village était un véritable cantonnement. Ils voulaient voir
la maman et le petit. Le temps a passé et maintenant je suis le doyen de la
commune au niveau des hommes, et je vais entrer dans ma 90e année, ce 9
novembre prochain. D'après la légende le nom de Sendets viendrait des sentiers du roi Vert galant, que traversait Henri IV, quand il
allait rencontrer la belle Corisande au château d’Andoins. J’habite toujours à Sendets et nous y sommes bien, mais il ne faut pas trop le dire. Mon père était
tailleur d'habits et fut secrétaire de mairie durant 35 années. Il avait ouvert
aussi une auberge en 1923. Ma mère était chemisière-couturière.
Nous étions trois enfants : ma soeur avait dix ans de plus que moi et fût
couturière à Pau. Mon frère qui avait cinq ans de plus que moi, était artisan
tailleur d'habits à Pau. Dans ces temps extrêmement difficiles pour les
artisans de campagne, mon arrivée ne fut pas désirée... Mais je ne n'en ai pas
souffert. On était quand même choyés et aimés. L'argent ne circulait pas, il y
en avait très peu. Avant 1914, c'était presque la misère pour beaucoup, même
ceux qui avaient des terres. L’or et les pièces en or, c'était la monnaie de
l'époque, qui fut remplacée par la planche à billets pour la défense de la
nation en 1914-18.
2-Papy, dans ce contexte rude,
pourriez-vous maintenant nous parler de votre enfance et de votre quotidien.
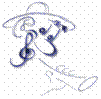
 L’hécatombe
de 14-18 avait marqué le pays qui était exsangue. Les deuils touchaient toutes
les familles. À trois ans je gagnais l'école et ma soeur me présenta à ses
copines. Nous avions un couple d'instituteurs, M et Mme Latapie,
qui étaient d'excellents enseignants, mais il fallait travailler car ils
avaient la gifle facile. Nous les avions très souvent sur le dos, comme nous
n'étions pas nombreux, les classes de 14-18 étant bien creuses les combattants
étant au front. Et quand la gifle arrivait, nous étions gratifiés d'un complément
identique à la maison. On était malin, car on cachait souvent qu'on était puni.
Moi j'étais assez mal placé car le maître d'école était voisin et ami de papa
qui souvent lui demandait si ça marchait. J'ai un souvenir ému à la pensée de
ces deux enseignants qui nous avaient aidés et suivis pendant 10 ans. Ils nous
avaient enseigné le jardinage, le théâtre scolaire, la musique, la taille de la
vigne, la menuiserie … En plus de tout le reste. Je passai le certificat
d'études à 11 ans et demi le 9 juillet 1930. Ensuite je suis resté à la maison
un an et demi aidant papa et maman qui avaient de nombreux pensionnaires et je
suivis aussi des cours d'adultes pendant l'année 1931. En mars 1932, à 13 ans
et demi, je partis à Pau comme garçon de courses,
L’hécatombe
de 14-18 avait marqué le pays qui était exsangue. Les deuils touchaient toutes
les familles. À trois ans je gagnais l'école et ma soeur me présenta à ses
copines. Nous avions un couple d'instituteurs, M et Mme Latapie,
qui étaient d'excellents enseignants, mais il fallait travailler car ils
avaient la gifle facile. Nous les avions très souvent sur le dos, comme nous
n'étions pas nombreux, les classes de 14-18 étant bien creuses les combattants
étant au front. Et quand la gifle arrivait, nous étions gratifiés d'un complément
identique à la maison. On était malin, car on cachait souvent qu'on était puni.
Moi j'étais assez mal placé car le maître d'école était voisin et ami de papa
qui souvent lui demandait si ça marchait. J'ai un souvenir ému à la pensée de
ces deux enseignants qui nous avaient aidés et suivis pendant 10 ans. Ils nous
avaient enseigné le jardinage, le théâtre scolaire, la musique, la taille de la
vigne, la menuiserie … En plus de tout le reste. Je passai le certificat
d'études à 11 ans et demi le 9 juillet 1930. Ensuite je suis resté à la maison
un an et demi aidant papa et maman qui avaient de nombreux pensionnaires et je
suivis aussi des cours d'adultes pendant l'année 1931. En mars 1932, à 13 ans
et demi, je partis à Pau comme garçon de courses,
 où
je restais la semaine. En ce
où
je restais la semaine. En ce
 temps-là,
la crise mondiale de 1929 avait laminé l'économie de tous les pays vainqueurs
et vaincus. L'astuce pour les parents peu fortunés, c'était les métiers ayant
trait à l'alimentation pour les jeunes. On était logés, nourris, et nous
rapportions un maigre argent de poche que je donnais à la maison pour faire
bouillir la marmite. On couchait dans des chambres où à plusieurs reprises,
punaises et cancrelats se damaient le pion. Nous avions des vélos qu’on se
montait avec des récupérations. Le chômage était partout. Je fis un peu tous
les métiers, manoeuvre à la pelle et à la pioche, le goudronnage, porter le
charbon aux étages pour le prochain hiver. Je revenais le samedi soir de Pau et
repartais le lundi matin en vélo. Le dimanche, on jouait aux quilles et aux
cartes et les adultes buvaient un coup. Le plus souvent, je servais les clients
à l'auberge et mine de rien, j'écoutais les combattants de 14-18 et autres
conversations. J'avais une excellente mémoire. Le temps passait et les voyous
nazis de Berlin dépassaient les bornes et faisaient bien du bruit. Ils avaient
des apôtres en France. Il n'y avait pas d'allocation chômage à l'époque. On
essayait de ne pas rester chômeur longtemps et on cherchait du travail car la
misère aux fesses, ce n'est pas à souhaiter. En 1936, avec la semaine de 40
heures et les congés payés les choses semblaient s'arranger....
temps-là,
la crise mondiale de 1929 avait laminé l'économie de tous les pays vainqueurs
et vaincus. L'astuce pour les parents peu fortunés, c'était les métiers ayant
trait à l'alimentation pour les jeunes. On était logés, nourris, et nous
rapportions un maigre argent de poche que je donnais à la maison pour faire
bouillir la marmite. On couchait dans des chambres où à plusieurs reprises,
punaises et cancrelats se damaient le pion. Nous avions des vélos qu’on se
montait avec des récupérations. Le chômage était partout. Je fis un peu tous
les métiers, manoeuvre à la pelle et à la pioche, le goudronnage, porter le
charbon aux étages pour le prochain hiver. Je revenais le samedi soir de Pau et
repartais le lundi matin en vélo. Le dimanche, on jouait aux quilles et aux
cartes et les adultes buvaient un coup. Le plus souvent, je servais les clients
à l'auberge et mine de rien, j'écoutais les combattants de 14-18 et autres
conversations. J'avais une excellente mémoire. Le temps passait et les voyous
nazis de Berlin dépassaient les bornes et faisaient bien du bruit. Ils avaient
des apôtres en France. Il n'y avait pas d'allocation chômage à l'époque. On
essayait de ne pas rester chômeur longtemps et on cherchait du travail car la
misère aux fesses, ce n'est pas à souhaiter. En 1936, avec la semaine de 40
heures et les congés payés les choses semblaient s'arranger....
3-Et la jeunesse papy, comment
cela se passait à cette époque ?
 La
jeunesse, on se trouvait heureux de vivre, on n'était pas malheureux. Le vélo
nous donnait une autonomie que ne connaissaient pas nos parents. Nous partions
en bande, souvent en chantant les succès de l'époque. Nous avions essayé de
former quelques anciens à faire du vélo, mais ils avaient très peur de tomber.
N'ayant pas pratiqué le rugby ou le football où l'on tombe souvent, ils
auraient été, comme ils disaient, « esbrigaillats »,
c’est-à-dire blessés. Au village la vie se déroulait tant bien que mal, la
débrouille était la règle. On économisait tout. Les chemins n'étaient pas
goudronnés jusqu'en 1953. L'électricité fut installée pour le tiers du village
en 1927. L'eau était fournie par les puits avec des pompes à main. Le chauffage
central attendit 1971. Auparavant les maisons n'étaient pas chauffées, ce
n'était que le coin du feu qui en profitait. La plupart des habitations avaient
le sol en terre battue. On se lavait l’hiver à proximité du feu. Dans les
périodes de pluie, la boue était
La
jeunesse, on se trouvait heureux de vivre, on n'était pas malheureux. Le vélo
nous donnait une autonomie que ne connaissaient pas nos parents. Nous partions
en bande, souvent en chantant les succès de l'époque. Nous avions essayé de
former quelques anciens à faire du vélo, mais ils avaient très peur de tomber.
N'ayant pas pratiqué le rugby ou le football où l'on tombe souvent, ils
auraient été, comme ils disaient, « esbrigaillats »,
c’est-à-dire blessés. Au village la vie se déroulait tant bien que mal, la
débrouille était la règle. On économisait tout. Les chemins n'étaient pas
goudronnés jusqu'en 1953. L'électricité fut installée pour le tiers du village
en 1927. L'eau était fournie par les puits avec des pompes à main. Le chauffage
central attendit 1971. Auparavant les maisons n'étaient pas chauffées, ce
n'était que le coin du feu qui en profitait. La plupart des habitations avaient
le sol en terre battue. On se lavait l’hiver à proximité du feu. Dans les
périodes de pluie, la boue était
 partout,
au-dehors. On se couchait dans des lits très froids, mais nous avions des
tuiles, cailloux ou briques qui nous aidaient à nous réchauffer. On était
habitués au froid. Les fêtes et les bals étaient tristes, mais à Sendets on dansait le dimanche après-midi pour la durée du
carnaval et le mardi gras. C’était le seul village où on dansait et il y avait
un petit orchestre. Un bal démarrait quand une fille
partout,
au-dehors. On se couchait dans des lits très froids, mais nous avions des
tuiles, cailloux ou briques qui nous aidaient à nous réchauffer. On était
habitués au froid. Les fêtes et les bals étaient tristes, mais à Sendets on dansait le dimanche après-midi pour la durée du
carnaval et le mardi gras. C’était le seul village où on dansait et il y avait
un petit orchestre. Un bal démarrait quand une fille
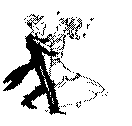 de Sendets dansait avec un étranger au village. Là,
piqués au vif, les Sendetsois se mettaient à s'amuser
et commençaient à danser, ils étaient jaloux. Les dimanches avant le carême, il
y avait 8 ou 10 après-midi de bal de carnaval, mais les après-midi sont courts,
la nuit tombe vite. Les vêpres drainaient les jeunes filles à 15 heures à
l'église, avant le bal. Le curé jouait les prolongations. De ce fait les filles
ne faisaient souvent que deux petites danses avant de rentrer à la maison,
l'angélus à 18 heures était la limite à respecter. Les garçons eux étaient plus
libres mais n'avaient pas d'argent.
de Sendets dansait avec un étranger au village. Là,
piqués au vif, les Sendetsois se mettaient à s'amuser
et commençaient à danser, ils étaient jaloux. Les dimanches avant le carême, il
y avait 8 ou 10 après-midi de bal de carnaval, mais les après-midi sont courts,
la nuit tombe vite. Les vêpres drainaient les jeunes filles à 15 heures à
l'église, avant le bal. Le curé jouait les prolongations. De ce fait les filles
ne faisaient souvent que deux petites danses avant de rentrer à la maison,
l'angélus à 18 heures était la limite à respecter. Les garçons eux étaient plus
libres mais n'avaient pas d'argent.
4-Papy, actuellement et à
juste titre, on parle beaucoup d’Ecologie, de relations avec la Nature, avec
les animaux. Et pour vous Papy, comme cela se passait ?
 J'ai
toujours eu des relations avec la nature, les bois, les champs, les sentiers
que nous parcourions avec mon frère. On allait pêcher à la ligne, goujons, « pesquits »
de toutes sortes. Le calme de la nature où l'on entend le ruissellement de
l'eau, les champs des oiseaux, mais c'est magnifique ! Côté animaux, nous
avions des chats, poules, un cochon pour l'année, des oies, des canards. Les
chats, ce sont des amis de toujours. J’en avais dressé, saut en hauteur, en
longueur. J'ai dormi avec des chats pendant très longtemps, je n'ai jamais été
griffé. Les poules avaient pour la plupart des noms, plutôt des prénoms de
personnes boiteuses de la commune. J’en avais apprivoisé plusieurs. Il y eut un
poulet, quand il faisait ses besoins, il relevait la tête, battait des ailes et
se mettait à siffler comme nous ! Il souffrait le pauvre ! Nous avions des
glousses avec des poussins qui venaient se chauffer au coin du feu l'hiver. Ils
étiraient leurs petites pattes et leurs ailes pour mieux se chauffer. C'était
tellement beau qu'on les laissait faire. Dans un poulailler, il y a des castes,
des clans, comme partout chez les humains. Les volailles anciennes mènent
souvent la vie dure aux jeunes.
J'ai
toujours eu des relations avec la nature, les bois, les champs, les sentiers
que nous parcourions avec mon frère. On allait pêcher à la ligne, goujons, « pesquits »
de toutes sortes. Le calme de la nature où l'on entend le ruissellement de
l'eau, les champs des oiseaux, mais c'est magnifique ! Côté animaux, nous
avions des chats, poules, un cochon pour l'année, des oies, des canards. Les
chats, ce sont des amis de toujours. J’en avais dressé, saut en hauteur, en
longueur. J'ai dormi avec des chats pendant très longtemps, je n'ai jamais été
griffé. Les poules avaient pour la plupart des noms, plutôt des prénoms de
personnes boiteuses de la commune. J’en avais apprivoisé plusieurs. Il y eut un
poulet, quand il faisait ses besoins, il relevait la tête, battait des ailes et
se mettait à siffler comme nous ! Il souffrait le pauvre ! Nous avions des
glousses avec des poussins qui venaient se chauffer au coin du feu l'hiver. Ils
étiraient leurs petites pattes et leurs ailes pour mieux se chauffer. C'était
tellement beau qu'on les laissait faire. Dans un poulailler, il y a des castes,
des clans, comme partout chez les humains. Les volailles anciennes mènent
souvent la vie dure aux jeunes.
5-Papy, je sais que vous étiez
sportif et que vous l’êtes encore un peu. Pourriez-vous nous en dire un peu
plus ?
 J'ai
pratiqué le cross-country en amateur depuis 1935. Je m'entraînais deux fois par
semaine au stadium de la gare, au fronton. Le cross c'était le sport le moins
coûteux. Il y avait beaucoup d'équipes de cross en France. La section paloise
avait à l'époque une bonne équipe de cross : Malé,
Laborde, Dufau, Lacoste et d'autres. François Dufau qui était employé à la SNCF avait la classe et a été
tué sur les bords de la Loire en mai 1940 : il y avait une stèle à la gare
de Pau où figurait son nom. Il était très bon sur route et avait fini 27e au
marathon d'Europe en 1937. Moi je n'avais pas de « classe ». Il
fallait que je m'entraîne beaucoup pour figurer. Je courus plusieurs courses,
dont le tour de Pau, où je terminais 44e. C'était le 25 avril 1937 et j'étais
encore junior. Après la guerre j'ai pratiqué un peu le rugby avec Sendets, puis à Pau, où nous faisions un match triangulaire
avec la Sécurité Sociale, la Préfecture et la Trésorerie, je jouais talonneur !
J'adore faire de l'exercice. Il faut se « faire aller ». Cela
facilite la digestion, le transit intestinal et le système cardio-vasculaire.
Encore maintenant, je vais faire le tour du village à vélo avec la chienne Leyla qui trottine à côté de moi.
J'ai
pratiqué le cross-country en amateur depuis 1935. Je m'entraînais deux fois par
semaine au stadium de la gare, au fronton. Le cross c'était le sport le moins
coûteux. Il y avait beaucoup d'équipes de cross en France. La section paloise
avait à l'époque une bonne équipe de cross : Malé,
Laborde, Dufau, Lacoste et d'autres. François Dufau qui était employé à la SNCF avait la classe et a été
tué sur les bords de la Loire en mai 1940 : il y avait une stèle à la gare
de Pau où figurait son nom. Il était très bon sur route et avait fini 27e au
marathon d'Europe en 1937. Moi je n'avais pas de « classe ». Il
fallait que je m'entraîne beaucoup pour figurer. Je courus plusieurs courses,
dont le tour de Pau, où je terminais 44e. C'était le 25 avril 1937 et j'étais
encore junior. Après la guerre j'ai pratiqué un peu le rugby avec Sendets, puis à Pau, où nous faisions un match triangulaire
avec la Sécurité Sociale, la Préfecture et la Trésorerie, je jouais talonneur !
J'adore faire de l'exercice. Il faut se « faire aller ». Cela
facilite la digestion, le transit intestinal et le système cardio-vasculaire.
Encore maintenant, je vais faire le tour du village à vélo avec la chienne Leyla qui trottine à côté de moi.
 6-Papy,
notre survol du 20ème siècle n’évitera pas la guerre et la peur.
Cette guerre, comment l’avez-vous vécu ? Comment cela a commencé
pour vous ?
6-Papy,
notre survol du 20ème siècle n’évitera pas la guerre et la peur.
Cette guerre, comment l’avez-vous vécu ? Comment cela a commencé
pour vous ?
Le 24 août 1937, à 18 ans et demi,
je suis incorporé au 196e RALT, « régiment d'artillerie lourde tractée et
motorisée », j’ai devancé l'appel de l'armée, ce qui nous permettait de
choisir notre régiment. Mon frère Ado, le matin en prenant son déjeuner avec
moi, se mit à pleurer et maman aussi... Je partais à Bordeaux
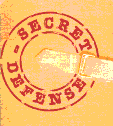 pour
deux ans à la caserne Nansouty, je pris le train pour
la première fois. Après avoir reçu mon paquetage, je fis comme les autres, la
dictée au bureau de la batterie : « le premier devoir du soldat est de faire
honneur à son drapeau et à sa patrie. Il doit obtenir de lui-même la force de
caractère de résister aux fatigues du métier et d'obéir à ses chefs, quels
qu'ils soient. Il doit se mettre au service de la nation pour servir son pays
utilement. » J'étais un peu « faux cul » car après ce que j'avais
entendu à Sendets par les poilus de 14-18, ce n'était
pas tout à fait mon idée. Plus tard je fis le peloton d'élèves petits gradés,
sans me casser le bol. J'ai travaillé au bureau de batterie comme scribouillard
et ensuite au bureau de la 18e région militaire. La j'ai travaillé avec un trouffion qui était professeur d'allemand et nazi notoire.
Il ne craignait pas d'afficher ses idées mais on le laissait faire... On
collationnait ensemble des documents militaires classés « secrets
défense ». Je fus ensuite nommé brigadier le 1er juillet 1939 et comme
j'étais quand même très connu avec la musique, ça me facilitait les relations.
On était connu, en particulier aux cuisines, où nous honorions sérieusement le
rabiot d’usage, qui nous était gardé en priorité envers et contre tous.
pour
deux ans à la caserne Nansouty, je pris le train pour
la première fois. Après avoir reçu mon paquetage, je fis comme les autres, la
dictée au bureau de la batterie : « le premier devoir du soldat est de faire
honneur à son drapeau et à sa patrie. Il doit obtenir de lui-même la force de
caractère de résister aux fatigues du métier et d'obéir à ses chefs, quels
qu'ils soient. Il doit se mettre au service de la nation pour servir son pays
utilement. » J'étais un peu « faux cul » car après ce que j'avais
entendu à Sendets par les poilus de 14-18, ce n'était
pas tout à fait mon idée. Plus tard je fis le peloton d'élèves petits gradés,
sans me casser le bol. J'ai travaillé au bureau de batterie comme scribouillard
et ensuite au bureau de la 18e région militaire. La j'ai travaillé avec un trouffion qui était professeur d'allemand et nazi notoire.
Il ne craignait pas d'afficher ses idées mais on le laissait faire... On
collationnait ensemble des documents militaires classés « secrets
défense ». Je fus ensuite nommé brigadier le 1er juillet 1939 et comme
j'étais quand même très connu avec la musique, ça me facilitait les relations.
On était connu, en particulier aux cuisines, où nous honorions sérieusement le
rabiot d’usage, qui nous était gardé en priorité envers et contre tous.
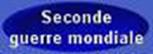 En
août 1939, les lits furent supprimés dans les chambrées et remplacés par de la
paille. Faisant partie de l'échelon A de mobilisation, il nous fut interdit de
nous déshabiller, nous pouvions partir dans les 10 minutes et nous dormions
tout habillés. À la fin de 1939, ayant embarqué les camions, canons, matériels
durant trois jours nous partîmes gare Saint-Jean de Bordeaux. On nous attribua
la chaînette plaque, en cas de décès et le paquet de pansements. C'était
réconfortant... Sur le train, ce fut le calme à côté du quartier où
grouillaient tant de mobilisés.
En
août 1939, les lits furent supprimés dans les chambrées et remplacés par de la
paille. Faisant partie de l'échelon A de mobilisation, il nous fut interdit de
nous déshabiller, nous pouvions partir dans les 10 minutes et nous dormions
tout habillés. À la fin de 1939, ayant embarqué les camions, canons, matériels
durant trois jours nous partîmes gare Saint-Jean de Bordeaux. On nous attribua
la chaînette plaque, en cas de décès et le paquet de pansements. C'était
réconfortant... Sur le train, ce fut le calme à côté du quartier où
grouillaient tant de mobilisés.
 7-Papy,
et où ce train vous a-t-il emmenés ? Et ensuite ?
7-Papy,
et où ce train vous a-t-il emmenés ? Et ensuite ?
Direction l’Alsace. A mon
arrivée, je fus muté au 194ème RALT du dépôt de la caserne Montcalm
de Nîmes et affecté à une unité de ravitaillement. Le cantonnement était dans
le Haut Rhin, à la maison Rey de Tagsdorff dans une
remise écurie. Nous ravitaillions les troupes situées à la frontière allemande
et nous transportions nourriture, obus, gargousses, viande, légumes, fruits.
L’hiver 39-40 fut très rude. Nous eûmes à deux reprises -28°. Aussi le poêle,
un bidon d'essence muni d'un tuyau pour l'évacuation, servait de
 chauffage
de jour et de nuit. Le poêle était entretenu en priorité. On couchait habillés,
car en cas d'alerte, il fallait être prêts à l'instant. On mettait la capote
sur la tête pour se protéger des courants d'air qui étaient sévères. Nous
faisions des corvées de bois pour entretenir le feu, par des moins 20°.
Certains arbres claquaient sous l'emprise du froid. La neige était tombée, 40
cm, était tassée, une autre couche tombait et était tassée sur la précédente...
Cette glace dura cinq mois. Le 22 avril il neigeait encore. La population du
village était en majorité « partisane » des Français, à part une ou
deux familles qui surtout en avaient marre de ces guerres. En avril 1940 nous
fûmes relevés par une autre unité et partîmes en convoi jusqu'à Dieffmatten, puis Lissol le grand, Chermisey,
chauffage
de jour et de nuit. Le poêle était entretenu en priorité. On couchait habillés,
car en cas d'alerte, il fallait être prêts à l'instant. On mettait la capote
sur la tête pour se protéger des courants d'air qui étaient sévères. Nous
faisions des corvées de bois pour entretenir le feu, par des moins 20°.
Certains arbres claquaient sous l'emprise du froid. La neige était tombée, 40
cm, était tassée, une autre couche tombait et était tassée sur la précédente...
Cette glace dura cinq mois. Le 22 avril il neigeait encore. La population du
village était en majorité « partisane » des Français, à part une ou
deux familles qui surtout en avaient marre de ces guerres. En avril 1940 nous
fûmes relevés par une autre unité et partîmes en convoi jusqu'à Dieffmatten, puis Lissol le grand, Chermisey,
 où
nous cantonnames..et ce
furent Nancy, Sarralbe, Whal, Faulquemont, Barst, Tedding, nous déposions
notre infanterie et là nous entendions nettement le bruit de la bataille. Des
ambulances passaient avec leurs chargements de blessés et leurs clochettes Pim Pom. On ne moisissait pas
dans le coin. Les fermes et les maisons étaient évacuées. Les camions devaient
être impérativement espacés de 50 mètres pour ne pas attirer les avions. Nous
revînmes à Chermisey pour en repartir presque
aussitôt. On évitait autant que possible les villes et là nous fûmes confrontés
avec la débâcle de la population qui entravait la montée des forces armées. Les
gens partaient où ? Ils ne savaient pas ! La panique était partout. On passa à Colombey-les belles. Je passai dans des villages que je
connaissais de nom pour les avoir entendus au bistrot de Sendets,
raconter par ceux de 14-18. Nous traversâmes l’Aube, puis Provins-Villenauxe,
Chantilly dans l'Oise, Luzarches où je vis en passant le monument indiquant
l’endroit où les Allemands avaient été arrêtés en 1914, pendant la bataille de
la Marne. On passa Senlis et la nuit on stationnait dans les forêts. Le moral
était à zéro, on ne dormait plus, on ne mangeait plus. Dès trois heures du
matin, les avions commençaient à passer. On ne pouvait pas mettre en batterie
nos canons qui avaient été conçus pour démolir des forteresses en 14-18. Notre
matériel était inadapté à la guerre de mouvement. Trop lourd, trop lent, trop
long à mettre en batterie. Nous passâmes la nuit au sud de Beauvais à Beaumont
sur Oise,.... On traversa la Seine à Vernon et filâmes au sud de Rouen, où à
une heure du matin, la colonne stationnait sur le bord de la route. La lueur
des incendies de dépôts d'essence éclairait la cabine du camion. C'était
hallucinant on aurait pu lire son journal… Nous reçûmes l'ordre d'abandonner
canons, obus,… et plus tard, nous arrivâmes au camp de Coëtquidan.
où
nous cantonnames..et ce
furent Nancy, Sarralbe, Whal, Faulquemont, Barst, Tedding, nous déposions
notre infanterie et là nous entendions nettement le bruit de la bataille. Des
ambulances passaient avec leurs chargements de blessés et leurs clochettes Pim Pom. On ne moisissait pas
dans le coin. Les fermes et les maisons étaient évacuées. Les camions devaient
être impérativement espacés de 50 mètres pour ne pas attirer les avions. Nous
revînmes à Chermisey pour en repartir presque
aussitôt. On évitait autant que possible les villes et là nous fûmes confrontés
avec la débâcle de la population qui entravait la montée des forces armées. Les
gens partaient où ? Ils ne savaient pas ! La panique était partout. On passa à Colombey-les belles. Je passai dans des villages que je
connaissais de nom pour les avoir entendus au bistrot de Sendets,
raconter par ceux de 14-18. Nous traversâmes l’Aube, puis Provins-Villenauxe,
Chantilly dans l'Oise, Luzarches où je vis en passant le monument indiquant
l’endroit où les Allemands avaient été arrêtés en 1914, pendant la bataille de
la Marne. On passa Senlis et la nuit on stationnait dans les forêts. Le moral
était à zéro, on ne dormait plus, on ne mangeait plus. Dès trois heures du
matin, les avions commençaient à passer. On ne pouvait pas mettre en batterie
nos canons qui avaient été conçus pour démolir des forteresses en 14-18. Notre
matériel était inadapté à la guerre de mouvement. Trop lourd, trop lent, trop
long à mettre en batterie. Nous passâmes la nuit au sud de Beauvais à Beaumont
sur Oise,.... On traversa la Seine à Vernon et filâmes au sud de Rouen, où à
une heure du matin, la colonne stationnait sur le bord de la route. La lueur
des incendies de dépôts d'essence éclairait la cabine du camion. C'était
hallucinant on aurait pu lire son journal… Nous reçûmes l'ordre d'abandonner
canons, obus,… et plus tard, nous arrivâmes au camp de Coëtquidan.
8-Papy, encore un peu plus
tard, que s’est-il passé le 19 juin 1940, à Carquefou, en banlieue de
Nantes ?
 Ce
jour-là, nous fûmes arrêtés par des soldats de la division blindée Hermann
Goering et Gross Deutschland pour d'autres
Ce
jour-là, nous fûmes arrêtés par des soldats de la division blindée Hermann
Goering et Gross Deutschland pour d'autres
 unités
et nous fûmes poussés vers un mur. On nous projeta contre un mur. C'était de
très jeunes soldats qui semblaient capables de faire n'importe quoi. Les gradés
allemands étaient un peu plus âgés. Les camions furent fouillés et nous étions
plusieurs centaines de militaires français avec leurs équipements qui durent
dégager. Nous fûmes dirigés à pied ce qui nous calma, car nous avions les nerfs
à fleur de peau depuis notre arrestation et on vivait dans un état second. On
arriva devant une usine de locomotives de Nantes où nous restâmes trois jours
sans manger, mais nous avions de l'eau. Je fis « durer » une boule de
pain. Nous étions naïfs, on attendait le repas. On était contents d'être en
vie, quand même, car depuis quelques semaines, on avait eu beaucoup de chance.
On fut transféré au camp de Châteaubriant et là les Allemands firent une faute
très grave pour eux Ils nous enlevèrent
les papiers militaires et autres. On pouvait ainsi dire et annoncer faux noms,
fausses adresses et dates de naissance. Certains se mirent des galons et
coupèrent ainsi aux corvées, qui étaient nombreuses. Après trois jours de
« diète », on eût de l'eau chaude graisseuse et un peu de pain avec
une noix de suif. Les Allemands ne s'avisaient pas de traverser le camp la
nuit, même les SS, il y avait des prisonniers rompus à tout. Un dimanche soir
qu'il pleuvait, l'eau terreuse des planches dégoulina dans l'assiette, là je
pleurais. Personne ne se lavait. Je passai 23 jours une première fois et 20
jours une deuxième fois. On s'habitue très bien à ne pas se laver, vous
savez... Faux nom, fausse adresse, je m'appelais Beaudoin Pierre né à Pia, un village frontière dans les Pyrénées-Orientales. A Châteaubriant il y eut
4 camps de 8000 prisonniers soit 32 000 prisonniers, les camps A, B, C et S. J'étais au camp S. Un jour j'entendis un saxo-alto dans le camp. C'était un réserviste parisien de
50 ans. Je lui dis que j'avais un accordéon et qu'on pourrait se réunir. Un
deuxième saxo du
unités
et nous fûmes poussés vers un mur. On nous projeta contre un mur. C'était de
très jeunes soldats qui semblaient capables de faire n'importe quoi. Les gradés
allemands étaient un peu plus âgés. Les camions furent fouillés et nous étions
plusieurs centaines de militaires français avec leurs équipements qui durent
dégager. Nous fûmes dirigés à pied ce qui nous calma, car nous avions les nerfs
à fleur de peau depuis notre arrestation et on vivait dans un état second. On
arriva devant une usine de locomotives de Nantes où nous restâmes trois jours
sans manger, mais nous avions de l'eau. Je fis « durer » une boule de
pain. Nous étions naïfs, on attendait le repas. On était contents d'être en
vie, quand même, car depuis quelques semaines, on avait eu beaucoup de chance.
On fut transféré au camp de Châteaubriant et là les Allemands firent une faute
très grave pour eux Ils nous enlevèrent
les papiers militaires et autres. On pouvait ainsi dire et annoncer faux noms,
fausses adresses et dates de naissance. Certains se mirent des galons et
coupèrent ainsi aux corvées, qui étaient nombreuses. Après trois jours de
« diète », on eût de l'eau chaude graisseuse et un peu de pain avec
une noix de suif. Les Allemands ne s'avisaient pas de traverser le camp la
nuit, même les SS, il y avait des prisonniers rompus à tout. Un dimanche soir
qu'il pleuvait, l'eau terreuse des planches dégoulina dans l'assiette, là je
pleurais. Personne ne se lavait. Je passai 23 jours une première fois et 20
jours une deuxième fois. On s'habitue très bien à ne pas se laver, vous
savez... Faux nom, fausse adresse, je m'appelais Beaudoin Pierre né à Pia, un village frontière dans les Pyrénées-Orientales. A Châteaubriant il y eut
4 camps de 8000 prisonniers soit 32 000 prisonniers, les camps A, B, C et S. J'étais au camp S. Un jour j'entendis un saxo-alto dans le camp. C'était un réserviste parisien de
50 ans. Je lui dis que j'avais un accordéon et qu'on pourrait se réunir. Un
deuxième saxo du
 Havre
se joignit à nous. Manaud le parisien me dit « on va
jouer le soir sous la tente des bureaux du camp ». Le premier soir, beaucoup de
monde. Et Manaud fit la quête dans un calot « il y a
de l'argent dans le camp et du marché noir, on ne va pas se gêner ». On
partagea ce n'était pas de refus. On jouait tous les soirs, et les gardes nazis
assistaient à ses concerts et « crachaient au bassinet » comme tout le monde…Et
une petite idée germa en moi... Il y avait eu deux évasions. Les deux nous
avertirent qu'arrivés chez eux, ils nous diraient ainsi « la mémé est
arrivée avec grand-père qui est souffrant mais pas grave ». Il y avait
quelques évasions…et nous reçûmes par courrier le mot « la mémé est arrivée
avec
Havre
se joignit à nous. Manaud le parisien me dit « on va
jouer le soir sous la tente des bureaux du camp ». Le premier soir, beaucoup de
monde. Et Manaud fit la quête dans un calot « il y a
de l'argent dans le camp et du marché noir, on ne va pas se gêner ». On
partagea ce n'était pas de refus. On jouait tous les soirs, et les gardes nazis
assistaient à ses concerts et « crachaient au bassinet » comme tout le monde…Et
une petite idée germa en moi... Il y avait eu deux évasions. Les deux nous
avertirent qu'arrivés chez eux, ils nous diraient ainsi « la mémé est
arrivée avec grand-père qui est souffrant mais pas grave ». Il y avait
quelques évasions…et nous reçûmes par courrier le mot « la mémé est arrivée
avec
 grand-père
qui est souffrant ». Après plusieurs soirées-musique je commençais à avoir une somme importante. Sur cette fin août 1940 nous fûmes
transférés à la caserne Mellinet de Nantes. De nouveau 48 heures sans
nourriture, mais nous avions un peu d'eau. Début septembre nous fûmes
transporté au camp du Vertou, en Loire-Atlantique, deux nouveaux jours de
diète, mais ôh miracle ! De l’eau à profusion. Nous
avions quand même eu la « chance » de rester trois mois en France,
les Allemands ayant acheminé les prisonniers des régions de France, ce qui nous
avait permis de voir venir... Nous étions les derniers à partir. J'avais lu la
débâcle d'Émile Zola, en 1870, et je n'aurais jamais cru vivre cette chose là.
grand-père
qui est souffrant ». Après plusieurs soirées-musique je commençais à avoir une somme importante. Sur cette fin août 1940 nous fûmes
transférés à la caserne Mellinet de Nantes. De nouveau 48 heures sans
nourriture, mais nous avions un peu d'eau. Début septembre nous fûmes
transporté au camp du Vertou, en Loire-Atlantique, deux nouveaux jours de
diète, mais ôh miracle ! De l’eau à profusion. Nous
avions quand même eu la « chance » de rester trois mois en France,
les Allemands ayant acheminé les prisonniers des régions de France, ce qui nous
avait permis de voir venir... Nous étions les derniers à partir. J'avais lu la
débâcle d'Émile Zola, en 1870, et je n'aurais jamais cru vivre cette chose là.
9-Papy, et puis arrive le 8
septembre 1940 à 9h du matin. Un jour inoubliable, pas du tout comme les
autres. Dites-nous papy ?
 C'est
un dimanche, nous sommes dirigés avec nos gardes nazis vers la gare de Nantes.
Nous montons dans les wagons « 40 hommes 8 chevaux ». Nous sommes 50 hommes par
wagon sans aucun accessoire pour boire, manger ou autre... Beaucoup avaient la
dysenterie. Le train s'ébranle, la chaleur est étouffante dans le wagon fermé.
L'haleine fétide et les odeurs sont incroyables et insoutenables. Il y en a qui
se trouvent mal ou qui font leurs besoins à même le
plancher. Des prisonniers se sont évadés en plongeant dans la Loire. Comme il y
a eu des évasions, les boissons et le pain de la Croix-Rouge nous sont supprimés. Il y a parmi nous des Espagnols, en civil,
qui ont de l'outillage. Il est 22 h 30. Avec l'un d'eux et un adjudant, nous
ouvrons la porte à roulettes pour faire aérer le wagon. Nous refermons à
l'arrêt du train, car des sentinelles guettent sur les miradors qui surplombent
les wagons. Le train repart vers le Mans et je profite de la vitesse du train,
à 50 km/h environ, pour lancer une poussée à
l’adjudant « tu vas te faire tuer » me dit-il. C'était une excitation et les
nerfs à fleur de peau, le coeur battait la chamade. Je dévale le talus en
roulé-boulé, traînant avec moi l'instrument et ma boîte à rasoir. Le train
passait toujours et je priais tous les saints du paradis pendant 30 secondes à
genoux. La boîte à rasoir fût reconstitué et je fus interpellé par un bonhomme,
lampe tempête en main : « qui est là ? ». Je vis un civil et lui
racontais la chose. « Allez à
C'est
un dimanche, nous sommes dirigés avec nos gardes nazis vers la gare de Nantes.
Nous montons dans les wagons « 40 hommes 8 chevaux ». Nous sommes 50 hommes par
wagon sans aucun accessoire pour boire, manger ou autre... Beaucoup avaient la
dysenterie. Le train s'ébranle, la chaleur est étouffante dans le wagon fermé.
L'haleine fétide et les odeurs sont incroyables et insoutenables. Il y en a qui
se trouvent mal ou qui font leurs besoins à même le
plancher. Des prisonniers se sont évadés en plongeant dans la Loire. Comme il y
a eu des évasions, les boissons et le pain de la Croix-Rouge nous sont supprimés. Il y a parmi nous des Espagnols, en civil,
qui ont de l'outillage. Il est 22 h 30. Avec l'un d'eux et un adjudant, nous
ouvrons la porte à roulettes pour faire aérer le wagon. Nous refermons à
l'arrêt du train, car des sentinelles guettent sur les miradors qui surplombent
les wagons. Le train repart vers le Mans et je profite de la vitesse du train,
à 50 km/h environ, pour lancer une poussée à
l’adjudant « tu vas te faire tuer » me dit-il. C'était une excitation et les
nerfs à fleur de peau, le coeur battait la chamade. Je dévale le talus en
roulé-boulé, traînant avec moi l'instrument et ma boîte à rasoir. Le train
passait toujours et je priais tous les saints du paradis pendant 30 secondes à
genoux. La boîte à rasoir fût reconstitué et je fus interpellé par un bonhomme,
lampe tempête en main : « qui est là ? ». Je vis un civil et lui
racontais la chose. « Allez à
 la
première maison que vous trouverez ». « Merci Monsieur». J'allais vers une
maison, mais j’étais en militaire et rentrais dans un hangar. Au bout d'un
moment, m'accoutumant à l'obscurité, je devinais des équipements de soldats
allemands. Je filais à la maison en face et là un chien forcené aboyait. Des
gens se levèrent. J'expliquais. Un peu plus tard, j'entendis les Allemands qui
revenaient de l'auberge où l'on fêtait la victoire. Je passais la nuit sur une
brouette, il y avait 10 mois que je n'avais pas couché dans un lit. Le
lendemain, je troquais ma vareuse militaire contre une tenue civile de
loqueteux, mais les gens m'invitèrent au déjeuner. On aurait dit un vagabond.
Je partis du Mans et fis à pied la fameuse ligne droite des Hunaudières des « 24 h du Mans » et arrivais à Château du Loir, un automobiliste,
faisant du cinéma pour les troupes d'occupation, m'ayant porté durant 25 km. Je
couchais dans un lit après 10 mois de paille ou autre. J'avais 200 lettres
remises par une aubergiste d'Écommoy, Mme Crie, que je gardais pour la zone
libre. Miracle, la dysenterie avait disparu. Je mangeais des pommes. Je pris le
train jusqu'à Tours, partageant le compartiment avec des moines. A Tours, les
ponts avaient sauté et le train roula au pas sur la traversée de la Loire. Puis
je marchais vers Ste Maure et la route de Montbazon. « C’est loin la ligne de
démarcation ? » 10 km. Pour me faire servir, j'arborais à la main un billet de
10 F. Beauvais, Batilly, et en zone libre Rouvres. Je déposais les lettres de
Mme Crie. Je dus aller me faire démobiliser à Nîmes, car à Loches et à Limoges,
on voulait me garder vu mon âge. Immanquablement le chef de poste me précisait
« moi je ne vous ai pas vu ». Qu'est devenu le wagon ? Je ne le saurais jamais.
la
première maison que vous trouverez ». « Merci Monsieur». J'allais vers une
maison, mais j’étais en militaire et rentrais dans un hangar. Au bout d'un
moment, m'accoutumant à l'obscurité, je devinais des équipements de soldats
allemands. Je filais à la maison en face et là un chien forcené aboyait. Des
gens se levèrent. J'expliquais. Un peu plus tard, j'entendis les Allemands qui
revenaient de l'auberge où l'on fêtait la victoire. Je passais la nuit sur une
brouette, il y avait 10 mois que je n'avais pas couché dans un lit. Le
lendemain, je troquais ma vareuse militaire contre une tenue civile de
loqueteux, mais les gens m'invitèrent au déjeuner. On aurait dit un vagabond.
Je partis du Mans et fis à pied la fameuse ligne droite des Hunaudières des « 24 h du Mans » et arrivais à Château du Loir, un automobiliste,
faisant du cinéma pour les troupes d'occupation, m'ayant porté durant 25 km. Je
couchais dans un lit après 10 mois de paille ou autre. J'avais 200 lettres
remises par une aubergiste d'Écommoy, Mme Crie, que je gardais pour la zone
libre. Miracle, la dysenterie avait disparu. Je mangeais des pommes. Je pris le
train jusqu'à Tours, partageant le compartiment avec des moines. A Tours, les
ponts avaient sauté et le train roula au pas sur la traversée de la Loire. Puis
je marchais vers Ste Maure et la route de Montbazon. « C’est loin la ligne de
démarcation ? » 10 km. Pour me faire servir, j'arborais à la main un billet de
10 F. Beauvais, Batilly, et en zone libre Rouvres. Je déposais les lettres de
Mme Crie. Je dus aller me faire démobiliser à Nîmes, car à Loches et à Limoges,
on voulait me garder vu mon âge. Immanquablement le chef de poste me précisait
« moi je ne vous ai pas vu ». Qu'est devenu le wagon ? Je ne le saurais jamais.
10-Papy, à ce stade de
l’émission, pourriez-vous nous parler de la peur ? De vos peurs ?
On a surtout peur avant l’action,
l'attente est plus mauvaise que l'action. On a surtout la peur rétrospective,
si l’on peut dire, c'est tellement rapide. J’eus une peur avec un déplacement
de batteries, peut être la pire peur de toute la guerre. Étant chef de voiture
avec chauffeur et aide-chauffeur, notre camion
transportant obus, poudre noire et étoupilles tombe en panne. Le chef de
colonne décida de nous remorquer en montant un petit col, dans les contreforts
des Vosges. Tant que la route montait, le cordage, nous traînant faisait bien
son office. Nous passâmes le sommet et le camion qui nous tirait, alla de
suite, trop vite, nous usâmes nos freins qui se mirent à fumer... On cria, on
gueula... mais les camions faisant pas mal de bruit, on ne nous entendit pas.
Nous nous arrêtâmes à 20 cm du parapet d'un pont
enjambant le canal du Rhône au Rhin d’une hauteur de 25 mètres après un choc
violent sur le camion qui nous tirait. Si jamais le camion avait chuté dans le
vide, quel feu
 d'artifice
! On aurait été porté disparus. Tremblant tous les trois, nous ne pouvions pas
parler. Étant chef de voiture, je refusais de repartir qu'avec un tracteur
d'artifice
! On aurait été porté disparus. Tremblant tous les trois, nous ne pouvions pas
parler. Étant chef de voiture, je refusais de repartir qu'avec un tracteur
 Latil muni de barres d'entraînement. On fit du 40 à
l'heure, mais en toute sécurité. Une autre peur : dans les environs de
Gisors, nous étions dans des bois touffus, on voyait passer des avions
allemands à 50 mètres au-dessus. Était-ce pour nous ? Non ! J’enviais presque
l'infanterie qui était protégée par les arbres et pouvait, en un instant, se
camoufler dans les sentiers. Nous, nos unités ne circulaient que sur les routes
pouvant supporter des tonnes, et à la vue des avions avec ce que nous
transportions ! Il y eu du dégât, mais on eût beaucoup de chance, notre unité
semblant intacte. Une autre fois à Bourgtheroulde,
nous avions plongés dans des orties, la peur... les avions en passant au-dessus...
Latil muni de barres d'entraînement. On fit du 40 à
l'heure, mais en toute sécurité. Une autre peur : dans les environs de
Gisors, nous étions dans des bois touffus, on voyait passer des avions
allemands à 50 mètres au-dessus. Était-ce pour nous ? Non ! J’enviais presque
l'infanterie qui était protégée par les arbres et pouvait, en un instant, se
camoufler dans les sentiers. Nous, nos unités ne circulaient que sur les routes
pouvant supporter des tonnes, et à la vue des avions avec ce que nous
transportions ! Il y eu du dégât, mais on eût beaucoup de chance, notre unité
semblant intacte. Une autre fois à Bourgtheroulde,
nous avions plongés dans des orties, la peur... les avions en passant au-dessus...
Une autre peur : à deux heures du matin descendant de la camionnette avec nos armes, un coup de feu sifflant partit. On se coucha, les coeurs battaient à tout rompre. Plus rien... Au bout d'un moment, l’un de nous déclara « F de P », j'ai accroché la gâchette et le coup est parti. On respira...
D'autre peurs encore à la rencontre à Carquefou avec la FLAK allemande servie par des jeunes énervés qui semblaient être capables de tout faire …Au camp de Châteaubriant avec les balles traçantes lumineuses qui nous passaient au-dessus. Ils fêtaient la victoire, avec parfois un peu ou beaucoup d'alcool... Ce n’est pas grand-chose, à côté de ce qu'ont du endurer, pendant quatre ans, nos aînés de 14-18. Dans ces moments-là, on n'a qu'un seul souci, c'est s'en sortir, le reste n'existe pas.
11-Papy, je sais que vous avez
une mémoire phénoménale des dates, qui jalonnent nos vies. Le 16 septembre
1940, huit jours après votre évasion et votre longue marche, c’est le
retour au pays. Comment cela s’est-il passé ?
 J’avais
fait trois ans, soit un an et 15 jours de plus que le service militaire normal
à cette époque. Quand je revins à Pau ce 16 septembre 1940 en train, je n'étais
pas présentable. J'évitais en ville des gens qui auraient pu me connaître
surtout des filles, baissant la tête ou la tournant de côté. J’étais pire qu’un
mendiant. J'ai filé chez ma soeur qui pleura et me prêta un vélo pour arriver à Sendets…Maman en larmes, me serra à m’étouffer et mon
frère Ado qui travaillait, riait et pleurait à la fois. Petit à
J’avais
fait trois ans, soit un an et 15 jours de plus que le service militaire normal
à cette époque. Quand je revins à Pau ce 16 septembre 1940 en train, je n'étais
pas présentable. J'évitais en ville des gens qui auraient pu me connaître
surtout des filles, baissant la tête ou la tournant de côté. J’étais pire qu’un
mendiant. J'ai filé chez ma soeur qui pleura et me prêta un vélo pour arriver à Sendets…Maman en larmes, me serra à m’étouffer et mon
frère Ado qui travaillait, riait et pleurait à la fois. Petit à
 petit,
je me refis une petite santé car à 21 ans et demi, on a du ressort et des
ressources. J'eus une crise d'eczéma sérieux et un assaut de rhumatisme qui me
fit peur. On avait eu la chaleur d'abord, puis la pluie et l'humidité dans les
camps. J’eus une joie en prenant possession de l'accordéon que M. Jean Soncarrieu possédait et qui mourut en 1940 à 46 ans. Il
avait 20 ans en 1914, la belle époque, et fit toute la campagne ; il fut usé
par cette guerre qui tua beaucoup de jeunes qui avaient eu la chance de s'en
sortir... Mon sommeil était troublé, je rêvais que j'étais prisonnier et
réveillé en sursaut, mais que je me retrouvais heureux... Libre !
petit,
je me refis une petite santé car à 21 ans et demi, on a du ressort et des
ressources. J'eus une crise d'eczéma sérieux et un assaut de rhumatisme qui me
fit peur. On avait eu la chaleur d'abord, puis la pluie et l'humidité dans les
camps. J’eus une joie en prenant possession de l'accordéon que M. Jean Soncarrieu possédait et qui mourut en 1940 à 46 ans. Il
avait 20 ans en 1914, la belle époque, et fit toute la campagne ; il fut usé
par cette guerre qui tua beaucoup de jeunes qui avaient eu la chance de s'en
sortir... Mon sommeil était troublé, je rêvais que j'étais prisonnier et
réveillé en sursaut, mais que je me retrouvais heureux... Libre !
En revenant à Sendets, j'avais décelé un changement dans la population. La presse, une feuille recto-verso, malgré la zone dite libre, était aux mains des Allemands et de trop d'admirateurs français. Les gens suivaient, du moment que c'était sur « le journal ». Il y avait n’importe quoi, par exemple, la guerre avait été voulue et déclarée par les Anglais. Rien que ça ! Je m'étais fait une opinion et ne parlais plus de rien. Quelques épouses de prisonniers trouvaient injuste, ça se comprend, que quelques jeunes, anciens prisonniers, soient libres alors que leurs maris étaient là-bas.
12-Papy, vous avez beaucoup
travaillé dans votre vie, vous allez maintenant nous parler de vos périodes d'activités,
de « travail » : on peut les décomposer en trois parties. Une
première de 13/14 ans jusqu’à votre incorporation à 18 ans et demi, ensuite,
après votre évasion, à la mairie de Pau et enfin à la « Sociale », à
la « Sécurité Sociale » un peu plus tard. Commençons par la période
de vos 13 à 18 ans, vous l’avez déjà un peu abordée, puisqu’elle se superpose
avec celle de votre jeunesse.
Oui, comme je l’ai dit, en mars
1932, je partis à Pau comme garçon de courses, où je restais la semaine.
Travaillant dans des conditions qui étaient le lot de beaucoup, il fallait
travailler vite et bien. On était malmenés ou engueulés surtout la période où
nous débutions. Il faut reconnaître qu'on ne savait pas s'y prendre, quand
même, mais nous faisions des progrès énormes, en très peu de temps. Selon le
mot de l'enseignant monsieur Latapie, il y avait les
adroits et les maladroits. Il fallait reconnaître que nos patrons avaient des
contraintes,
 travaillant
beaucoup et nous donnant l'exemple, étant eux-mêmes soumis à des cadences
rapides et à des responsabilités
travaillant
beaucoup et nous donnant l'exemple, étant eux-mêmes soumis à des cadences
rapides et à des responsabilités
 générales
sévères. À partir de 9 ou 10 ans, nos parents nous occupaient et savaient
commander. Mon père était assez sévère. Il y avait deux choses à
distinguer : celles qu'on peut faire et celles qu'on ne doit pas faire. Il
voyait clair, ne nous laissant pas souvent sans rien faire, jardin, balayages,
commissions, aidant à la plonge, quillier de neuf à remettre en état, servir
les pensionnaires, chercher le pain, le tabac au bureau pour les clients. On
fréquentait l'église, messes, vêpres par n'importe quel temps catéchisme,
histoire sainte. Dès la petite enfance on avait « l'empreinte »,
c'était le lot de toutes les familles qui participaient. De ce fait, les
nouvelles du village se propageaient par cette fréquentation. Mais l'hiver, c'était pas de chauffage. L'auberge, le dimanche, était
classé « garage à vélos 30 ou 40 vélos ». Et tout le monde prenait
l'apéritif. On jouait aux quilles de 6 ou de 9. Papa nous quitta en 1935 alors
que j'avais 16 ans, maman a su réagir et fut très efficace.
générales
sévères. À partir de 9 ou 10 ans, nos parents nous occupaient et savaient
commander. Mon père était assez sévère. Il y avait deux choses à
distinguer : celles qu'on peut faire et celles qu'on ne doit pas faire. Il
voyait clair, ne nous laissant pas souvent sans rien faire, jardin, balayages,
commissions, aidant à la plonge, quillier de neuf à remettre en état, servir
les pensionnaires, chercher le pain, le tabac au bureau pour les clients. On
fréquentait l'église, messes, vêpres par n'importe quel temps catéchisme,
histoire sainte. Dès la petite enfance on avait « l'empreinte »,
c'était le lot de toutes les familles qui participaient. De ce fait, les
nouvelles du village se propageaient par cette fréquentation. Mais l'hiver, c'était pas de chauffage. L'auberge, le dimanche, était
classé « garage à vélos 30 ou 40 vélos ». Et tout le monde prenait
l'apéritif. On jouait aux quilles de 6 ou de 9. Papa nous quitta en 1935 alors
que j'avais 16 ans, maman a su réagir et fut très efficace.
13-Papy, la deuxième période
se situe après votre évasion et votre retour en Béarn. Quels souvenirs
en gardez-vous ?
J'entrais à la mairie de Pau à 22
ans et demi en 1941, pour le « ravitaillement ». J'avais acquis une
certaine maturité, comme tout un chacun à cet âge. L'armée et la guerre avaient
été assez présentes pour cela. J'écoutais, je voulais sortir un peu de cette
discipline qui s'était instaurée en moi. J'avais mon idée sur la politique,
mais je
 n'en
parlais pas. Comme j'étais depuis toujours pratiquant de la
« calotte », j'avais des idées autres, de ceux qui
« seuls » parlaient des pauvres, des petites gens. Je bouffais à deux
râteliers, mais j'étais prudent et tolérant. Le travail à la mairie de Pau
m'occupait, ainsi que l'aide à mon frère Ado à la mairie du village. Il fallait
aussi se méfier, car en 1942, il ne faisait pas bon parler, la France étant
divisée en deux. Ayant connu le Frontstalag, je ne
voulais pas risquer, quoique ce soit, après cela. Il y avait les riches et les
pauvres, qui pour quelques-uns étaient des fainéants, ils ne voulaient plus
travailler ! En fin d’année 43 quand le vent tourna de l'autre côté, tant
n'en
parlais pas. Comme j'étais depuis toujours pratiquant de la
« calotte », j'avais des idées autres, de ceux qui
« seuls » parlaient des pauvres, des petites gens. Je bouffais à deux
râteliers, mais j'étais prudent et tolérant. Le travail à la mairie de Pau
m'occupait, ainsi que l'aide à mon frère Ado à la mairie du village. Il fallait
aussi se méfier, car en 1942, il ne faisait pas bon parler, la France étant
divisée en deux. Ayant connu le Frontstalag, je ne
voulais pas risquer, quoique ce soit, après cela. Il y avait les riches et les
pauvres, qui pour quelques-uns étaient des fainéants, ils ne voulaient plus
travailler ! En fin d’année 43 quand le vent tourna de l'autre côté, tant
 espéré,
la « France d'en haut » retourna sa veste du bon côté. Les résistants
furent nombreux en 1945. Quelques mariages, pas mal de décès, chômage pour
quelques-uns, le souci du ravitaillement, les soucis de santé, il y avait
beaucoup moins de médecins. Les assurances sociales créées en 1930 étaient
inconnues pour certains qui n'allaient chez un médecin que quand c'était
sérieux ou trop tard. Il restait pas mal d'illettrés. Plus tard en d'autres
circonstances, j'avais été surpris de voir trop de gens ne sachant pas signer
leur nom. On leur faisait marquer les pièces comptables par une croix et nous
ajoutions : « ne sait pas signer ».
espéré,
la « France d'en haut » retourna sa veste du bon côté. Les résistants
furent nombreux en 1945. Quelques mariages, pas mal de décès, chômage pour
quelques-uns, le souci du ravitaillement, les soucis de santé, il y avait
beaucoup moins de médecins. Les assurances sociales créées en 1930 étaient
inconnues pour certains qui n'allaient chez un médecin que quand c'était
sérieux ou trop tard. Il restait pas mal d'illettrés. Plus tard en d'autres
circonstances, j'avais été surpris de voir trop de gens ne sachant pas signer
leur nom. On leur faisait marquer les pièces comptables par une croix et nous
ajoutions : « ne sait pas signer ».
En 1942, mon frère s'étant marié,
le maire de Sendets, Jean Cazaban me demanda si je voulais continuer à m'occuper de la mairie. J'acceptais, mais
ceci en plus de tout le reste, travail à la mairie de Pau en vélo, auberge des
pensionnaires, mairie de Sendets avec les cartes
d'alimentation qui tous les mois étaient distribuées à 95 foyers, réunions du
conseil municipal devant fournir tant de produits, céréales, bêtes etc.. Je fus
très occupé... En vélo tous les jours, par n'importe quel temps, c'était le lot
de tous ceux qui travaillaient à Pau. Les pneus de vélo nous causèrent à tous
des problèmes, ils n'étaient pas bons, coûtant souvent le prix d’un mois de
travail et duraient très peu. J'éclatais souvent et ne m’arrêtais même
 pas
avec les vieux pneus-enveloppes. J'allais deux jours
à Pau avec des jantes en bois. J'étais quelquefois arrêté par le poste allemand
de la bifurcation, Auchan actuellement. Je présentais mon laissez-passer au
gradé, qui voyant la mairie de Pau, me saluait et m’indiquait que je pouvais
partir.
pas
avec les vieux pneus-enveloppes. J'allais deux jours
à Pau avec des jantes en bois. J'étais quelquefois arrêté par le poste allemand
de la bifurcation, Auchan actuellement. Je présentais mon laissez-passer au
gradé, qui voyant la mairie de Pau, me saluait et m’indiquait que je pouvais
partir.
Heureusement les soirs d'été, la jeunesse, les copains venaient au centre mairie, quelques filles aussi, l'angélus de rigueur étant toujours là…bals interdits, extinction des feux, interdiction de circuler avec le couvre-feu. On fit du rugby durant 1943. L'obésité était inconnue au village et partout. L'outillage agricole ou jardinier était un tant soit peu comme au Moyen Âge. N'empêche qu'on cultivait « sec » pour suppléer à tout ce qui manquait, car depuis la débâcle de 1940, il avait fallu s'accrocher, se débrouiller. Nous dans les campagnes, nous étions favorisés en cultivant, en jardinant. On n'était pas envieux, on se contentait de peu, on n'aurait pas osé espérer une voiture, cette question ne nous effleurait pas.
 14-Papy,
après un passage rapide à la mairie de Pau, c’est une 3ème et longue
période de travail qui va se dérouler à la « Sociale ».
14-Papy,
après un passage rapide à la mairie de Pau, c’est une 3ème et longue
période de travail qui va se dérouler à la « Sociale ».
Le 15 juillet 1943 je changeais
de travail, d'auxiliaire à la mairie je passais titulaire à la Caisse
d’Assurances Sociales, titulaire au bout
de six mois. Je n’eus pas de vacances
 cette
année-là. Puis nous fûmes en 1944, tout continuait comme avant, mais avec
l'espoir que bientôt ça risquait de s'accélérer. Les radios de Londres nous
renseignaient. On s'était habitués à cette pénurie. Les magasins étaient vides,
mais le marché noir et le troc s'étaient généralisés. Le 6 juin 1944 fut une
sorte de joie contenue. On pensa à ces combattants qui se battaient pour la
liberté, avec un serrement de coeur... On avait connu cela... Mais ils
pouvaient avoir l'espoir de la victoire, alors que nous... Nous avions eu
affaire à l'armée nazie, après l'invasion de la Pologne en 1939. Cette armée
nazie intacte, des jeunes de l'armée active sous les drapeaux, dotés d’un matériel
motorisé moderne, extrêmement mobile, puissant, efficace. Ces jeunes nazis
étaient supers entraînés, conditionnés par leurs dirigeants, chefs exerçant sur
eux, une discipline de fer.
cette
année-là. Puis nous fûmes en 1944, tout continuait comme avant, mais avec
l'espoir que bientôt ça risquait de s'accélérer. Les radios de Londres nous
renseignaient. On s'était habitués à cette pénurie. Les magasins étaient vides,
mais le marché noir et le troc s'étaient généralisés. Le 6 juin 1944 fut une
sorte de joie contenue. On pensa à ces combattants qui se battaient pour la
liberté, avec un serrement de coeur... On avait connu cela... Mais ils
pouvaient avoir l'espoir de la victoire, alors que nous... Nous avions eu
affaire à l'armée nazie, après l'invasion de la Pologne en 1939. Cette armée
nazie intacte, des jeunes de l'armée active sous les drapeaux, dotés d’un matériel
motorisé moderne, extrêmement mobile, puissant, efficace. Ces jeunes nazis
étaient supers entraînés, conditionnés par leurs dirigeants, chefs exerçant sur
eux, une discipline de fer.
A la « Sociale », dans
ces périodes, ce n’était pas facile au guichet. Sortant de la guerre, des
privations, très souvent malades, longtemps traqués par les « Chleus », les assurés rouspétaient et gueulaient
souvent très fort, mais il y avait des jours où tout allait bien. Il n’était
pas question de faire tenir le guichet par des femmes qui souvent y pleuraient.
Il y avait une exception, la Lily qui était active, compétente et qui répondait
du tac au tac. Et cela dura
 jusqu’en
1950, où je fus muté au contrôle médical. Il y avait des clans, des rivalités,
des jalousies nées de beaucoup de choses. Les sportifs et les demi artistes
comme moi, nous passions pour des « pas sérieux », mais quand même,
nous étions aimés, à peu près, de tous. Puis je fus muté au service
Immatriculations, et je suis parti en retraite à 60 ans le 5 octobre 1978. En
définitive, je
jusqu’en
1950, où je fus muté au contrôle médical. Il y avait des clans, des rivalités,
des jalousies nées de beaucoup de choses. Les sportifs et les demi artistes
comme moi, nous passions pour des « pas sérieux », mais quand même,
nous étions aimés, à peu près, de tous. Puis je fus muté au service
Immatriculations, et je suis parti en retraite à 60 ans le 5 octobre 1978. En
définitive, je
 détenais
47 années de salariat, avec les années de guerre.
détenais
47 années de salariat, avec les années de guerre.
Entre temps, j’avais trouvé le temps de me marier le 23 juin 1945, un mois et demi après la fin de la guerre. Il faut préciser que comme moitié, j’ai tiré le bon numéro, mon épouse Marie depuis 62 ans et qui n’a que 86 ans. Notre fille est née en 1946, et notre fils en 1949 mais hélas décédé d’une maladie orpheline en 1998 en laissant deux jeunes enfants. La famille est précieuse et très importante pour nous, nous avons quatre petits-enfants, que des garçons et Camille, une arrière petite-fille.
15- Papy, vous avez évoqué, à
quelques détours, une de vos grandes passions : la musique. Aussi
il est temps d’y revenir plus longuement. Papy, je vous propose de dérouler
cette passion en partant du début.
Monsieur Germain Latapie, notre instituteur était un excellent musicien et
en 1919, à Sendets il avait monté une petite harmonie
musicale « l'avenir de Sendets ». C'était sa
deuxième harmonie après celle de Saint-Médard. Il
dispensait l'enseignement du solfège. Le curé du village, poussé par quelques
biens pensants, prit ombrage de cette phalange musicale. C'était
« républicains » contre la calotte, et la lutte. Le
 curé
décida d'exclure de la communion solennelle quatre enfants, dont deux étaient
pupilles de la nation, c’est-à-dire fils de tués de la guerre 14-18. C'était
quand même les meilleurs éléments en classe et en études musicales. Que de
salive fut ainsi dépensée ! La dernière sortie de la musique « l’avenir de Sendets » fut le 15 août 1933. Cette année-là, les
conscrits « baladiers » de la fête du 15
août 1933 voulurent reconstituer pour un jour la musique : hélas trop jeune
pour avoir pu participer à cette harmonie, je fis quand même partie de la
répétition la veille à l'école.
curé
décida d'exclure de la communion solennelle quatre enfants, dont deux étaient
pupilles de la nation, c’est-à-dire fils de tués de la guerre 14-18. C'était
quand même les meilleurs éléments en classe et en études musicales. Que de
salive fut ainsi dépensée ! La dernière sortie de la musique « l’avenir de Sendets » fut le 15 août 1933. Cette année-là, les
conscrits « baladiers » de la fête du 15
août 1933 voulurent reconstituer pour un jour la musique : hélas trop jeune
pour avoir pu participer à cette harmonie, je fis quand même partie de la
répétition la veille à l'école.
Mais c’est bien cette harmonie
qui a déclenché la musicomanie chez moi. Le jour où
j’entendis la musique, la petite musique
 de Sendets, ce fut un des plus beaux jours de mon
enfance, ce fut la lumière. Déjà en 1924, à 6 ans, je traînais mon père, au
moment des répétitions, pour venir écouter la musique au dehors. Comme quoi !
Je fus contaminé d'une manière généralisée et irréversible... Définitivement
depuis plus de 80 ans.
de Sendets, ce fut un des plus beaux jours de mon
enfance, ce fut la lumière. Déjà en 1924, à 6 ans, je traînais mon père, au
moment des répétitions, pour venir écouter la musique au dehors. Comme quoi !
Je fus contaminé d'une manière généralisée et irréversible... Définitivement
depuis plus de 80 ans.
Et je fus tout de suite conquis à la pratique d'un instrument, et je m’en fis prêter plusieurs : flûte piccolo, saxo-alto, saxo baryton, batterie. Je travaillais tout seul un saxo-alto, issu de la dissolution des régiments tarbais. Les notes graves ne sortaient pas, ne pouvaient pas sortir ! Si vous aviez vu la bobine de ce saxo alto ? Etant assez adroit dans la pratique instrumentale, je fis très vite des progrès. J'ai aussi assimilé assez vite l'accordéon et en 1934 - 1935, je faisais le carnaval de Sendets. En 1937, j'achetais un accordéon que mon beau-frère m'aida à payer en avançant l'argent.
En 1937, je partis au régiment, et au bout de trois semaines, je revins chercher l’instrument pour accompagner les soldats chanteurs sur la scène à la caserne Nansouty de Bordeaux. Par la suite, en Alsace, là aussi on trouva de nouveaux éléments, beaucoup de professionnels. J'appris beaucoup au contact d'excellents musiciens, ça me plaisait. On faisait du théâtre aux armées, des vedettes mobilisées passaient. Et puis, j’ai déjà longuement évoqué la musique au camp de prisonniers de Châteaubriand, et mon évasion avec mon accordéon.
Après ma démobilisation, je
revins chez moi, travaillant la musique après mes huit heures de travail
journalier à la boîte. Il y eut quelques séances récréatives pour les
 prisonniers,
mais c'était très peu d'activités au plan musical. Vers 1943, sur l'instigation
de jeunes et surtout de jeunes filles, on commença à faire des bals
clandestins. Les danseurs auraient dansé n'importe quoi, n'importe où, n'importe
comment. Les organisateurs faisaient une quête et me vidaient le contenu dans
ma poche, sans compter. Il faut avoir vécu cette période pour le croire, les
gens n'avaient plus dansé depuis presque quatre ans. C'était incroyable et
fabuleux, mais dangereux.
prisonniers,
mais c'était très peu d'activités au plan musical. Vers 1943, sur l'instigation
de jeunes et surtout de jeunes filles, on commença à faire des bals
clandestins. Les danseurs auraient dansé n'importe quoi, n'importe où, n'importe
comment. Les organisateurs faisaient une quête et me vidaient le contenu dans
ma poche, sans compter. Il faut avoir vécu cette période pour le croire, les
gens n'avaient plus dansé depuis presque quatre ans. C'était incroyable et
fabuleux, mais dangereux.
16-Et à la fin de la guerre,
Papy, comment avez-vous poursuivi cette passion de la musique ?
Quand la guerre prit fin,
aussitôt je fus embrigadé dans un petit orchestre. Puis au palais des Pyrénées,
nous étions 10 éléments faisant danser 5 à 6000 personnes jusqu’à une heure du
matin. En 1946, il y eut une éclosion de petites boîtes, faisant instrumenter
des musiciens en trio avec piano
 et
batterie comme instruments de base. Sur les incitations de collègues musiciens,
j’ai acheté un bandonéon diatonique : c’est un instrument magnifique mais
c'était presque de la folie, de la compétition de haut niveau, cela
correspondait à jouer sur quatre claviers à quatre doigtés incroyables,
complètement différents. J'ai joué de cet instrument de 1946 à 1958, arrivant à
faire des variations, chose que je n'aurais jamais envisagée au début. J’ai acheté par la suite
et
batterie comme instruments de base. Sur les incitations de collègues musiciens,
j’ai acheté un bandonéon diatonique : c’est un instrument magnifique mais
c'était presque de la folie, de la compétition de haut niveau, cela
correspondait à jouer sur quatre claviers à quatre doigtés incroyables,
complètement différents. J'ai joué de cet instrument de 1946 à 1958, arrivant à
faire des variations, chose que je n'aurais jamais envisagée au début. J’ai acheté par la suite
 d’autres
instruments : bando chromatique, clarinette,
flûte, etc…En 1947, j’entrais à la musique municipale
de Pau, qui se reformait dont le chef provisoire était Léonard Souverbie, qui avait joué 30 ans à l'orchestre des Folies-Bergères à Paris. Ce fut pour moi un excellent
travail durant ces trois années de répétitions, concerts, services, qui me fit acquérir du métier, de la maîtrise de la
lecture, du mécanisme aux saxos. Je quittais cette formation en 1950, pour
faire 16h de musiques payées, avec tout ce que cela comporte, en dancing,
jouant les jeudi et samedi soir, le dimanche après-midi et soir par séries de
quatre heures. L'orchestre de danse fut prioritaire, car avec la répétition du
mardi, le concert du vendredi, je partais cinq soirs par semaine. Madame était
compréhensive, mais il y avait des limites qu'il valait mieux ne pas dépasser.
d’autres
instruments : bando chromatique, clarinette,
flûte, etc…En 1947, j’entrais à la musique municipale
de Pau, qui se reformait dont le chef provisoire était Léonard Souverbie, qui avait joué 30 ans à l'orchestre des Folies-Bergères à Paris. Ce fut pour moi un excellent
travail durant ces trois années de répétitions, concerts, services, qui me fit acquérir du métier, de la maîtrise de la
lecture, du mécanisme aux saxos. Je quittais cette formation en 1950, pour
faire 16h de musiques payées, avec tout ce que cela comporte, en dancing,
jouant les jeudi et samedi soir, le dimanche après-midi et soir par séries de
quatre heures. L'orchestre de danse fut prioritaire, car avec la répétition du
mardi, le concert du vendredi, je partais cinq soirs par semaine. Madame était
compréhensive, mais il y avait des limites qu'il valait mieux ne pas dépasser.
Et je continuai ensuite à faire du dancing : Casino ambassadeur, Petit casino, Fosse du théâtre ou cinéma du Casino, Continental, Pergola, Terminus, Brasserie des Pyrénées, de l'Aragon, Hôtel de France, Cafés Restaurants, Café Nabas, Salle des fêtes de Bizanos, de Billère, etc… je connaissais presque tous les morceaux devant être joués, j'ai de la mémoire musicale et l'habitude de jouer carton ou oreille. Nous faisions pas mal de noces. Les mariages au pays basque, ah c'était quelque chose de considérable.
Je fis mes adieux à la musique de
danse le 3 août 1972. J’avais 54 ans et j’en avais assez. Depuis quelques
années, il m'était très dur de partir. J'ai totalisé 2477 journées d'activités
de huit heures souvent prises sur les repos ou les loisirs, ce qui occasionnait
pas mal de fatigue. Et ici, ce qui est prépondérant, c’est d'éviter les excès
de toutes sortes, ce qui est très difficile, car on côtoie des gens qui
s'amusent, prêts à boire, à manger et à vous inviter. J'ai instrumenté avec les
orchestres suivants : « Chouett », Ray
Dupont, André Castagnet, Maurice Séby,
Pierre Jacques (c’est moi), Jean Glorieux, Jacques Huet, Cady Verez, Sarrazin à Bagnères,
« Pépé Nunca » à Oloron, Pierre Louis, Bob Curtis. Veiller la nuit, c’est quelque chose de très dur,
assez atroce. J’ai longtemps craint que, d'avoir beaucoup veillé, n'ait une
 incidence
sur ma santé future, mais je suis encore là.
incidence
sur ma santé future, mais je suis encore là.
De décembre 1973 jusqu’en
novembre 1998, j'ai joué à l'harmonium de l'église de Sendets avec les abbés successifs Nabias, Labat et Vacher.
J'ai terminé ma musique à l'église en
 novembre
1998, à 80 ans soit 25 années d' « organiste » qui correspond à
quelques 1300 séances. Si, après cela, l'éternel ne nous fait pas une petite
place... malgré mes limites. D'octobre 1988 à 1998 j'ai aussi fréquenté notre
chorale inter paroissiale.
novembre
1998, à 80 ans soit 25 années d' « organiste » qui correspond à
quelques 1300 séances. Si, après cela, l'éternel ne nous fait pas une petite
place... malgré mes limites. D'octobre 1988 à 1998 j'ai aussi fréquenté notre
chorale inter paroissiale.
Actuellement pour mon plaisir je joue 20 minutes à une demi-heure au plus par jour, après ce laps de temps je sens que ça devient un travail. En résumé j'ai effectué 10 000 h de bals sur l'estrade avec presque tous les instruments musicaux existants. Je n'ai pas compté les bals que je faisais quand j'étais célibataire, ni les séances avec le big band de Domengé après ma cessation de 1972. Durant cette longue période j'ai remarqué qu'après une heure de musique, on est chaud et on peut alors faire de la virtuosité. Et je suis d’accord avec les soeurs Labèque de Bayonne, concertistes internationales et universellement connues, qui résument bien en disant que la musique, c’est 1 % de talent et 99 % de travail.
17-Merci Papy pour ce survol
musical du siècle, qui aurait mérité à lui seul, toute une série d’émissions.
Parlons maintenant un peu des autres engagements.
 Depuis
l'année 1973 à 55 ans, ayant cessé le gros travail musical que je pratiquais en
plus de mon travail à la Sécurité Sociale, je décidais de participer au comité
des fêtes et à la marche de l'Union Sportive de Sendets.
Durant neuf ans, donc jusqu'en 1982 c’est une succession de réunions,
rassemblements, matchs qu'il fallait chaperonner, et parfois calmer de jeunes
coqs énervés.
Depuis
l'année 1973 à 55 ans, ayant cessé le gros travail musical que je pratiquais en
plus de mon travail à la Sécurité Sociale, je décidais de participer au comité
des fêtes et à la marche de l'Union Sportive de Sendets.
Durant neuf ans, donc jusqu'en 1982 c’est une succession de réunions,
rassemblements, matchs qu'il fallait chaperonner, et parfois calmer de jeunes
coqs énervés.
Quant au comité des fêtes, qui préparait la fête du village, le 15 août à Sendets, cela nécessitait une préparation sérieuse pour trois jours et trois nuits de fêtes. Après la messe; le dépôt de la gerbe et la Marseillaise, apéritif-concert, bal à papa, ou soirées jeunes. Boissons, amuse-bouche, repas, buffet. Un podium pour disc-jockey, une aire de quilles de six. Après chaque soirée, il fallait balayer, remettre en état. Comme j'étais premier voisin de la mairie, il m’était laissé le soin de partir le dernier. Je fermais à clé. Une année, je me couchais les trois soirs en suivant à 4 h 30. Actuellement un excellent matériel, que nous aurions apprécié, spécial pour fêtes, est présent au foyer facilitant le travail des bénévoles. Le nouveau foyer municipal fut inauguré en mai 1975. Et nous avions fait venir l'orchestre André Auzias de Radio-Monte-Carlo et du Casino de Monaco. Nous eûmes 900 entrées.
18-Papy, nous pourrions
évoquer encore longtemps d’autres engagements, d’autres responsabilités, aux
anciens combattants notamment. Papy, il y a un temps pour tout, la fin de
l’émission approche, il y a aussi un temps pour la fin des engagements.
J’aimerais que vous nous racontiez votre vie quotidienne d’aujourd’hui, d’un
retraité depuis presque 30 ans, dans sa 90ème année, qui a la chance
d’avoir son
 épouse
auprès de lui et sa fille et le gendre à proximité immédiate.
épouse
auprès de lui et sa fille et le gendre à proximité immédiate.
 En
définitive, la retraite, c’est l’âge d’or. La retraite est bienvenue et
implique, au fil des années, un très important changement de mode de vie. Il
faut accepter la venue de l'âge et les petites choses qui ne manquent pas
d'apparaître. Mener une vie simple, régulière : lever à 7 h 30 l'été, à
huit heures l'hiver, petit déjeuner, toilettes, lecture du journal. Vers 9-10
heures dehors à la campagne, il y a toujours des choses à faire. Promenade, par
beau temps en vélo : 3/4 km. Lecture, musique sur le clavier, aide à la
préparation du repas qui est pris à 12-13 heures. Télévision, sieste, lecture,
jardinage, goûter à 16 h, puis diverses choses à faire encore. 17 h30 jeux
des « chiffres et des lettres », de « questions pour un
champion », matchs de foot, de rugby, « Tour de France ». La
télé, quelle chose merveilleuse à cet âge ! On y passe des heures !
En
définitive, la retraite, c’est l’âge d’or. La retraite est bienvenue et
implique, au fil des années, un très important changement de mode de vie. Il
faut accepter la venue de l'âge et les petites choses qui ne manquent pas
d'apparaître. Mener une vie simple, régulière : lever à 7 h 30 l'été, à
huit heures l'hiver, petit déjeuner, toilettes, lecture du journal. Vers 9-10
heures dehors à la campagne, il y a toujours des choses à faire. Promenade, par
beau temps en vélo : 3/4 km. Lecture, musique sur le clavier, aide à la
préparation du repas qui est pris à 12-13 heures. Télévision, sieste, lecture,
jardinage, goûter à 16 h, puis diverses choses à faire encore. 17 h30 jeux
des « chiffres et des lettres », de « questions pour un
champion », matchs de foot, de rugby, « Tour de France ». La
télé, quelle chose merveilleuse à cet âge ! On y passe des heures !
19-Papy, mon ultime
question : qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Et
qu’est-ce que vous auriez envie de transmettre d’essentiel aux plus
jeunes ?
La tolérance, le respect d'autrui
et des choses, l'honnêteté. Éviter les gaspillages, se contenter de peu, un
sourire brise la glace, aller vers l'autre, le saluer, travailler dans sa
profession pour progresser,
 pratiquer
le sport même en amateur pour la santé, un art si possible, faire partie
d'associations correspondant à vos désirs, endosser des responsabilités,
pratiquer la patience, ne jamais se décourager, être optimiste, positif,
solidaire. Éviter l'alcool, le jeu où on est presque toujours perdant,
respecter nos compagnes qui sont nos égales. Dans toute la mesure du possible,
ne jamais avoir affaire à la police et à la justice.
pratiquer
le sport même en amateur pour la santé, un art si possible, faire partie
d'associations correspondant à vos désirs, endosser des responsabilités,
pratiquer la patience, ne jamais se décourager, être optimiste, positif,
solidaire. Éviter l'alcool, le jeu où on est presque toujours perdant,
respecter nos compagnes qui sont nos égales. Dans toute la mesure du possible,
ne jamais avoir affaire à la police et à la justice.

Merci infiniment Papy pour le magnifique témoignage de vie que vous offrez en partage à la famille, aux amis, aux jeunes ainsi qu’à tous les auditeurs. Je ne saurais bien sûr passer sous silence, ma belle-mère qui va hocher la tête à mes propos, que je taquine largement et qui mériterait aussi une émission, qui ne se fera probablement pas. Vous me permettrez enfin de témoigner du bonheur dont nous bénéficions dans notre affectueuse proximité familiale, depuis déjà 10 ans ce mois-ci. Merci à tous les deux, à belle-maman et à beau-papa.
Il ne me reste plus qu’à vous annoncer le thème prévisible de mon mémoire du mois prochain : « Terre et Humanisme au cœur du local ». Il m’appartient de remplir de blanches pages, à vous offrir en partage dans un mois, mais je ne devrais pas être seul à m’exprimer car le « fou du roi », qui s’est déjà manifesté lors de précédentes émissions, a l’intention de sévir à nouveau. Sur ce, comme d’habitude, en vous disant à bientôt, nous vous adressons avec Papy et Mamy, nos fraternelles salutations.
lectures...