|
|
Nombre de lecture |
|
17ème
émission juillet 2006 |
|
|
(diffusion les 1er
mardi du mois à 21h et les 3ème lundi à 20h30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bovins
et Agro pastoralisme en vallée d’Aspe |
|

Aujourd’hui 17ème
émission de « Regards du Sud ». Nous avons le plaisir d’avoir avec
nous au studio de « Radio Voix du Béarn » trois jeunes intervenants.
Bonjour Messieurs (bonjour). Et donc je suis vraiment très, très heureux
d’accueillir ici Xavier Parailloux Caubet, Clovis Héraud et Léo Morlane
Hondère qui ont 16 ans et qui sont tous trois en 1ère au lycée
agricole de Montardon. Les 4 dernières émissions de « Regards du
Sud » étaient consacrées à un récent voyage au Mali dans le cadre d’un
projet d’autosuffisance alimentaire en milieu sahélien, avec l’association
« Terre et Humanisme » et Pierre Rabhi. Nous étions à Tacharane, à
20km au Sud de Gao, sur la boucle du Niger en relation avec trois ethnies
caractérisées toutes trois par une composante pastorale essentielle : les
Peuls, les Songhaï et les Touaregs. Eh bien aujourd’hui, nous allons poursuivre
sur le pastoralisme avec nos trois jeunes amis, qui sont partis en voyage, à
proximité, en vallée d’Aspe avec une intéressante interrogation « Est-ce
que les  bovins
sont adaptés au système agro-pastoral ? »
bovins
sont adaptés au système agro-pastoral ? »
Avant d’entrer dans le vif du sujet, juste un mot pour expliquer les multiples raisons de leur présence ici et dans cette émission. Je me limiterais à quelques-unes d’entre elles :
- la VDB est une radio d’ouverture et de proximité et l’émission « Radio du Sud » se veut une émission d’espoir qui élargit le regard aux dimensions du monde et s’adresse aux jeunes tout particulièrement,
- l’agriculture nourricière est essentielle à nos vies et à nos survies, et personne ne devrait jamais l’oublier,
- la raison dominante de leur présence à tous trois, il faut bien le dire, c’est eux seuls qui ont pris l’initiative courageuse d’utiliser l’outil radio pour rendre compte de leur stage à leurs professeurs, et aussi pour l’offrir en partage aux auditeurs, et j’ai beaucoup apprécié leur initiative et aussi cette liberté, cette chance qui leur était offerte par leurs professeurs et leur lycée.
Voilà, aussi, le cœur de l’émission sera la présentation aux auditeurs et à leurs professeurs de leurs travaux et de leurs conclusions.
Chers auditeurs, en préalable et confidentiellement, je vous propose une première partie, où nos jeunes amis se présenteront un peu plus et nous expliqueront tout ce qu’il est indispensable de savoir pour profiter pleinement de cette émission. Il devrait être question de vaches laitières, de vaches allaitantes, de vaches taries, de chaleurs, de gestation, de vêlage, de lactation, de bovins viande, de bovins lait, etc.etc.
Tout de suite je vais
donc donner la parole à chacun pour se présenter aux auditeurs et nous dire son
âge, où il habite, ses centres d’intérêt, etc.
….
Encore une question à
chacun. Vous êtes tous au lycée agricole de Montardon et j’ai tout à fait
compris que vous êtes motivés pour l’agriculture ou l’environnement. Quelle est
votre motivation profonde à chacun, et comment elle vous est venue ?
...
Maintenant, nous
allons essayer de familiariser les auditeurs avec l’élevage bovin. Peut-être
serait-il intéressant que vous racontiez la vie d’une vache ordinaire, en
essayant de décrire un cycle complet. Je suis sûr que les auditeurs vont
apprendre plein de choses. Qui se lance ?
Xavier.
Partons de la jeune vache, la génisse,
dès ses 2/3 ans elle a ses chaleurs périodiques (environ toutes les 3 semaines
) correspondant à ses périodes de fertilité, puis il y a insémination
artificielle ou naturelle suivie de la conception à la 1ère ou 2ème
saillie (on dit aussi au 1er ou au 2ème service). La
durée de gestation est de 9 mois (elle « porte » 9 mois) jusqu’au
vêlage, c’est-à-dire l’arrivée du veau. Il faut  savoir
qu’une génisse est une vache qui n'a pas de veau donc elle n'a pas de lait,
alors il faut la faire vêler pour qu’enfin la vache devienne productive.
Ensuite, deux solutions soit elle reste quelque temps avec son veau (broutard)
et est appelée vache allaitante (on parle de bovin viande), soit le veau est
enlevé rapidement et elle est vache laitière pour tirer des revenus du lait (on
parle de bovin lait). On parle aussi de vaches taries quand on ne tire plus le
lait deux mois avant le prochain vêlage.
savoir
qu’une génisse est une vache qui n'a pas de veau donc elle n'a pas de lait,
alors il faut la faire vêler pour qu’enfin la vache devienne productive.
Ensuite, deux solutions soit elle reste quelque temps avec son veau (broutard)
et est appelée vache allaitante (on parle de bovin viande), soit le veau est
enlevé rapidement et elle est vache laitière pour tirer des revenus du lait (on
parle de bovin lait). On parle aussi de vaches taries quand on ne tire plus le
lait deux mois avant le prochain vêlage.
On peut dire qu’entre deux vêlages, il y a 12 à 13 mois. La vie d’une vache ordinaire peut se résumer en 9 mois, où elle est pleine et 3 mois entre 2 vêlages. Quelques mots supplémentaires pour préciser qu’il existe des races de vaches laitières et des races de vaches allaitantes. Le cycle de lactation est le suivant : 8 jours de colostrum, très nourrissant pour le veau, puis au bout d’un mois il y a le pic de lactation avant une baisse jusqu'au tarissement 2 mois avant le vêlage.
Voilà après cette 1ère partie, nous entrons tout de suite
dans le cœur du sujet, avec notre deuxième partie, qui s’adresse celle-ci à la
fois aux professeurs, que je salue respectueusement, ainsi qu’aux auditeurs que
je salue comme d’habitude très fraternellement.
« Les bovins sont-ils
adaptés au système agro-pastoral ? »
A la lumière de votre
stage en vallée d’Aspe. Comment pensez-vous traiter cette question ?
 Le
point de départ de notre TPE est un stage en vallée d’Aspe que nous avons
effectué durant 5 jours au début de l’année scolaires, du 12 au 16 septembre
2005.
Le
point de départ de notre TPE est un stage en vallée d’Aspe que nous avons
effectué durant 5 jours au début de l’année scolaires, du 12 au 16 septembre
2005.
Les visites chez deux éleveurs du village de Lescun, leur témoignage et les informations données par les professeurs qui nous encadraient mais aussi par les intervenants extérieurs, ont amené à une réflexion sur « Les bovins et le pastoralisme ».
Nous traiterons la question en étudiant quatre paramètres communs aux vaches laitières et aux vaches allaitantes qui constituent l’élevage bovin en montagne :
![]() la reproduction
la reproduction
![]() l’alimentation
l’alimentation
![]() les installations
les installations
![]() les aspects vétérinaires
les aspects vétérinaires
Q2- Démarrons donc
par la reproduction. Que pouvez-nous en dire ?
Les vaches laitières
En hiver, au début de l’année, l’éleveur procède à un regroupement des chaleurs donc d’insémination artificielle pour obtenir ensuite un groupement de vêlages et d’automne.
Ainsi la vache à son maximum de production dispose de toute l’alimentation nécessaire (réserve de fourrages).
Le groupement de vêlage permet également un groupement des ventes de veaux et un groupement des vaches taries qui vont en estive.
Les vaches allaitantes
Au début de l’été (juin juillet), l’éleveur effectue aussi un groupement d’inséminations pour obtenir des vêlages printaniers, saison où la vache dispose avec son veau d’herbe abondante dans les prairies autour de l’étable.
Durant trois mois, la mère pâture et allaite son veau ; elle est ensuite à nouveau inséminée et part en estive jusqu’à fin septembre.
Q3-Et donc quelles
conclusions tirez-vous de l’analyse de ce 1er paramètre qu’est la
reproduction ?
Le paramètre de la reproduction est le seul que l’éleveur peut contrôler (regroupement des chaleurs, insémination artificielle).
De ce fait, il adapte la période des vêlages en fonction de la courbe de lactation et de l’alimentation disponible, selon les différentes saisons de l’année.
Pour les vaches laitières, les regroupements d’insémination sont intéressants pour obtenir des groupes de vaches taries facilitant le déplacement et le rationnement.
Pour les vaches allaitantes, les regroupements des vêlages sont intéressants pour obtenir des lots de veaux du même âge destinés à l’engraissement (broutards).
Ainsi, l’éleveur a adapté la reproduction des bovins au système agropastoral.
Q4-Le 2ème
paramètre concerne l’alimentation. Est-ce un paramètre important ?
L’alimentation constitue un des paramètres importants permettant de se faire une opinion sur l’adaptation des bovins au système agropastoral.
Les vaches laitières
En production
Les vaches laitières ont besoin d’une ration complète et équilibrée pour fournir une production importante, un bon rendement.
En hiver, cette ration se compose de fourrage (foin et luzerne) et d’aliment complet en granulés intégrant des céréales (maïs, orge, blé) du tourteau de soja, des minéraux et des vitamines.
La ration des équilibrée ;
chaque vache bénéficie par jour, de foin à volonté, de  complet
(60% de maïs, 10 % de céréales à paille, 10 % de tourteau de soja, 15 % de
minéraux (bicarbonate) et 5 % de CMV)
complet
(60% de maïs, 10 % de céréales à paille, 10 % de tourteau de soja, 15 % de
minéraux (bicarbonate) et 5 % de CMV)
en été, les réserves de fourrage sont épuisées et l’alimentation journalière est constituée alors de pâture à volonté durant la journée, sur l’exploitation, et de 6 kg d’aliment complet (30% de maïs, 40% de céréales à paille, 10% de tourteau de soja, 15 % de minéraux (bicarbonate) et 5 % de CMV)
Les vaches taries
En hiver, les vaches taries sont nourries de foin à volonté ; celles qui sont taries en été de juin à fin septembre montent en estive, propriété communale car en cette saison, l’herbe de la vallée est réservée à la pâture des vaches en production et à la récolte du foin pour constituer les réserves hivernales.
Les vaches allaitantes
L’alimentation d’un bovin viande
est moins complexe que celle d’une vache laitière. En effet, c’est seulement
durant les mois d’hiver de mi-octobre à fin mars que le bétail reçoit une
ration constituée de foin à volonté et de
Au printemps, les vaches qui ont vêlé pâturent dans les prés de l’exploitation en compagnie des veaux.
A partir du mois de juin, les vaches allaitantes qui ont vêlé depuis 3 mois quittent leur veau pour partir en estive jusqu’à la fin septembre.
Q5- Et maintenant,
quelles sont vos conclusions quant au paramètre alimentation ?
La pâture et le foin sont des éléments de l’alimentation communs aux vaches allaitantes et aux vaches laitières produits sur l’exploitation.
Il est à noter cependant que certaines exploitations possédant un nombre de têtes de bovins trop élevé par rapport à leur SAV sont obligées d’acheter du fourrage à l’extérieur.
L’aliment complet et la luzerne donnés aux vaches laitières qui constituent approximativement la moitié de la ration sont achetés à l’extérieur.
Le maïs distribué aux bovins viande correspondant environ à un quart de l’alimentation annuelle est également acheté en plaine : le climat montagnard, le relief et la structure du sol ne permettent pas de cultiver des céréales.
Au vu de ces données, on peut constater donc que l’agriculture de montagne ne répond qu’en partie aux besoins alimentaires des bovins avec cependant une différence notable ; en effet si elle fournit les ¾ de l’alimentation des vaches allaitantes, elle ne pourvoit qu’à la moitié des besoins alimentaires des vaches laitières.
Q6-Vous avez cité les
installations comme 3ème paramètre. Dites-nous ce que vous entendez
par ce mot et puis pouvez-vous nous  résumer ce qui vous a paru important ?
résumer ce qui vous a paru important ?
1. Le logement
![]() Généralement, les vaches laitières
comme les vaches allaitantes sont à l’attache dans des étables situées dans la
vallée, près de la maison d’habitation.
Généralement, les vaches laitières
comme les vaches allaitantes sont à l’attache dans des étables situées dans la
vallée, près de la maison d’habitation.
![]() Les vaches sont sur une aire
paillée (coûteux) ou fougère et prennent la nourriture dans la mangeoire devant
elles.
Les vaches sont sur une aire
paillée (coûteux) ou fougère et prennent la nourriture dans la mangeoire devant
elles.
![]() L’été, les vaches laitières
passent la journée dans les prairies autour du bâtiment et rentrent à l’étable
le soir pour la traite.
L’été, les vaches laitières
passent la journée dans les prairies autour du bâtiment et rentrent à l’étable
le soir pour la traite.
![]() Les vaches allaitantes ayant vêlé
depuis 3 mois et étant inséminées, sont envoyées en estive, celles qui ont
récemment vêlé restent à l’exploitation avec leur veau ; elles sont libres
d’aller à l’extérieur et de rentrer à l’étable comme elles veulent.
Les vaches allaitantes ayant vêlé
depuis 3 mois et étant inséminées, sont envoyées en estive, celles qui ont
récemment vêlé restent à l’exploitation avec leur veau ; elles sont libres
d’aller à l’extérieur et de rentrer à l’étable comme elles veulent.
2. le matériel de traite
![]() La traite a lieu exclusivement
dans la vallée, à l’exploitation. Il n’y a pas de salle de traite, elle
s’effectue à l’aide d’une trayeuse constituée de pots suspendus déplacés de
vache en vache.
La traite a lieu exclusivement
dans la vallée, à l’exploitation. Il n’y a pas de salle de traite, elle
s’effectue à l’aide d’une trayeuse constituée de pots suspendus déplacés de
vache en vache.
3. la fromagerie
![]() C’est une pièce attenant à
l’étable, mise aux normes européennes où sont élaborés les fromages ; à
côté se trouve le saloir où les fromages sont affinés.
C’est une pièce attenant à
l’étable, mise aux normes européennes où sont élaborés les fromages ; à
côté se trouve le saloir où les fromages sont affinés.
4. le stockage
![]() le fourrage :
le fourrage :
![]() Il est stocké directement
au-dessus de l’étable, sur le plancher.
Il est stocké directement
au-dessus de l’étable, sur le plancher.
![]() Il est à noter que la ration est
distribuée manuellement.
Il est à noter que la ration est
distribuée manuellement.
![]() les effluents :
les effluents :
![]() La litière est sur un caillebotis
et la fosse à purin est située sous l’étable.
La litière est sur un caillebotis
et la fosse à purin est située sous l’étable.
![]() Le fumier est évacué manuellement
puis stocké sur une fumière à l’extérieur.
Le fumier est évacué manuellement
puis stocké sur une fumière à l’extérieur.
5. matériel de contention.
![]() Ce matériel est utilisé pour
faciliter le chargement et le déchargement des bovins qui vont en estive.
Ce matériel est utilisé pour
faciliter le chargement et le déchargement des bovins qui vont en estive.
![]() Le bétail est transporté dans des
bétaillères jusqu’au bout de la voie carrossable, le matériel de contention est
utilisé pour canaliser les bovins à la descente du véhicule.
Le bétail est transporté dans des
bétaillères jusqu’au bout de la voie carrossable, le matériel de contention est
utilisé pour canaliser les bovins à la descente du véhicule.
![]() La même opération a lieu à la
descente de l’estive pour faire monter les bovins dans la bétaillère et
rejoindre l’exploitation.
La même opération a lieu à la
descente de l’estive pour faire monter les bovins dans la bétaillère et
rejoindre l’exploitation.
Q7-Nous avons bien saisi ce
paramètre installations. Et quelles sont vos conclusions en la matière ?
Comme pour le paramètre de l’alimentation, on remarque que le bovin viande est plus adapté au système agropastoral que les vaches laitières.
Comme il n’y a pas de contrainte de traite, les vaches allaitantes ont besoin d’un minimum d’installations (4 à 5 mois en estive).
De plus la traite manuelle est trop pénible pour que l’éleveur envisage de monter ses vaches laitières en production.
Les bovins allaitants sont assez bien adaptés au système agropastoral car ils montent l’été en estive ce qui permet de garder l’herbe de la vallée pour les réserves d’hiver. A l’inverse, les vaches laitières en production, en raison des contraintes de traites, restent sur l’exploitation toute l’année.

Q8- Si je me souviens bien, le
4ème paramètre était relatif aux aspects vétérinaires. Pour vous,
qu’est-ce que cela veut dire exactement et qu’avez-vous appris en ces
domaines ?
Choix de la race
![]() ◄ Vache laitière : la
Brune des Alpes est une race de vache laitière rustique, adaptée aux conditions
difficiles de la montagne (relief, température…). Leur morphologie et
physiologie favorisent cette adaptation et privilégie la rusticité plutôt que
la productivité.
◄ Vache laitière : la
Brune des Alpes est une race de vache laitière rustique, adaptée aux conditions
difficiles de la montagne (relief, température…). Leur morphologie et
physiologie favorisent cette adaptation et privilégie la rusticité plutôt que
la productivité.
![]() Vache allaitante : la Blonde
d’Aquitaine est une race de vache à viande naturellement adaptée puisqu’elle
est issue de la région et qu’elle est
Vache allaitante : la Blonde
d’Aquitaine est une race de vache à viande naturellement adaptée puisqu’elle
est issue de la région et qu’elle est  également
rustique dans sa morphologie et sa physiologie. ►
également
rustique dans sa morphologie et sa physiologie. ►
Les contraintes liées à l’estive
![]() Les aspects vétérinaires sont une
part très importante pour l’agriculture de montagne car sans cela le troupeau
pourrait être mis en danger et mettre en danger les autres troupeaux.
Les aspects vétérinaires sont une
part très importante pour l’agriculture de montagne car sans cela le troupeau
pourrait être mis en danger et mettre en danger les autres troupeaux.
![]() Le vétérinaire suit le troupeau
tout au long de l’année ; c’est lui qui autorise un bovin à partir en
estive.
Le vétérinaire suit le troupeau
tout au long de l’année ; c’est lui qui autorise un bovin à partir en
estive.
![]() Il effectue un test sanguin pour
tous les bovins devant partir en estive afin de détecter d’éventuelles maladies
comme la brucellose, la tuberculose, l’IBR (une maladie pulmonaire :
infection bovine rhino trachéite) ou encore le charbon.
Il effectue un test sanguin pour
tous les bovins devant partir en estive afin de détecter d’éventuelles maladies
comme la brucellose, la tuberculose, l’IBR (une maladie pulmonaire :
infection bovine rhino trachéite) ou encore le charbon.
![]() Ces maladies étant contagieuses,
le vétérinaire ne peut laisser partir un bovin atteint de l’une de ces maladies
pour ne pas contaminer les autres bovins en estive.
Ces maladies étant contagieuses,
le vétérinaire ne peut laisser partir un bovin atteint de l’une de ces maladies
pour ne pas contaminer les autres bovins en estive.
![]() De plus, le carnet de santé du
bovin et son passeport doivent être à jour.
De plus, le carnet de santé du
bovin et son passeport doivent être à jour.
![]() Lors d’un accident en estive
(patte cassée le plus couramment), le bovin doit être hélitreuillé afin que le
vétérinaire puisse le soigner.
Lors d’un accident en estive
(patte cassée le plus couramment), le bovin doit être hélitreuillé afin que le
vétérinaire puisse le soigner.
![]() Le vétérinaire permet donc le bon
fonctionnement du système agropastoral et constitue un élément essentiel pour
le troupeau.
Le vétérinaire permet donc le bon
fonctionnement du système agropastoral et constitue un élément essentiel pour
le troupeau.
Q9-Vous devinez ma question.
Dans ces aspects vétérinaires que vous avez définis, quelles sont vos
conclusions ?
Ainsi le bovin en montagne, du fait de sa race et du peu de contrainte de prévention spécifique à l’estive, semble adapté au système agropastoral, l’inconvénient majeur est lié au risque d’accident en estive et aux difficultés pour secourir et soigner l’animal blessé.
On peut noter que l’éleveur prend le plus souvent une assurance pour couvrir ce risque qui peut entraîner des frais importants.

Q10-Au stade actuel, nous
disposons, les auditeurs, vos professeurs et moi-même, de quatre conclusions
partielles. Pouvez-vous maintenant conclure en une synthèse globale, et nous
donner votre réponse à la question : « Est-ce que les bovins sont
adaptés au système agro-pastoral ? »
Ainsi le bovin en montagne, du fait de sa race et du peu de contrainte de prévention spécifique à l’estive, semble adapté au système agropastoral, l’inconvénient majeur est lié au risque d’accident en estive et aux difficultés pour secourir et soigner l’animal blessé.
On peut noter que l’éleveur prend le plus souvent une assurance pour couvrir ce risque qui peut entraîner des frais importants.
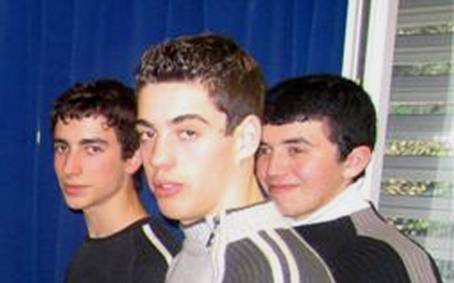 Eh
bien, merci infiniment Xavier, Clovis et Léo. J’ai beaucoup apprécié de
m’immerger dans votre sujet. Je suis très heureux que vous vous soyez lancés
dans cette aventure radiophonique. C’était une première pour vous. Ce ne sera
pas, j’en suis sûr la dernière. Merci encore et bravo. Mais je voudrais
prolonger encore quelques instants cette émission avec quelques
questions :
Eh
bien, merci infiniment Xavier, Clovis et Léo. J’ai beaucoup apprécié de
m’immerger dans votre sujet. Je suis très heureux que vous vous soyez lancés
dans cette aventure radiophonique. C’était une première pour vous. Ce ne sera
pas, j’en suis sûr la dernière. Merci encore et bravo. Mais je voudrais
prolonger encore quelques instants cette émission avec quelques
questions :
J’aurais envie de
poser à chacun la même question d’imagination. Vous avez tous les trois 16 ans.
Comment vous voyez-vous dans votre vie professionnelle, dans une vingtaine
d’années ? Et il n’est pas interdit de rêver.
…
Chers jeunes, en
final, je voudrais vous dire en vous remerciant très fort que j’ai beaucoup
apprécié de vous initier à la radio, et aussi de préparer et d’enregistrer avec
vous cette émission. Mon ultime question, posée à chacun sera donc : et
vous, qu’avez-vous à dire de cette expérience radiophonique ?
…
Encore un grand merci à tous les trois. Il ne me reste plus qu’à vous annoncer le thème de la prochaine émission, la 18ème diffusée à la rentrée de septembre, le 5 septembre à 21h. Nous tenterons la synthèse de là où nous en sommes actuellement de notre vaste projet : « Comment construire tous ensemble un monde plus fraternel ? ». Et donc, en ce qui me concerne, au boulot et en ce qui concerne les auditeurs, à très bientôt, avec mon amical et fraternel bonsoir.

